Revue néo-scolastique Du beau dans la nature et dans l'art (suite) Désiré Merci
Revue néo-scolastique Du beau dans la nature et dans l'art (suite) Désiré Mercier Citer ce document / Cite this document : Mercier Désiré. Du beau dans la nature et dans l'art (suite). In: Revue néo-scolastique. 1ᵉ année, n°4, 1894. pp. 339-348; doi : https://doi.org/10.3406/phlou.1894.1388 https://www.persee.fr/doc/phlou_0776-5541_1894_num_1_4_1388 Fichier pdf généré le 26/04/2018 XVII. Du beau dans la nature et dans l'art. (Suite *). L'art est le moyen de réaliser et d'exprimer le beau, ou, plus explicitement, l'art a pour but d'incarner dans une belle forme sensible la beauté idéale, et d'en procurer à autrui avec la contemplation la pure jouissance. La nature, en elle-même, est si belle, que l'esprit humain ne peut en épuiser les merveilles; elle est le véritable Héal que l'artiste n'atteindra jamais. Faire « plus beau que la nature » n'est pas possible. Est-ce à dire que l'artiste n'ait pas d'autre mission que de copier la réalité? Le prétendre, ce serait ravaler l'art au niveau d'un métier de photographe. Doit-il donc fausser la nature? Moins encore; ce serait descendre au dessous de la reproduction servile de la réalité. Aussi bien, personne ne le conteste, ce qui est contre nature est laid. Comment sortir de cette alternative ? Au moyen d'une distinction entre la nature individuelle, tixée en un type unique telle que les sens la perçoivent, et la nature abstraite telle qu'elle est concevable par l'intelligence sous des aspects partiels et par conséquent multiples à des points de vue différents. Réduire le rôle de l'artiste à l'imitation exacte d'un type réel, concret, déterminé, c'est du réalisme de mauvais aloi, c'est l'application du sensualisme matérialiste au domaine de l'art. Mais, à l'extrême opposé, prôner la conception d'un idéal indépendant de l'observation de la nature réelle, c'est se jeter dans un idéalisme arbitraire et aboutir tôt ou tard à un symbolisme inintelligible. *) V. n° de Juillet. Jlevue Néo-Scolastique, Zw 340 D. MERCIER. Tout objet intelligible, en effet, tout idéal du génie artistique vient originairement des sens et ne renferme, par conséquent, aucun clément positif qui ne soit emprunté aux choses sensibles de la nature. Mais l'intelligence conçoit cet objet autrement que les sens ne le perçoivent. Les choses sensibles ne réalisent jamais adéquatement la perfection de la- nature qu'elles enveloppent en un type concret. Il appartient à l'intelligence d'abstraire des réalités concrètes fournies par l'observation, le type qui s'y trouve engagé; ainsi abstrait,- il devient concevable sous de multiples aspects, réalisable en une infinité de types concrets qui le reproduiront toujours dans ses traits essentiels sans l'épuiser jamais. Concevoir ainsi une nature abstraite imitable par des reproductions concrètes, variables à l'infini, qui s'approchent de la perfection typique sans l'égaler jamais, c'est concevoir l'idéal r). Viser à exprimer cet idéal, le plus énergiquement , le plus vivement possible, à l'aide de formes matérielles, c'est l'objectif de l'art. L'idéal, que les réalistes veulent nier, que les idéalistes exaltent outre mesure, n'est donc pas autre chose que la nature elle-même, non pas évidemment telle que les sens la perçoivent fixée en un sujet déterminé, mais telle que l'esprit la conçoit, envisagée sous un aspect spécial qui en révèle avec intensité la perfection et qui, exprimé par des formes sensibles appropriées, produira chez autrui, avec la vieion de l'ordre ou de la perfection, le sentiment du beau 2). J) C'est cet idéal que les Ontologistes ont confondu avec l'Absolu. •» L'idéal recule sans cesse à mesure qu'on en approche davantage, écrit M. Cousin. Son dernier terme est dans l'infini, c'est-à-dire en Dieu; on, pour mieux parler, le vrai et absolu idéal n'est autre que Dieu lui-même. » Du vrai, du beau et du bien, 7roo leçon. ~) R. Topffer observe très justement que l'artiste croit souvent imiter la nature, tandis que, en réalité, il l'interprète. « L'artiste, écrit-il, a le sentiment qui le guide et qui l'éclairé; ses prémisses peuvent être fausses, mais peu importe, presque d'intuition, il conclut juste. Qui donc n'a pas rencontré tels peintres, parmi les plus excellents, qui imitent de la façon la plus libre, la plus belle, la plus poétique, tout en ne croyant que copier humblement, servilement? M. Jourdain faisait de la prose; eux, c'est de la poésie qu'ils font sans le savoir. « Mais qui n'a pas rencontré aussi tels peintres que ce faux principe égare, DU BEAU DANS LA NATURE ET DANS L'ART. 341 Chaque espèce d'êtres a son rôle à jouer ici-bas, leur nature est faite en conséquence; leurs parties sont justement disposées de manière à permettre l'accomplissement de ce rôle qui forme leur destinée 1). Comprendre la nature des êtres et la concordance qui en résulte au sein de leur composition, plus brièvement, comprendre l'ordre harmonieux de la nature pour le faire ensuite admirer à autrui, telle est donc la noble tâche des beaux-arts. Mais les richesses de perfection de la nature nous dépassent ; il appartient au génie de l'artiste de nous apprendre à la regarder et à admirer les merveilles qu'elle étale à nos yeux distraits ou mal exercés. En résumé, comprendre la nature et l'interpréter pour nous, afin de nous la faire mieux admirer, telle est la double mission du génie artistique. La conception ou l'invention, et l'expression ou l'exécution sont les deux moments de son travail. La théorie qui assigne pour but aux beaux-arts la conception et l'expression par des formes sensibles de l'idéal tel que nous l'avons défini tout à l'heure, nous semble résumer les principes essentiels de l'esthétique. Si le terme n'avait pas reçu par l'usage une autre acception, nous dirions que c'est là le naturalisme sainement entendu. et qui s'en font un bouclier contre une critique juste et fondée £ En voici un qui a peint une scène de deuil et de misère : c'est un vieillard, et, auprès de lui, morte dans sa couche délabrée, une jeune tille qui était son soutien et qui soignait ses vieux jours. Le sujet avait sa beauté : cependant le tableau, au lieu d'attacher, repousse; au lieu d'intéresser, fait peine. C'est que le peintre, pour faire vrai, a fait réel. Au sentiment poétique qui cherche une pensée, il a substitué la pure imitation qui cherche une copie, et, en atteignant au vrai, il a touché au triste, au vulgaire, à l'ignoble, au taudis, au cadavre. La critique détourne les yeux : il la trouve bien raffinée; la critique l'attaque sur le vrai, et il la repousse au nom de ce vrai lui-même. " Cet autre a peint un homme qu'on va pendre ou guillotiner. Le sujet, ici, offrait plus d'écueils que de beautés. La] critique, qui blâmait déjà le sujet, blâme plus encore le tableau qui fait frémir de vérité. L'artiste lui tient tête au nom de cette vérité même, et la prospérité, je veux dire le public, est pour lui; le sens commun aussi. « Réflexions et menus propos d'un peintre genevois, liv. IV, chap. VII. ') Cfr, Jnuffroy, Cours d'esthétique, 10e leçon. 342 D. MERCIER. Entrons dans quelques développements sur le double travail de conception et d'expression que demande une œuvre d'art. Comprendre la nature, ce n'est pas en observer passivement les divers éléments, mais saisir leurs relations, embrasser (comprebendere, com-plecti) leur coordination dans l'ensemble, dégager leur harmo- nieuse unité. Toutefois, autre est le rôle du savant, autre celui de l'artiste dans l'étude de la nature. Le savant n'a pas d'autre ambition que de connaître ; tout ce qui peut enricbir la connaissance se recommande donc, à titre égal, à son attention. L'artiste a pour but de saisir et de nous faire voir la nature sous un aspect spécial, de manière à éveiller dans toutes nos facultés perceptives et émotives ce ravissement complet qui se traduit dans l'admiration et l'enthousiasme du beau. ]) L'homme de science n'est préoccupé que de la compréhension de l'objet ; le génie de l'artiste étudie à la fois l'harmonie de l'objet et les ressorts à faire jouer pour que l'unité harmonieuse de l'objet apparaisse ravissante au sujet. L'homme de science expose la vérité toute nue et se défend contre les entraînements du sentiment ; l'artiste expose pour émouvoir, son but dernier est de faire impression. Aux prises avec la nature, l'artiste n'a pas la folle prétention de *) « Le géomètre, écrit Tôpffer, saisit les formes par leurs propriétés absolues : angle, rectangle, cercle. L'artiste les saisit par leurs propriétés relatives, soit à l'objet, soit à lui, forme gracieuse, triste, molle, repoussante, etc.. » Op. cit., p. 133. " L'œuvre d'art, écrit M. Taine, a pour but de manifester quelque caractère essentiel ou saillant, partant quelque idée importante, plus clairement et plus complètement que ne le font les objets réels. Elle y arrive en employant un ensemble de parlies liées dont elle modifie systématiquement les rapports. » « Ainsi, écrit-il ailleurs, les eboses passent du réel à l'idéal lorsque l'artiste les reproduit en les modifiant d'après son idée, et il les modifie d'après son idée lorsque, concevant et dégageant en elles quelque caractère notable, il altère systématiquement les rapports naturels de leurs parlies pour rendre ce caractère plus visible et plus dominateur. » uploads/s3/du-beau-dans-la-nature-le-genie.pdf
Documents similaires


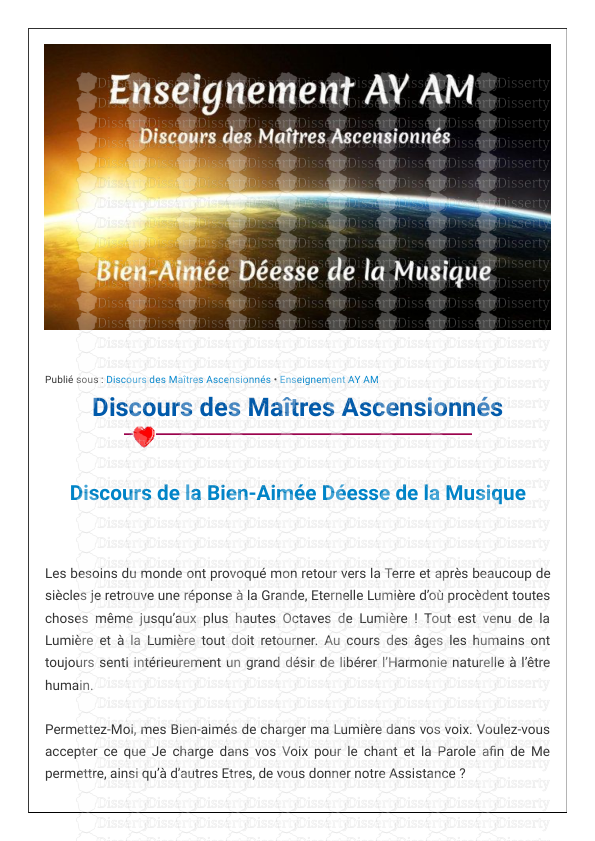

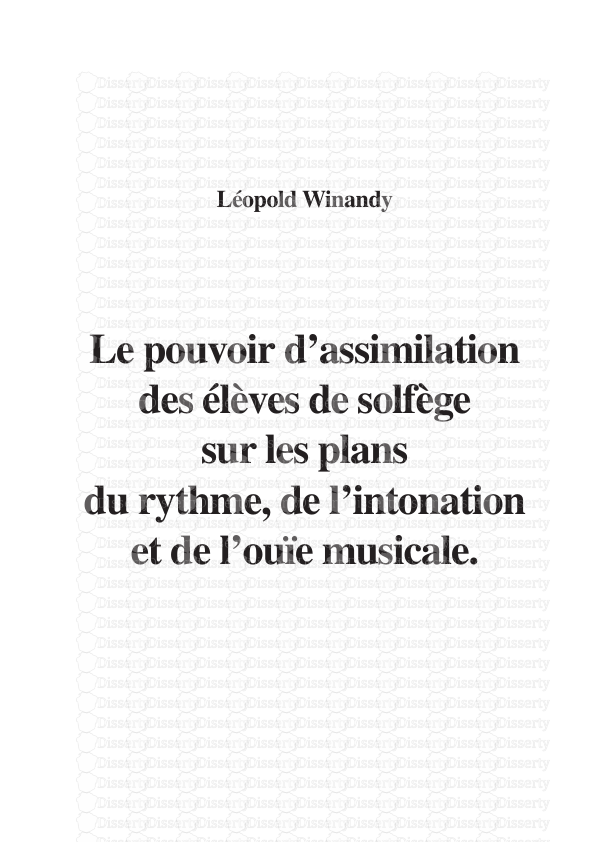





-
68
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 21, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6273MB


