Simone Bodève – biographie 2 SIMONE BODÈVE BIOGRAPHIE Edition: zebras54.fr (Dom
Simone Bodève – biographie 2 SIMONE BODÈVE BIOGRAPHIE Edition: zebras54.fr (Dominique Hoffmann) 3 4 Simone Bodève est le pseudonyme de Jeanne Chrétien née le 1er Février 1876 au 113 rue d'Aboukir, dans le 2e arrondissement de Paris C'est la fille aînée d'Eugène Chrétien (né en 1849) et de Eugénie Debove (né en 1854). Tous deux travaillaient comme fabricants de fleurs artificielles). Est ce que notre auteur a-t-elle tiré son pseudonyme du nom de jeune fille de sa mère? Sur l'acte de naissance de Jeanne, on voit le nom des deux témoins ; un oncle Louis Chrétien (né 1854) et Théodore Larcanger. Tous deux habitaient avec la famille au 113 rue d'Aboukir. Louis avait la même profession que son frère et sa belle-soeur et Théodore était cordonnier. Le greffier qui a enregistré la naissance s'appellait Roger Dhostel. Plusieurs petites entreprises liées au textile travaillent toujours dans ce quartier, dont une située au 113 rue d'Aboukir. 5 Lorsqu'Henri nait en 1879, la famille habite 12 rue du Faubourg Saint-Denis ; Eugène travaille comme tapissier sa femme Eugénie travaille toujours dans la fabrication de fleurs artificielles. Bientôt Jeanne et Henri auront quatre frères et soeurs. Mathilde, Léon et Georges. Marguerite, la cadette nait en 1889. D'après la nécrologie de Claire Géniaux, Jeanne était une fille précoce avec un esprit sérieux. À l'école communale, elle excellait en science. Elle termine l'école à quatorze ans avec son certificat. C'est la norme pour les enfants des classes populaire de cette époque de quitter l'école après le certificat pour suivre une formation. On attend des filles qu'elles gagnent de l'argent et se marient vite pour quitter le foyer familial. Elle suit une formation dans le métier des fleurs artificielles et pendant son temps libre, elle étudie la science, l'allemand et l'anglais. Elle prend des cours de mathématiques et de philosophie. Blaise Pascal l'inspire tout autant que l'astronomie. Elle devient membre avec son frère de la toute nouvelle société française d'astronomie. On a peu de documents sur sa vie familiale. Son futur beau-frère, époux de Marguerite, écrit dans son journal que Jeanne vivait avec sa mère au 9 rue Mandar. 6 Le métier des fleurs artificielles http://institut-metiersdart.org/ La fabrication de fleurs artificielles fut très active en France de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle. Aujourd’hui seules trois grandes maisons employant entre dix et trente fleuristes subsistent : Légeron, Lemarié et Guillet. Parallèlement, un nombre très réduit de professionnels exercent dans des ateliers constitués d’une ou de deux personnes. Les fabricants de fleurs artificielles s’adressent à une clientèle de professionnels recherchant des produits de grande qualité. Ce sont les modistes, les maisons de haute-couture ou de prêt-à- porter de luxe dans le domaine de la mode. En décoration, les débouchés se situent surtout dans l’univers du spectacle ou de l’événementiel : théâtre, cinéma, opéra ou bien publicités et vitrines de marques prestigieuses. La vente aux particuliers a pâti de la production de pièces en plastique et de la concurrence étrangère. Mais il reste un marché de niche notamment pour les parures de mariées. A l’international, il existe un marché à l’exportation en Europe de l’Ouest, au Japon, en Australie et en Amérique du Nord. La Chine possède aussi une petite clientèle très aisée qui se fournit auprès des maisons françaises. Jeanne fait partie de 6.000 personnes qui travaillent dans cette profession. Il y a une forte demande parce que les fleurs à corsage étaient à la mode. Paris et New York sont les principaux centre de production et les couturiers, modistes, merceries, marchand de tissu, boutiques achètent chez les artisans. Par contre c'est une profession alléatoire et les ouvriers gagnent environ 3.50 francs (le 7 prix d'un livre de poche, ou d'un loyer d'une semaine pour une chambre mansardée) par jour. Il n'y a pas d'assurance maladie, assurance vieillesse ou assurance- chômage. Les ouvriers travaillent à leur compte, et les périodes de pleine activité alternent avec les périodes creuses. Dans le quartier de Jeanne, la Maison Sajou est une des merceries clientes, et elle existe encore aujourd'hui quoique le magasin d'origine a fermé ses portes en 1950. Il y a une dizaine d'année, la Maison Sajou a repris son activité sous forme d'artisanat spécialisé 8 Jeanne passe son diplôme de dactylographie et change de métier. Elle travaille comme dactylo chez Paz et Silva au 55 rue Saint-Anne dans le 2e arrondissement, cette entreprise produit du matériel électrique. Elle s'interesse à la vie culturelle de l'époque et se lie d'amitié avec George de Bouhelier, dramaturge et ami d'enfance du beau-fils d'Émile Zola. Le père de George de Bouhelier était un homme politique et parmi ses connaissances, il comptait le poète Paul Verlaine. L'éditeur Bonvallot-Jouve se trouve sur la route du lieu de travail de Jeanne. En 1907, Celle-ci adopte le pseudonyme de Simone Bodève et leur soumet le manuscrit de son premier roman : La Petite Lotte. La Petite Lotte s'inscrit tout à fait dans la tradition réaliste d'Émile Zola. Ce livre connait un certain succès parmi la critique puisqu'il est nommé au Prix Goncourt. Là, les critiques sont divisés, le journaliste Vergalen surnomme le livre « La Petite Sotte » mais l'écrivain Octave Mirbeau se passionne pour cette héroïne issue de la classe ouvrière. Mais Simone Bodève ne deviendra pas la première lauréate du Prix Goncourt, ce sera une autre Simone – Simone de Beauvoir – qui le sera en 1954. En 1907, la palme revient à Émile Moselly et son ouvrage « Terres Lorraines » lequel s'inscrit bien dans la tradition des romans réalistes bucoliques. « La Petite Lotte » est pourtant l'un des premiers romans français sur la classe ouvrière écrit par une femme issue de la classe ouvrière. Simone Bodève fait partie d''un groupe très petit puisqu'on compte seulement les écrivaines américaines Agnes Smedley and Meridel LeSueur. En France, le premier roman populaire lauréat 9 d'un prix littéraire sera « l'Atelier de Marie-Claire » écrit par Marguerite Audoux. 10 Aprés le Prix Goncourt, Simone Bodève continue de travailler comme dactylo chez Paz et Silva. « l'Aurore » un journal de tendance socialist l'Aurore mentionne son nom. La Maison Bonvallot-Jouve est reprise par la Maison Paul Ollendorff en 1908. Celle-ci publie « Clo », le deuxième roman de Simone Bodève. L'écrivain Romain Roland s'engoue pour ce livre car il en fait l'éloge dans une lettre à ses amis. Le journal «Le Rappel » publie une critique favorable. L'année suivante, en 1909, le journal « Le Petit Parisien » publie quatre contes : Les Premiers Pas, La Gaffe, La Peur, La Tour Gazou, l'Habitude. Ce dernier conte sera republié par « l'Aurore » Claire Géniaux reçoit Simone Bodève dans les bureaux de son magazine « La Femme », elle décrit Simone Bodève comme étant mince, pâle et nerveuse. Simone parle beaucoup, son visage encore jeune est si ridé et si fatigué que la journaliste se demande si l'écrivaine dort assez. Les écrivains issus de la classe ouvrière doivent presque toujours travailler à plein temps pour subsister fnancièrement et donc écrire empiète sur les heures de sommeil. 11 Les écrivains progressistes issus des classes moyennes comme Romain Roland, Georges de Bouhelier, Madeleine Paz et le journaliste Marcel Martinet étaient d'avis que les classes populaires devaient être mieux représentées dans le monde de la publication. Marcel Martinet crée « L'Effort Libre » une revue qui promouvoit la diversité. Cette revue publie « Double Morale » , un essai sur la condition féminine dans le mariage et le droit de vote des femmes. Elle écrit qu'un mariage sans respect est un mariage sans valeur car ce n'est qu'un arrangement financier qui profite au mari. Simone Bodève par contre reste célibataire, elle ne veut pas être une femme entretenue.Elle participe aussi à des débats publics. L'écrivaine Rachilde et le philosophe Émile de Durkheim (fondateur de la sociologie) ne la trouvent pas assez intellectuelle. Une partie de la presse est hostile à son nouveau roman « Son Mari » , elle reproche à Simone Bodève son style peu soutenu. Par contre, Claire Géniaux est d'avis que Simone Bodève depeint ses personnages de manière lucide et réaliste. Ce sont des personnages durs qui luttent contre les bas-salaires et ne mangent pas suffisamment. 12 En 1911, Ollendorff re-publie « La Petite Lotte » et les critiques sont favorables. Les droits des enfants sont un sujet important pour Simone Bodève, et elle publie un essai dans « L'Enfant » un magasine d'une association Belge de l'enfance. Dans la Revue Bleue, l'avis de Lucien Maury n'est pas tout à fait favorable. Il trouve la troisième partie du livre peu réaliste. On peut très facilement refuter cet argument en expliquant les détails biographiques de Simone Bodève et de son frère Henri. Malgré tout, Lucien Maury conclut que Simone Bodève est un écrivain à retenir. Paul Valdagne de la revue « Touche à Tout » trouve que la troisième partie du livre est source d'inspiration pour les esprits progressistes issus des classes aisées. Malgré tout, constate Claire Géniaux, « La Petite Lotte » ne connut pas uploads/Finance/ simone-bodeve-biographie.pdf
Documents similaires
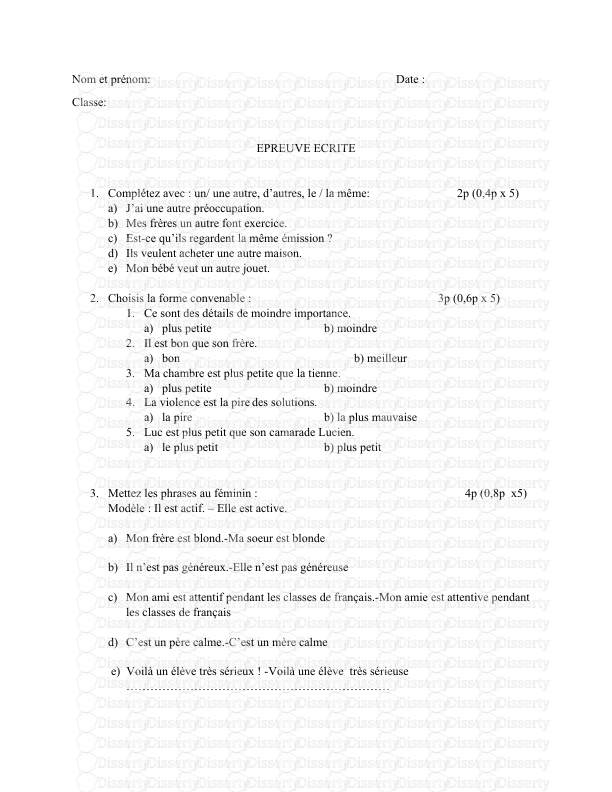






-
308
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 21, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.4455MB


