1 2 A-GESTION DE PROJET 1-Gestion de projet 2-Exemples de projet 3- Maîtrise d'
1 2 A-GESTION DE PROJET 1-Gestion de projet 2-Exemples de projet 3- Maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage 4-Relations maître d'ouvrage - maître d'oeuvre 5-La nécessité d'une méthodologie claire 6-Le Schéma Directeur 7-Comité de pilotage 8-Les étapes du projet B-PHASE PREPARATOIRE 1-L'étude d'opportunité 2-L'étude de faisabilité 3-L'étude détaillée 4-L'étude technique C-PHASE DE REALISATION 1-Préparation 2-Réalisation 3-Documentation 4-Validation D-PHASE DE MISE EN ŒUVRE 1-Recette 2-Qualification 3-Mise en production 4-Capitalisation 5-Maintenance E-LES OUTILS I- Cahier des charges 1-Intérêt d'un cahier des charges 2-Eléments principaux 3-Clauses juridiques II-Diagramme de GANTT 1-Introduction au diagramme GANTT 2-Création d'un diagramme GANTT 3 A-GESTION DE PROJET 1-Gestion de projet On appelle projet l'ensemble des actions à entreprendre afin de répondre à un besoin défini dans des délais fixés. Ainsi un projet étant une action temporaire avec un début et une fin, mobilisant des ressources identifiées (humaines et matérielles) durant sa réalisation, celui-ci possède également un coût et fait donc l'objet d'une budgétisation de moyens et d'un bilan indépendant de celui de l'entreprise. On appelle «livrables» les résultats attendus du projet. La difficulté dans la conduite du projet réside en grande partie dans la multiplicité des acteurs qu'il mobilise. En effet, contrairement aux projets personnels ou aux projets internes à faible envergure pour lesquels le besoin et la réponse à ce besoin peuvent être réalisés par la même personne ou par un nombre limité d'intervenants, dans un projet au sens professionnel du terme, l'expression du besoin et la satisfaction de ce besoin sont portés par des acteurs généralement distincts. De cette manière, il est nécessaire de s'assurer tout au long du projet, que le produit en cours de réalisation correspond clairement aux attentes du «client». Par opposition au modèle commerçant traditionnel («vendeur / acheteur») où un client achète un produit déjà réalisé afin de satisfaire un besoin, le projet vise à produire une création originale répondant à un besoin spécifique qu'il convient d'exprimer de manière rigoureuse. Cette expression des besoins est d'autant plus difficile que le projet n'a généralement pas d'antériorité au sein de l'entreprise étant donné son caractère novateur. A l'inverse, il est généralement difficile de faire abstraction des solutions existantes et de se concentrer uniquement sur les besoins en termes fonctionnels. 2-Exemples de projet L'informatique a ceci de particulier qu'il est possible de faire développer ou assembler des briques logicielles aussi facilement que le permet l'imagination. Toute la difficulté consiste à identifier correctement les besoins, indépendamment de toute solution technique et de choisir un prestataire ou une équipe de développement interne à l'entreprise pour le réaliser. Les projets les plus couramment mis en place sont les suivants : Intégration d'un progiciel de gestion intégré (ERP) Mise en oeuvre d'un intranet ou d'un extranet Configuration d'un système de gestion de la relation client (CRM) Mise en place d'une démarche de gestion de la connaissance (KM) 4 3- Maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage Maître d'ouvrage On appelle maître d'ouvrage (parfois maîtrise d'ouvrage, notée MOA) l'entité porteuse du besoin, définissant l'objectif du projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet. Le résultat attendu du projet est la réalisation d'un produit, appelé ouvrage. La maîtrise d'ouvrage maîtrise l'idée de base du projet, et représente à ce titre les utilisateurs finaux à qui l'ouvrage est destiné. Ainsi, le maître d'ouvrage est responsable de l'expression fonctionnelle des besoins mais n'a pas forcément les compétences techniques liées à la réalisation de l'ouvrage. Maître d'ouvrage délégué Lorsque le maître d'ouvrage ne possède pas l'expérience métier nécessaire au pilotage du projet, il peut faire appel à une maîtrise d'ouvrage déléguée (dont la gestion de projet est le métier). On parle ainsi d'assistance à maîtrise d'ouvrage (notée AMO). La maîtrise d'ouvrage déléguée (notée parfois MOAd) est chargée de faire l'interface entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage afin d'aider le maître d'ouvrage à définir clairement ses besoins et de vérifier auprès du maître d'oeuvre si l'objectif est techniquement réalisable. La maîtrise d'ouvrage déléguée ne se substitue pas pour autant à la maîtrise d'ouvrage et n'a donc pas de responsabilité directe avec le maître d'oeuvre. Maître d'oeuvre Le maître d'oeuvre (ou maîtrise d'oeuvre, notée MOE) est l'entité retenue par le maître d'ouvrage pour réaliser l'ouvrage, dans les conditions de délais, de qualité et de coût fixées par ce dernier conformément à un contrat. La maîtrise d'oeuvre est donc responsable des choix techniques inhérents à la réalisation de l'ouvrage conformément aux exigences de la maîtrise d'ouvrage. Le maître d'oeuvre a ainsi la responsabilité dans le cadre de sa mission de désigner une personne physique chargée du bon déroulement du projet (on parle généralement de maîtrise du projet), il s'agit du chef de projet. Sous-traitance Pour la réalisation de certaines tâches du projet, lorsqu'il ne possède pas en interne les ressources nécessaires, le maître d'oeuvre peut faire appel à une ou plusieurs entreprises externes, on parle alors de sous-traitance (et chaque entreprise est appelée sous-traitant ou prestataire). Chaque sous-traitant réalise un sous-ensemble du projet directement avec le maître d'oeuvre mais n'a aucune responsabilité directe avec la maîtrise d'ouvrage, même si celle-ci a un " droit de regard " sur sa façon de travailler. 5 Schéma récapitulatif 4-Relations maître d'ouvrage - maître d'oeuvre Distinction des rôles du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage La distinction entre maître d'ouvrage et maître d'oeuvre est essentielle dans le déroulement du projet, car elle permet de distinguer les responsabilités des deux entités. Il convient ainsi de s'assurer que la définition des besoins reste sous l'entière responsabilité de la maîtrise d'ouvrage. En effet, il arrive dans certains cas que la maîtrise d'ouvrage délègue à la maîtrise d'oeuvre des choix d'ordre fonctionnel sous prétexte d'une insuffisance de connaissances techniques (de façon concrète le service informatique d'une organisation prend la main et pilote le projet dès la phase d'expression des besoins). Or seul le maître d'ouvrage est en mesure de connaître le besoin de ses utilisateurs. Une mauvaise connaissance des rôles des deux entités risque ainsi de conduire à des conflits dans lesquels chacun rejette la faute sur l'autre. D'autre part, s'il est vrai que le maître d'oeuvre doit prendre en compte les exigences initiales du maître d'ouvrage, il n'est par contre pas habilité à ajouter de nouvelles fonctionnalités au cours du projet même si cela lui semble opportun. Le maître d'oeuvre est cependant chargé des choix techniques pour peu que ceux-ci répondent fonctionnellement aux exigences de la maîtrise d'ouvrage. Enfin il arrive qu'une maîtrise d'ouvrage estime qu'un produit existant est susceptible de répondre à ses besoins, l'achète, puis se retourne vers la maîtrise d'oeuvre (le service informatique par exemple) pour effectuer des adaptations du produit. La distinction entre maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage est encore plus difficile lorsque les deux entités font partie de la même structure d'entreprise. Dans de pareils cas, il est d'autant plus essentiel de bien définir contractuellement les rôles respectifs des deux entités. Communication entre maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage Pour le bon déroulement du projet, il est nécessaire de définir clairement les rôles de chaque entité et d'identifier au sein de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre un représentant. Un groupe projet associant les chefs de projet de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre, ainsi que de la maîtrise d'ouvrage déléguée éventuel 6 doit ainsi se réunir lorsque cela est nécessaire pour résoudre les conflits liés aux exigences de la maîtrise d'ouvrage ou à la coordination du projet. Enfin, il est essentiel d'établir un plan de formation permettant à la maîtrise d'oeuvre et à la maîtrise d'ouvrage d'avoir un langage commun et de s'entendre sur une méthode de conduite de projet, de conduite d'entretiens ou de réunions, etc. 5-La nécessité d'une méthodologie claire On appelle « gestion de projet » (éventuellement « conduite de projet ») l'organisation méthodologique mise en œuvre pour faire en sorte que l'ouvrage réalisé par le maître d'œuvre réponde aux attentes du maître d'ouvrage et qu'il soit livré dans les conditions de coût et de délai prévus initialement, indépendamment de sa « fabrication ». Pour ce faire, la gestion de projet a pour objectifs d'assurer la coordination des acteurs et des tâches dans un souci d'efficacité et de rentabilité. C'est la raison pour laquelle, un « chef de projet » est nommé au niveau de la maîtrise d'ouvrage afin d'être en relation permanente (en théorie) avec le chef de projet du côté de la maîtrise d'œuvre. En raison de l'ambiguïté évidente que constitue le terme de chef de projet, l'AFNOR préconise qu'un terme alternatif tel que « responsable de projet » soit utilisé de façon préférentielle pour désigner le chef de projet de la maîtrise d'ouvrage. Les termes « chef de projet utilisateur » ou « directeur de projet » sont parfois également employés. Dans le cas de projets importants, le maître d'ouvrage peut nommer une Direction de projet, c'est-à-dire un équipe projet sous la responsabilité du responsable de projet chargée de l'aider dans la gestion du projet, ainsi que dans les décisions stratégiques, politiques et de définition des objectifs. Le uploads/Ingenierie_Lourd/ comment-rediger-un-projet 1 .pdf
Documents similaires







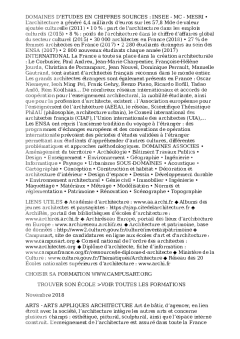


-
60
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 26, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3951MB


