Documents pour l’histoire des techniques Nouvelle série 18 | 2e semestre 2009 L
Documents pour l’histoire des techniques Nouvelle série 18 | 2e semestre 2009 La numérisation du patrimoine technique De l’aide des maquettes virtuelles à la restauration d’un ouvrage d’art historique. Le viaduc de Lambézellec (Brest) Using virtual models for restoring a historical artistic structure. The viaduct of Lambézellec (Brest, France) Stéphane Sire, Dominique Cochou et Jean-François Péron Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/dht/248 DOI : 10.4000/dht.248 ISSN : 1775-4194 Éditeur : Centre d'histoire des techniques et de l'environnement du Cnam (CDHTE-Cnam), Société des élèves du CDHTE-Cnam Édition imprimée Date de publication : 1 décembre 2009 Pagination : 43-49 ISBN : 978-2-9530779-4-0 ISSN : 0417-8726 Référence électronique Stéphane Sire, Dominique Cochou et Jean-François Péron, « De l’aide des maquettes virtuelles à la restauration d’un ouvrage d’art historique. Le viaduc de Lambézellec (Brest) », Documents pour l’histoire des techniques [En ligne], 18 | 2e semestre 2009, mis en ligne le 06 avril 2011, consulté le 08 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/dht/248 ; DOI : https://doi.org/10.4000/dht.248 © Tous droits réservés Documents pour l’histoire des techniques n° 18 - décembre 2009 43 permet de décrire des éléments aujourd’hui cachés ou dégradés par le temps. Ces derniers seront bientôt à nouveau visibles car le viaduc est en passe d’être intégralement restauré. Contexte historique Le viaduc ferroviaire de Lambézelle fut construit entre 1891 et 1893, dans une importante commune située au nord de Brest2. Jouxtant une célèbre brasserie brestoise, la Grande Brasserie de Lambézellec fondée en 1837, il est également connu sous le nom de viaduc de la Brasserie3. 2 Depuis l’ordonnance du 27 avril 1945 qui a fusionné dans le grand Brest, les quatre communes les plus voisines de la Penfeld, Lambézellec n’est plus qu’un vaste quartier de Brest. 3 La brasserie de Lambézellec et celle de Kerinou (autre quartier de Brest) fusionnèrent en 1925 et regroupèrent leurs activités à Lambézellec. Le nom de Grande Brasserie de Kerinou (GBK) fut donné à cette nouvelle entreprise. De l’aide des maquettes virtuelles à la restauration d’un ouvrage d’art historique. Le viaduc de Lambézellec (Brest) Stéphane Sire Université européenne de Bretagne, Université de Brest Laboratoire Brestois de Mécanique et des Systèmes, site UBO (LBMS EA 4325) Dominique Cochou Brest Métropole Océane (BMO), Études Techniques Opérationnelles Jean-François Péron Brest Métropole Océane (BMO), Études Techniques Opérationnelles Résumé La restauration du viaduc de Lambézellec s’appuie sur les résultats de recherches historiques menées sur la conception et la construction de cet ouvrage. Les plans, dessins techniques et explications issus du riche corpus documentaire (entre 1891 et 1893) présent aux archives départementales du Finistère ont en particulier permis de comprendre les choix technologiques adoptés par les ingénieurs, de reconstituer virtuellement ce viaduc pour proposer une description fidèle des différents éléments structuraux qui le constituent et ainsi offrir une aide précieuse aux travaux de réparation. Résumés et mots clés en anglais sont regroupés en fin de volume, accompagnés des mots clés français P armi les nombreux ouvrages d’art historiques brestois (le pont tournant de Brest à Recouvrance (1861- 1944)1, le pont à transbordeur de Ferdinand Arnodin (1909-1947), le pont Albert Louppe conçu par Eugène Freyssinet…) le viaduc ferroviaire de Lambézellec est certainement le plus méconnu. Pourtant, il est toujours en place et est remarquable par sa conception légère et élégante. Il est également unique car il résulte d’une collaboration rapide et efficace entre deux ingénieurs français renommés : Louis Harel de la Noë et Armand Considère. Afin de montrer l’ouvrage tel qu’il était lors de son inauguration, une maquette numérique en trois dimensions restituant les solutions technologiques retenues a été réalisée à partir des dessins d’exécution originaux. En particulier, elle 1 Sylvain Laubé, Stéphane Sire, « Histoire du paysage industriel portuaire de Brest : l’exemple du premier pont tournant de Recouvrance », Premier congrès d’histoire de la construction, Paris, juin 2008, actes révisés à paraître aux éditions Picard. De l'aide des maquettes virtuelles à la restauration d'ouvrage d'art 44 Documents pour l’histoire des techniques n° 18 - décembre 2009 Desservie par la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, la Bretagne a connu un essor très important de son réseau de chemins de fer à la fin du XIXe siècle. Ainsi, dans sa séance du 25 août 1888, le conseil général du Finistère invite le service des Ponts et Chaussées à dresser les avant-projets de quatre lignes d’intérêt local. Le 24 avril 1889, le choix d’une ligne reliant Brest à Ploudalmézeau d’une longueur de 31,382 km avec un viaduc métallique à Lambézellec est retenu parmi cinq projets de tracés reliant ces deux villes. Ces lignes appartiennent aux réseaux secondaires à voies étroites qui sont construits principalement à l’initiative des conseils généraux entre 1880 et 1914 pour désenclaver tous les chefs-lieux de cantons. Sur près de 20 000 km, elles complètent l’ambitieux programme du ministre des Travaux publics Charles de Freycinet. Le 14 février 1891, le Président de la république Sadi Carnot promulgue « la loi ayant pour objet de déclarer d’utilité publique l’établissement, dans le département du Finistère, d’un réseau de chemins de fer d’intérêt local » ; la loi est insérée au Journal Officiel le lendemain. Le viaduc de Lambézellec est un ouvrage d’art métallique très élégant et original dans sa conception. Il est à classer dans la catégorie des « ponts à tréteaux ». Il mesure 109 mètres de long. Composé de sept « jambes » triangulaires espacées de 13,50 mètres, le viaduc franchit le ruisseau du Spernot, minuscule affluent de la Penfeld. Dans la figure 1, on devine le Spernot et l’on découvre quatre des sept piles qui sont les plus hautes du viaduc. Les travaux de construction de ce viaduc sont confiés aux établissements Moisant-Laurent- Savey dirigés par Armand Moisant (1838-1906). Diplômé de l’École Centrale, celui-ci fonde en 1866 les Établissements Moisant, société de construction métallique à Paris, qui devient en 1887 les Établissements Moisant-Laurent-Savey. Cette entreprise a réalisé beaucoup de charpentes métalliques remarquables comme celles du Crédit lyonnais en 1905, de la Société générale en 1912, du nouveau bon Marché en 1920-1924 et de la gare de Lyon à Paris en 1896-18984. Elle participa également à la réalisation de grandes structures comme la nef nord du Grand Palais de 1900 et son escalier d’honneur ainsi que la réalisation d’environ 150 ponts (avant 1935) dont les ponts de Levallois en 1913 et de Gennevilliers en 1913 et 1921. La direction de l’ensemble des travaux est confiée à Louis Harel de la Noë (1852–1931), ingénieur ordinaire de l’arrondissement de l’ouest du service des ponts et chaussées. Il est chargé de la mise en place des réseaux de chemins de fer sous la responsabilité directe 4 Bertrand Lemoine, L’architecture du fer, Éditions Champ Vallon, collection Milieux, 1986. fig. 1 - Le viaduc de Lambézellec sur une carte postale, Archives municipales et communautaires de Brest, doc 3Fi079_133. Documents pour l’histoire des techniques n° 18 - décembre 2009 45 Stéphane Sire, Dominique Cochou et Jean-François Péron Considère polémique avec l’économiste Clément Colson sur les formules économiques d’exploitation de ces lignes et leur rentabilité sociale10. Description des solutions techniques adoptées Parmi plus de trois cents ouvrages construits par Harel de la Noë, une minorité possède une structure entièrement métallique ; les autres ponts et viaducs sont en maçonnerie ou en béton armé11. Le type particulier « en tréteaux » n’a été retenu que sur deux d’entre eux : ce viaduc finistérien ainsi que le viaduc de Déhault dans la Sarthe ; le premier ayant inspiré le deuxième12. Pour franchir la dépression de la vallée du Spernot, le viaduc de Lambézellec comporte ainsi sept piles métalliques constituées de deux jambes elles-mêmes triangulaires, dont l’écartement maximal atteint 12 mètres sur la palée la plus haute (17 mètres). Espacées de 13,50 mètres, elles supportent un tablier métallique composé de deux poutres maîtresses distantes de 2 m, hautes de 0,90 mètre sur lesquelles reposent des semelles de 200 millimètres de large13. Des voûtains en brique supportent le ballast, les traverses et la voie ferrée. Le viaduc est long de 109,20 mètres et large de 3,60 mètres ; les sept piles ont des hauteurs variant de 5 mètres pour celle du côté de Brest jusqu’à 17 mètres. La carte postale présentant le viaduc (fig. 1) nous montre la géométrie très originale de ces piles. Au niveau de la culée du côté de Ploudalmézeau, le tablier est encastré dans la roche. Du côté de Brest, le tablier repose sur des rouleaux cylindriques pour permettre sa dilatation lorsqu’il y a une variation de température. Ceux-ci permettent ainsi d’éviter des contraintes mécaniques intolérables pour l’ensemble de la structure. Chaque pile est également liée au tablier et aux dés en maçonnerie par l’intermédiaire de deux articulations, ce qui des Ponts et Chaussées, 2003. 10 François Caron, « Les réseaux et les politiques d’amé- nagement du territoire : l’exemple des chemins de fer », dans Patrice Caro, Olivier Dard et Jean-Claude Daumas dir., La politique d’aménagement du territoire : racines, logiques et résultat, collection Espace et territoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, pp. 17-29 ; id. Histoire des chemins de fer en France, uploads/Ingenierie_Lourd/ dht-248.pdf
Documents similaires

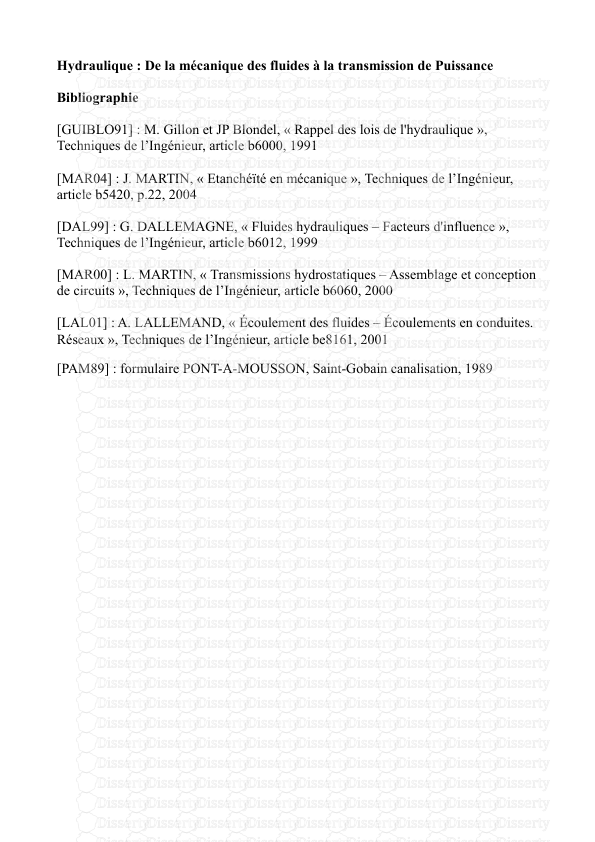








-
44
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 01, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 1.7288MB


