Faculté des Lettres et Sciences Humaines DOCTORAT ARTS, LETTRES ET LANGUES Ment
Faculté des Lettres et Sciences Humaines DOCTORAT ARTS, LETTRES ET LANGUES Mention : « Arts, Lettres et Civilisation » Spécialité : « Langues, Littératures interculturelles et Éthique du Divers Parcours : « Lettres Modernes et Littératures comparées » N° attribué par la Bibliothèque Universitaire : DES ÉCRITURES DU MOI DANS LE CHAMP LITTÉRAIRE CARIBÉEN FRANCOPHONE CONTEMPORAIN : ENTRE EMPÊCHEMENTS ET DÉTOURS DE L’AUTOBIOGRAPHIE ? THÈSE DE DOCTORAT Présentée et soutenue Par Thérésa THÉRÉSINE-AUGUSTINE Sous la direction du Professeur Roger TOUMSON Jury : Daniel-Henri PAGEAUX, P.U.-émérite, Président, Rapporteur, Université, Paris 3 Sorbonne Olga Hel-Bongo, P.U., Rapporteur, Université de Laval (Canada) Charles SCHEEL, P.U. Université des Antilles Laura CASSIN, M.C.F. Université des Antilles Roger TOUMSON, P.U.-émérite, (invité) Université des Antilles LABORATOIRE D’ACCUEIL : Centre de Recherches Interdisciplinaires en Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines (CRILLASH : EA 4095…) Année universitaire 2019-2020 2 3 Faculté des Lettres et Sciences Humaines DOCTORAT ARTS, LETTRES ET LANGUES Mention : « Arts, Lettres et Civilisation » Spécialité : « Langues, Littératures interculturelles et Éthique du Divers Parcours : « Lettres Modernes et Littératures comparées » N° attribué par la Bibliothèque Universitaire : DES ÉCRITURES DU MOI DANS LE CHAMP LITTÉRAIRE CARIBÉEN FRANCOPHONE CONTEMPORAIN : ENTRE EMPÊCHEMENTS ET DÉTOURS DE L’AUTOBIOGRAPHIE ? THÈSE DE DOCTORAT Présentée et soutenue Par Thérésa THÉRÉSINE-AUGUSTINE Sous la direction du Professeur Roger TOUMSON Jury : Daniel-Henri PAGEAUX, P.U.-émérite, Président, Rapporteur, Université, Paris 3 Sorbonne Olga Hel-Bongo, P.U., Rapporteur, Université de Laval (Canada) Charles SCHEEL, P.U. Université des Antilles Laura CASSIN, M.C.F. Université des Antilles Roger TOUMSON, P.U.-émérite, (invité) Université des Antilles LABORATOIRE D’ACCUEIL : Centre de Recherches Interdisciplinaires en Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines (CRILLASH : EA 4095…) Année universitaire 2019-2020 4 Avant-propos Après m’être surtout intéressée aux personnages des œuvres du corpus dans mes mémoires de recherche de Master 1 et 2 de Lettres modernes dont les titres sont respectivement : « Images d’africaines dans Une si longue lettre de Mariama Bâ et Tu t’appelleras Tanga de Calixthe Beyala » et « De l’histoire au mythe : les figures de "Chakaʺ chez Mofolo et Senghor » ; j’ai voulu préparer une thèse doctorale où l’auteur occuperait une place de choix. C’est donc naturellement que je me suis orientée vers l’écriture autobiographique. Se sont alors posés les problèmes du choix du corpus et de l’espace géographique circonscrit. Si mes précédentes recherches ont porté sur le continent africain qui regorge d’écrivains autobiographiques tels que Camara Laye, Assia Djebar, Wole Soyinka – pour ne citer qu’eux –, j’ai voulu dans ce présent cadre travailler autour d’un corpus dont les écrivains sont issus d’un milieu géographique auquel j’appartiens. C’est ainsi que ma décision s’est finalement arrêtée sur un où sont réunis divers écrivains de la Caraïbe francophone. De plus, il m’a semblé pertinent de découvrir les enjeux de ces écritures autobiographiques d’écrivains contemporains, finalement peu lus du lectorat de la Caraïbe ; et de les confronter à l’horizon d’attente de spécialistes du genre, comme Philippe Lejeune, qui se retrouve volontiers dans les autobiographies d’écrivains français tels que Jean-Jacques Rousseau, Jean- Paul Sartre, Simone De Beauvoir, Hervé Bazin, Annie Ernaux, etc. La constitution du corpus n’a pas été aisée. En réalité, malgré le nombre important d’œuvres à l’étude (douze en tout), il ne prend en compte que sept écrivains qui ont été retenus pour aborder les écritures du Moi en Martinique, Guadeloupe et Haïti. Un tri d’auteurs majeurs, mais aussi d’auteurs mineurs, mal connus et méconnus, qu’il a fallu mettre à l’honneur. La réception critique peu abondante, l’exercice du métier de professeur de lettres en même temps que la veille scientifique et la rédaction de la thèse ont été de sérieuses embûches, d’autant que j’ai surtout été formée à la littérature française et étrangère et que je suis peu familière de la littérature franco et anglo-caribéenne. Cependant, piquée de la curiosité du chercheur sur le regard que porte l’écrivain caribéen sur sa propre vie, dans un espace dont je connais les contours, cette recherche m’a fascinée. La méthode privilégiée a consisté à comparer les œuvres entre elles, eu égard aux exigences à la fois structurelles et sur le fond que requiert l’entreprise scripturale d’un genre qui a le vent en poupe. 5 REMERCIEMENTS La présente recherche n’aurait pas trouvé un aboutissement final sans le concours de mon Directeur de recherches, M. le Professeur Roger Toumson, qui a bien voulu m’encadrer dans cette aventure, ainsi que M. Max Bélaise (MCF). Le Crillash, et singulièrement, son ancienne directrice, Madame le professeur Corinne Mencé- Caster, de même que Monsieur le professeur Raphaël Confiant pour sa relecture. Je tiens également à remercier la Région Martinique (CTM depuis), pour l’aide financière octroyée durant trois années. Je ne saurais oublier enfin, beaucoup trop nombreux à citer, tous ceux qui m’ont toujours encouragée. Un grand merci à mes parents et à mes frères. 6 À mes parents À mes frères 7 C’est toujours idiot de raconter ses souvenirs. Ils prennent leur autonomie, nous échappent, nous reviennent, avec cette façon qu’ont les choses rebelles de ne pas demander notre avis avant de se manifester. Et puis, parler, raconter, c’est toujours cacher quelque chose. Le récit est le territoire même de l’évitement. Pendant que vous me racontez une histoire, d’autres se déroulent qui mériteraient tout aussi bien d’être contées. Qui en moi décide de ce dont je me souviens ? Et pourquoi ai-je choisi l’oubli de tel visage ou de tel événement ? Peut-être, n’ai-je livré que les choses avec lesquelles il m’est permis de vivre en cachant celles qui me hantent vraiment ?1 – L. Trouillot, Objectif : l’autre. 1 L. Trouillot, Objectif : l’autre, Bruxelles, André Versaille éditeur, 2012, p. 207. 8 RÉSUMÉ Depuis quelques décennies, nous assistons dans le champ littéraire caribéen francophone à la prolifération d’écrits dans lesquels les écrivains font le récit de leur propre vie. Ces récits que nous pourrions répertorier dans les « écritures du moi » semblent fortement marqués de l’empreinte autobiographique. Pourtant, au regard des travaux réalisés par Philippe Lejeune et Georges Gusdorf sur le genre, ces œuvres, pétries de traces autobiographiques, semblent en contourner les canons. Notre recherche consiste donc à nous interroger sur ce qui pourrait empêcher la classification de ces récits comme des autobiographies, au sens strict du terme. Nous émettons l’hypothèse d’un détournement des règles propres au genre inhérent au « moi empêché » de l’auteur, ou bien à l’affirmation d’un polymorphisme du genre (en contexte caribéen francophone). L’autobiographie serait-elle purement occidentale ? En nous appuyant sur un corpus d’une douzaine d’œuvres, dont les écrivains sont issus de la Caraïbe francophone (Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant pour la Martinique ; Maryse Condé, Henri Corbin, Daniel Maximin pour la Guadeloupe ; Jan-J. Dominique et Émile Ollivier pour Haïti), nous tenterons de répondre à cette problématique. Mots-clés : Autobiographie – Littérature caribéenne – Empêchement du Moi– Sujet émergent. ABSTRACT WRITING ABOUT SELF IN CONTEMPORARY FRANCOPHONIC CARIBBEAN LITERATURE. A complex approach of autobiography Since recent decades, we are seeing a proliferation of papers in the French Caribbean literature in which writers talk about themselves, the story of their own life. These narratives which could be list as “writings of myself” seem strongly marked with autobiographical imprint. Nevertheless, according to the works of Philippe Lejeune and Georges Gusdorf about the genre, these works molded by autobiographical tracks seem to stretch the rules. This present research deals with wondering about what could prevent the classification of these narratives as real autobiographies, in the strict sense of the word. We emit the hypothesis of a diversion of rules appropriate to the inherent genre in the “self-restraint” of the author, either in the assertion of a polymorphism of the genre (in the French-speaking Caribbean context) Is the autobiography a pure European genre? Basing on a corpus of a dozen of works, writers who arise from the French-Speaking Caribbean (Patrick Chamoiseau and Raphaël Confiant for Martinica; Maryse Condé, Henri Corbin and Daniel Maximin for Guadeloupe; J.-J. Dominique and Emile Ollivier for Haïti), we shall try to answer this problematic. Key- words: Autobiography – Caribbean literature – Self-restraint – Emergent subject. 9 Campus de Schœlcher BP 7207 97275 Schœlcher 10 SOMMAIRE AVANT-PROPOS ........................................................................................................................................... 4 REMERCIEMENTS ...................................................................................................................................... 5 RÉSUMÉ ........................................................................................................................................................ 8 INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 11 PREMIÈRE PARTIE : STATUT PROBLÉMATIQUE DE L’AUTOBIOGRAPHIE DANS LE ROMAN CARIBÉEN FRANCOPHONE CONTEMPORAIN .................................................................................. 31 A. DE L’AUTOBIOGRAPHIE ET DE SON EFFACEMENT DANS LA LITTÉRATURE ANTILLAISE .... 34 I. QU’EST-CE-QUE L’AUTOBIOGRAPHIE ? ............................................................................................ 34 II. LES FONCTIONS DE CE TYPE LITTÉRAIRE ? .................................................................................... 51 III. LES LIMITES ......................................................................................................................................... 55 IV. ESSOR DE L’AUTOBIOGRAPHIE DANS LE ROMAN/LA LITTÉRATURE FRANÇAIS(E) DES XXe ET XXIe SIÈCLES REVUE DE LA LITTÉRATURE .......................................................................................... 61 V. ABSENCE DE L’AUTOBIOGRAPHIE DANS LE ROMAN CARIBÉEN FRANCOPHONE CONTEMPORAIN ....................................................................................................................................... 77 B. PRÉSENTATION DU CORPUS : INDICES D’UNE DIMENSION AUTOBIOGRAPHIQUE ............... 107 I. PRÉSENTATION DU CORPUS ............................................................................................................. 107 II. TYPOLOGIE DES ASPECTS AUTOBIOGRAPHIQUES ...................................................................... 133 III. DE L’AUTOBIOGRAPHIE ET DU ROMAN AUTOBIOGRAPHIQUE ANTILLAIS ........................... 158 DEUXIÈME PARTIE : DES ÉCRITURES DU MOI EN ESPACE CREOLE ........................................... 166 A. TRACES AUTOBIOGRAPHIQUES ........................................................................................................ 170 I. PRÉSENCE D’UN PACTE AUTOBIOGRAPHIQUE uploads/Litterature/ thesetheresaaugustine-pdf 1 .pdf
Documents similaires



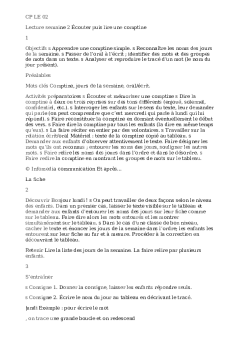






-
55
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 20, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 4.9861MB


