1 P. SAINTYVES ------------ LES SAINTS SUCCESSEURS DES DIEUX I.- L’ORIGINE DU C
1 P. SAINTYVES ------------ LES SAINTS SUCCESSEURS DES DIEUX I.- L’ORIGINE DU CULTE DES SAINTS II. Ŕ LES SOURCES DES LEGENDES HAGIOGRAPHIQUES III. Ŕ LA MYTHOLOGIE DES NOMS PROPRES -------------------------------- 2 ESSAIS DE MYTHOLOGIE CHRETIENNE P. SAINTYVES LES SAINTS SUCCESSEURS DES DIEUX * Les hommes ne reçoivent des idées nouvelles qu’autant qu’elles sont en rapport avec celles qu’ils ont déjà. De Bonstetten, Voyage dans le Latium, page 182. I - L’origine du culte des saints II. Ŕ Les sources des Légendes hagiographiques III. Ŕ La mythologie des noms propres 3 PREFACE Avez-vous lu le livre récent de Dom Cabrol, abbé de Saint-Michel, sur « Les origines liturgiques » ? Ŕ C’est un livre agréable et dont vous vous rappelez sans doute ce début de chapitre : « Dès l’abord, écrit-il, nous nous trouvons en face d’une objection : le culte catholique ne vient pas de Jésus. Jésus n’avait pas de liturgie, il était ennemi des formules vides, des pratiques extérieures ; il voulait un culte intime, celui du cœur, c’était le culte libre du Père, qui consiste dans la soumission filiale à Dieu, dans l’amour, la confiance ; il rejette les rites extérieurs ; il veut une religion sans prêtres et sans autels, et il n’admet d’autre temple que l’âme. « La liturgie catholique, continue le Révérend Père, ne vient donc pas de Jésus ; il en faut chercher les origines dans le gnosticisme, et même en dernière analyse dans le paganisme, auquel le gnosticisme servit de pont, et qui ne fut un moment vaincu par le christianisme que pour prendre une éclatante revanche au IVème siècle. Si le paganisme fut baptisé dans la personne des empereurs, ne nous hâtons pas d’applaudir. En recevant les eaux du baptême, il les contamina, il y laissa son virus, et le culte des idoles fleurit de plus belle sous couleur de culte des saints, de culte des martyrs. Toute cette splendeur dont le culte fut entouré au IVème siècle est un paganisme liturgique. « Telle est l’objection renouvelée du protestantisme du XVIème siècle, qui partit en guerre contre la Babylone du Papisme, ses superstitions, son idolâtrie ; objection qui a pris en quelque sorte sa forme scientifique dans les ouvrages de Renan1, de Harnack2, de Sabatier, et de tous ceux qui s’en inspirent. « Voyons ce qu’il faut penser de cette thèse, ajoute le savant abbé. Est-ce que vraiment nous serions païens sans nous en douter ? Est-ce qu’en invoquant la sainte Vierge, ou les saints, en prenant de l’eau bénite, en recevant l’onction, en allumant nos cierges sur l’autel du vrai Dieu, nous ne serions que de grossiers adorateurs de Pallas Athéné, de la Magna Mater, de Jupiter Optimus Maximus ? Avouez que la situation serait piquante. Nous croyons avoir pour les martyrs morts au service du Christ, un culte sincère et délicat, et au fond ces martyrs, s’ils sortaient de leurs châsses dorées, maudiraient en nous des idolâtres, tout juste aussi intéressants que ceux qui les ont condamnés au chevalet. « La question vaut la peine d’être examinée de près, ne pensez-vous pas ? » C’est en effet ce que bien d’autres et nous-même avons pensé. Cet ouvrage est tout d’abord un essai de réponse à cette question. Le culte des saints est-il d’origine païenne ? 1 Renan, Origines du christianisme, t. VI, p. 154 et suiv. et p. 181 ; t. VII, p. 142 et suiv. ; et p. 540 et suiv. ; t. VIII, p. 127 et suiv. 2 Harnack, Das Wesen des Christentum, 1900, p. 130. 4 C’est l’objet de notre première partie. Grâce à la comparaison des formes diverses du culte populaire et de sa liturgie officielle avec celles du culte des héros, grâce surtout à l’étude des liens historiques qui relient le culte des martyrs au culte des morts ou des mânes, on a pu répondre nettement et sans crainte d’erreur : le culte des martyrs et des saints est d’origine païenne3. Dans la deuxième partie qui traite « Des sources des légendes hagiographiques » nous semblons nous écarter de notre sujet. Ce n’est pourtant point sans motifs que nous avons cru devoir exposer longuement la façon dont on écrivait la vie d’un saint jusqu’aux temps modernes, quelles furent la valeur et la nature des documents qui y entraient. Il apparaît, et de savants religieux l’avaient déjà surabondamment démontré, que fort souvent l’histoire des saints est incertaine et se sert de matériaux de toutes origines. Après cet exposé, on est préparé à rencontrer des fragments de l’histoire fabuleuse des dieux dans la légende des saints et le lecteur est défendu contre les surprises du sujet véritable de cet ouvrage : « les saints successeurs des dieux ». Cette troisième partie est une étude de mythologie proprement dite et présentait de ce chef des difficultés particulières. La mythologie comparée est une des sciences conjecturales dont parlait Renan. Elle est loin d’être arrivée à la plénitude de son développement et demande à ceux qui l’abordent une part d’initiative et un esprit de méthode que nul ne saurait se flatter de posséder. Lorsque la mythologie entra dans la voie scientifique, on crut qu’elle n’était qu’une branche de la philologie et que les évolutions des noms divins expliquaient toutes les créations mythologiques. Ce temps n’est plus. Depuis Clermont Ganneau et Robertson Smith, on accorde que les images et les rites, à l’instar des noms propres, ont été les facteurs essentiels de ces formations divines. En conséquence, cette troisième partie a été divisée en trois livres : La mythologie des noms propres, où nous étudions les saints qui se rattachent par leurs noms, sans préjudice des autres liens, aux dieux du paganisme. Dans La mythologie des images, nous passerons en revue les images païennes qui influèrent sur le culte chrétien et donnèrent naissance à des saints. Enfin avec La mythologie des rites, nous examinerons les rites païens qui se perpétuèrent dans le culte des saints, et provoquèrent les développements de certaines légendes hagiographiques. Ces deux derniers livres formeront la matière d’un prochain volume. L’étude des cas individuels de cultes hagiographiques, l’éploiement de notre galerie de saints successeurs des dieux n’est qu’une vaste vérification de notre thèse générale : le culte des saints est d’origine païenne. 3 On remarquera toutefois que nous sommes loin de croire qu’il faille limiter l’influence païenne à l’influence gnostique ou plus exactement qu’elle n’ait agi que par l’intermédiaire du gnosticisme. On aurait tort de croire, malgré ce qu’en pense Dom Cabrol, que des esprits comme Renan, Harnack, Sabatier s’en soient tenus à une vue aussi étroite. 5 Certes, nous nous écartons quelquefois de l’optimisme de Dom Cabrol4 et de maints auteurs catholiques. Mais on ne pourra nous faire le reproche qu’il adresse à Renan : d’avoir conclu de simples analogies et de simples rapprochements à un emprunt et à une superstition. Dans nos études sur sainte Marguerite, saint Hippolyte, saint Ménas et tant d’autres, ou sur les origines de telle grande fête comme la Toussaint, nous nous sommes efforcé de montrer le lien historique étroit et fort qui rattache le culte des saints au culte des dieux. Sans doute on peut, avec Dom Cabrol, s’approprier l’argumentation de M. Loisy et dire : « Supposé que l’on puisse démontrer l’origine païenne d’un certain nombre de rites chrétiens, ces rites ont cessé d’être païens lorsqu’ils ont été acceptés et interprétés par l’Église5 ». C’est fort bien : mais c’est là précisément une des ressources apologétiques que ce grand esprit fécond en points de vue profonds et ingénieux avait proposées aux catholiques afin de pouvoir sauver la foi, j’allais dire la face, lorsqu’il serait reconnu que l’histoire concluait presque partout à l’inverse des défenseurs des opinions traditionnelles. En supposant que nous ayons démontré l’origine païenne du culte des saints, nous ne prétendons point avoir prouvé qu’il n’est pas chrétien ; mais modestement que ses sources roulaient sous des flots païens. 4 « Si je ne me trompe, écrit le R. P., les faits de ce genre qu’on a relevés ne tiennent pas à l’essence de la liturgie, ou seulement à ses parties vitales. Il les faut chercher sur les frontières. Ainsi on cite des fêtes païennes devenues chrétiennes, des temples païens consacrés au culte du vrai Dieu, des fontaines, des statues de dieux baptisés et devenant des patrons chrétiens ». Loc. cit. pp. 65, 66. 5 Loisy, L’Évangile et l’Église, p. 186. Ŕ F. Cabrol, Les origines liturgiques, 1906, p. 65. 6 INTRODUCTION La rencontre des dieux. Les religions païennes du monde antique, avant de mourir sous les coups des missionnaires évangéliques, eurent souvent l’occasion de se confronter entre elles. Le commerce, les voyages, la guerre, la science, les arts furent autant de raisons de contact. La rencontre fut chaque fois fertile en résultats inattendus ; mais les plus pittoresques furent sans contredit provoqués par les migrations des dieux. « À mesure qu’il s’établissait entre les peuples de nouveaux liens, ils se communiquaient mutuellement leurs divinités : le Grec qui avait apporté en Égypte les dieux de son pays rapportait uploads/Religion/ les-saints.pdf
Documents similaires
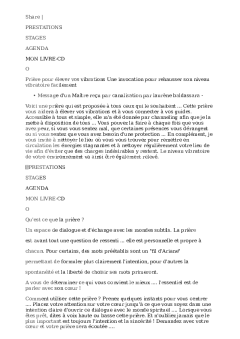









-
85
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 19, 2021
- Catégorie Religion
- Langue French
- Taille du fichier 2.5196MB


