Leçon 30. De l’expérience à l’expérimentation Un des traits dominants du savoir
Leçon 30. De l’expérience à l’expérimentation Un des traits dominants du savoir scientifique actuel, c'est l’idée selon laquelle la science porte sur des faits, se fonde sur des observations : en un mot s’appuie sur l’expérience et non pas sur de simples spéculations en l’air. Une théorie n’est scientifique, que si elle se prête à une vérification par l’expérience. Toute la question est de savoir quel sens exact donner à ce mot expérience. Dans la vie concrète, nous disons avoir été soumis à des expériences, ce qui signifie avoir été confronté quelque peu malgré nous, à la réalité. On subit l’expérience, on l’éprouve et quelquefois on en tire des leçons. A l’inverse, l’expérience scientifique n’est en rien « subie ». Elle ne se produit pas au hasard, comme pour les rencontres ou les accidents de la vie ; elle résulte d’un protocole, elle est organisée intentionnellement, préparée soigneusement. Une expérience scientifique ne tombe pas du ciel comme une sorte de révélation. Elle n’est pas de l’ordre du miracle qu’attend l’enfant « qui fait des expériences » en mélangeant toutes sortes de substance dans un tube à essai ! Qu’est-ce que faire une expérience ? L’expérience, est-elle essentiellement une sorte d’épreuve de la sensibilité, une épreuve de soi dans le temps qui structure le vécu conscient ? Ou bien, n’est elle pas plutôt une invention libre de l’esprit ? Dans l’expression « faire une expérience », à qui revient le « faire » ? A une « réalité extérieure » à laquelle nous serions confronté ou à une initiative de l’intellect, tentant d’exercer son contrôle sur la réalité ? * * * A. Le champ de l’expérience Partons de l’ordre de l’expérience empirique, celle-là même qui nous fait dire, que certains hommes « possèdent une grande expérience » et que d’autres n’ont « pas encore assez d’expérience ». L’expérience a ici deux valeurs. (texte) Elle désigne d’abord une pratique routinière bien maîtrisée. L’apprenti boulanger n’a pas l’expérience de son patron. Avec le temps, il va finir par la gagner. Toute pratique répétée en ce sens confère une expérience. Avec le temps et le travail, l’apprenti va, dit-on, gagner de l’expérience. L’expérience peut désigner aussi une diversité et une richesse du vécu qui vient de découvertes, de rencontres, d’aventures. C’est ce qui fait dire de l’un ou de l’autre qu’il « a beaucoup vécu ». Nous nous représentons dans les deux cas l’expérience comme le résultat, déposé en nous par la perception et la pratique, d’un contact avec le monde. Celui qui a beaucoup d’expérience, a éprouvé ce contact de la réalité pendant longtemps, avantage que n’aura pas le plus jeune. Il est remarquable que le sens commun attribue une grande valeur à cette acquisition passive, souvent répétitive et routinière. S’il est une croyance bien reçue dans l'opinion commune, c’est bien que l’on « tire des leçons de l’expérience », rien qu’en la vivant ; ce qui sous-entend que l’expérience enseignerait d’elle-même quelque chose ou qu’il suffirait en quelque sorte de « sentir » pour apprendre. Ce qui est loin d’être évident. Nous donnerons un nom au savoir tiré de la simple pratique, celui de savoir empirique. C’est ainsi que l’on dit vouloir enseigner « sur le tas », en plaçant l’apprenti devant la machine, en ne lui donnant que le minimum d’explications théoriques, pour que l’expérience fasse son oeuvre et qu’il apprenne son métier en l’exerçant. C’est au nom de ce privilège de l’expérience que l’on critique l’instruction scolaire qui, soi-disant, n’apprend rien aux jeunes du monde du travail. (texte) Il y a bien des confusions dans cette interprétation de l’expérience. Il est d’abord faux de prétendre que l’expérience en général enseigne quoi que ce soit. Ce qui peut-être enseigné, ce n’est pas seulement ce qui est acquis, c’est surtout ce qui est susceptible d’être compris. Sans la vertu de la compréhension, l’expérience n’apprend rigoureusement rien, elle n’est qu’un simple constat qui ne fait que consigner des faits, ou pire, elle est une forme de conditionnement. Pour qu’il y ait connaissance au sens profond du terme, il faut qu’à l’expérience se joigne la compréhension. On peut fort bien, dans l’expérience de la vie, répéter les mêmes erreurs indéfiniment, sans jamais en tirer des leçons, parce que l’intelligence n’aura pas accédé à une compréhension de l’expérience elle-même. Inversement, la compréhension directe, lucide et profonde, peut précéder toute expérience et peut nous permettre de faire l’économie d’expériences inutiles ou aliénantes. Il n’est pas nécessaire de faire l’expérience de la drogue pour comprendre qu’elle est une déstructuration de la personnalité, pour comprendre en quoi elle conduit à une autodestruction. Un esprit intelligent peut transcender la nécessité de passer par des expériences, pour entrer directement dans la compréhension. La prétendue « sagesse » que l’on prête aux « hommes d’expérience » en réalité ne vient pas vraiment de l’expérience, mais de l'intelligence, car seule l’intelligence donne la maturité de vue qu’on leur prête. Aussi ne devons-nous pas nous méprendre sur la portée du savoir empirique. Ce qui résulte de la seule répétition et de l’habitude n’est pas intelligent, donc n’instruit pas vraiment, mais conditionne. On gagne certes de cette manière une habileté pratique, mais pas encore une connaissance, s’il ne s’y ajoute la dimension de la compréhension intellectuelle. Platon fait ainsi la distinction entre le savoir empirique et la science. C’est ce qui sépare par exemple le http://sergecar.club.fr/cours/theorie1.htm rebouteux des campagnes, adroit pour remettre en place des articulations et le médecin dûment formé. Aller lire dans le grand livre du monde a de l’intérêt quand on a été trop confiné dans l’étude, comme une saine contrepartie. Mais cela n’a rien de nécessaire. L’intelligence de ce qui est, est ouverte à un esprit lucide. Mais il y plus important encore. Nous on ne peut pas réduire l’expérience à la seule forme de l’empirisme. L’expérience est un domaine très varié et complexe. Elle ne se ramène pas à des observations répétitives et à une expérience des « choses » du monde. a) Dans l’expérience sociale l’expérience de la rencontre d’autrui ne veut pas dire : « expérimenter sur quelque chose ». Je suis beaucoup plus passif effectivement dans ce type d’expérience et la relation de dualité avec l’autre peut aboutir à un conflit qui n’est pas dans la structure de l’expérience sensible. C’est à l’égard d’autrui que la provocation de l’expérience est ma plus vive. J’ai beaucoup à apprendre de la vie en relation. Ce n’est plus seulement ma sensibilité, c’est mon affectivité qui est mise en scène, mon sens des valeurs et du respect de l’autre, mon sens de l’humain. b) L’expérience éthique qui me confronte au souci du bien et du mal est aussi très différente. Elle donne à l’expression « faire une expérience » un sens très original. Dans un cas de conscience par exemple, je fais une expérience qui a une valeur pathétique qui ne se rencontre nulle part ailleurs. Le bien et le mal ne sont pas les objets de l’expérience objective, ce ne sont pas des choses que l’on puisse manipuler à son gré. La compassion devant la souffrance n’a pas du même ordre que l’habileté d’une manipulation technique. c) L’expérience esthétique ne consiste pas non plus dans une « manipulation objective », mais dans une épreuve sensible devant la beauté. Elle suppose que celui qui fait l’expérience s’y abandonne entièrement. On ne goûte une musique que si on se laisse charmer par sa mélodie. d) L’expérience spirituelle est encore d’un ordre différent, elle est soit expérience métaphysique, soit expérience mystique. Dans les deux cas, ce qui s’y manifeste, c’est la révélation d’une idée, avec toute sa force de certitude. Là encore, l’élément de pathétique est essentiel, car il faut que l’esprit s’ouvre au réel pour que se produise la donation de sens du réel. Il est clair que l’expression « faire une expérience », n’a pas seulement le sens d’une expérimentation. Il est aussi abusif de ne regarder l’expérience sous l’angle de son interprétation empiriste. C'est un angle beaucoup trop réduit, à comparaison de la richesse et de la diversité de l'expérience humaine. B. L’idée d’expérimentation scientifique Ce que nous avons en vue dans l’idée d’expérience scientifique s’éloigne considérablement de ce que nous venons d’analyser. La distinction entre les deux ordres est celle de l’opposition subjectivité/objectivité. Par expérience scientifique on entend une méthode mise en oeuvre dans les sciences. Le mot expérience est alors employé dans un sens presque opposé au sens de l’expérience courante. Il signifie non pas une passivité, mais l’activité de l’esprit consistant à tester une hypothèse, ou à faire un essai. Les sciences de la Nature reposent sur des protocoles d’expérimentation. L’esprit n’est pas alors béat devant la Nature ou passif, mais il la questionne, afin de vérifier le bien fondé d’une explication qu’il avance de lui-même. A l’expérience brute de l’empirisme, des conditions de la vie ordinaire, se substitue donc l’expérience réglée, qui met en place une série de dispositifs, pour vérifier une explication. Ici, rien n’est découvert qui n’ait été pensé et posé dès uploads/Science et Technologie/ de-l-x27-experience-a-l-x27-experimentation.pdf
Documents similaires



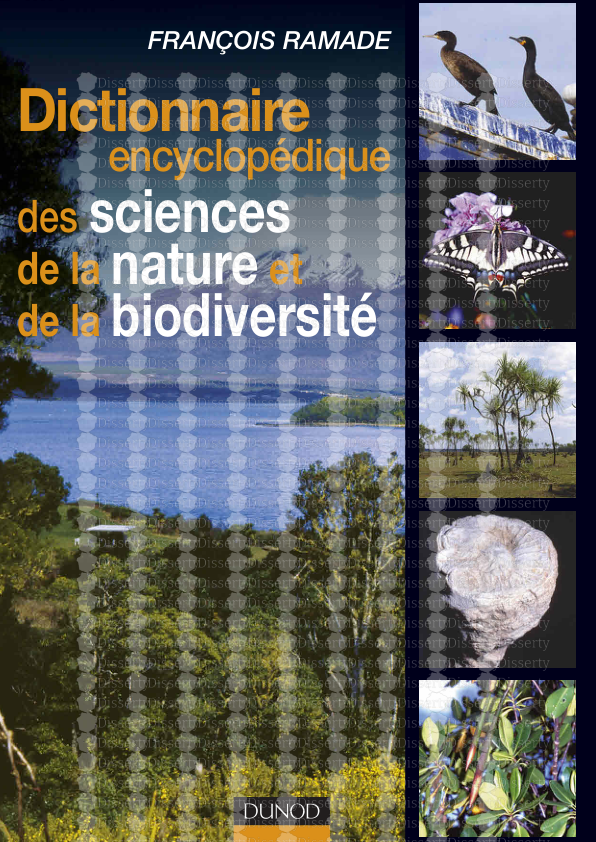






-
105
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 23, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.8910MB


