1 Dr Philippe NGUEMETA Université de Yaoundé I Faculté des Arts, Lettres et Sci
1 Dr Philippe NGUEMETA Université de Yaoundé I Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines Département de Philosophie DESCRIPTIF DE L’UE 212 INTITULEE : EPISTEMOLOGIE L’objectif pédagogique de ce cours est d’amener les étudiants à réfléchir sur les fondements des connaissances scientifiques, la différence entre la connaissance scientifique et la connaissance vulgaire. Si on admet que l’une des principales caractéristiques de la connaissance scientifique, c’est la systématisation, puisqu'elle consiste en une connaissance ordonnée, abstraite à partir du principe de la vérifiabilité, il s’agit, dans le cadre de ce cours d’inviter les étudiants à étudier la science de l’intérieur et de l’extérieur : la connaissance scientifique est collective, elle devient savoir parce qu’elle communique la connaissance et la donne en partage. Plus fondamentalement, le savoir scientifique repose également sur les caractéristiques telles que la rationalité, l'objectivité, la factualité, l’expérimentabilité et la communicabilité. Il en résulte que certaines idées ou théories doivent être vérifiées et prouvées du point de vue de la science avant qu'une connaissance puisse faire partie de la connaissance scientifique. Seulement, malgré la volonté de décrire la nature comme totalité des phénomènes déterminés par des lois à l’époque moderne, la science n’est pas parvenue à livrer tous les secrets de l’univers. Elle se rapproche de la vérité mais jamais de la certitude car les connaissances scientifiques sont faillibles, ce qui signifie qu'elles ne sont pas définitives. Ainsi si l’activité scientifique ne permet pas de prévoir totalement un phénomène déterminé, il se pose le problème de sa nature. Mais qu’est-ce que la science ? Comment fonctionne-t-elle ? Procédés pédagogiques Pour atteindre cet objectif, nous allons commencer par définir la science. Nous pensons qu’elle est un ensemble de connaissances plus ou moins ordonnées, transmissibles par un enseignement. L’enjeu est d’établir par la suite la démarcation entre la connaissance scientifique et la connaissance vulgaire. Cette approche nous conduit à concevoir la notion même des actes épistémologiques, des actes de rupture, de construction et de constatation où 2 les contextes de découverte et de justification dans la pratique scientifique. Nous allons ensuite exposer le « constructivisme épistémologique » de l’épistémologue Gaston Bachelard. Sa conception scientifique construit son objet et soutient une approche dynamique ou évolutive de la science telle qu’on a l’expérience dans La formation de l’esprit scientifique, Paris, Alcan, 1934. C’est aussi ce qu’exprime Jean Ullmo dès les premières lignes de son ouvrage La pensée scientifique moderne (Paris, Flammarion, 1969) : « la science recherche ses objets, elle les construit, elle les élabore ; elle ne les trouve pas tout faits ». Sous ce rapport, l'activité du chercheur ne repose pas sur une base rocheuse d’après son nouvel esprit scientifique. Notre réflexion épistémologique permettra de reconsidérer la place de la science à l’ère de la complexité. Mots-clés : rationalité, science, objectivité, communicabilité, vérifiabilité, esprit scientifique. Indications bibliographiques 1-Bertrand Russell, L’esprit scientifique et la science dans le monde moderne, Paris, Janin, 1947. 2-Bernard D’Espagnat, A la recherche du réel. Le regard d’un physicien, Paris, Gauthiers, Villars, 1979. 3-Carl Gustav Hempel, Eléments d’épistémologie, Etats-Unis, Armand Colin, 1966. 4-Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, Paris, Puf, 1934. 5- Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Paris, J.Vrin, 1938. 6-Henri Poincaré, La valeur de la science, Paris, Flammarion, 1905. 7-Jean-Louis Le Moigne, Les épistémologies constructivistes, Paris, Puf, coll « Que sais-je ? », 1995. Métiers sur lesquels ce cours de méthodologie peut déboucher 1-Métiers de journalisme scientifique 2-Métiers de l’enseignement 3-Didactique des sciences 4-Responsable d’un laboratoire scientifique 3 5- Chargé de recherche en sciences sociales 6- Chargé d'études en sciences Programmation du cours Semaine 1 : Introduction au cours Plan du cours, bibliographie et Notes introductives Semaine 2 : Définition de la science et démarcation entre la connaissance scientifique et la connaissance vulgaire. Semaine 3 : Nature de la connaissance scientifique chez Bachelard a-Nature et finalité Semaine 4 : Nature et déterminisme, Nature et convention Semaine 5 : Le constructivisme épistémologique de Bachelard et ses limites Semaine 6 : Travail personnel de l’étudiant (TPE) Dr NGUEMETA 4 Dr Philippe NGUEMETA Université de Yaoundé I Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines Département de Philosophie DESCRIPTIF DE L’UE 132 INTITULEE : INTRODUCTION A L’EPISTEMOLOGIE La place primordiale qu’occupent les connaissances scientifiques aujourd’hui dans la vie sociale rend indispensable une réflexion philosophique sur la manière dont ces connaissent s’élaborent et sur quels critères elles peuvent prétendre à l’objectivité ou à une représentation objective du réel. Dans le cadre de ce cours introductif à l’épistémologie, l’objectif pédagogique est de faire comprendre aux étudiants comment la tradition scientifique s’est peu à peu constituée en insistant sur les relations que la philosophie entretient avec les sciences. Si les auteurs comme Henri Poincaré, Jean Louis Le Moigne, Pierre Duhem, John Stuart Mill et Albert Einstein estiment que l’épistémologie n’a pas de sens toute seule ; qu’elle se nourrit des domaines différents et surtout de la philosophie, on peut se demander si on peut valablement assimiler la connaissance scientifique et l’activité philosophique. Que faire des multiples philosophies ? Comment la philosophie intègre-t-elle des fragments de science ? Comment faire coexister science et philosophie dans notre contexte ? Procédés pédagogiques Pour atteindre cet objectif, nous allons commencer par définir la science. Nous pensons que l’analogie entre la pratique scientifique et la philosophie est réelle. Notre souci est d’établir que l’un des enjeux de la clarification logique de la pensée peut conduire à notre développement. Nous allons ensuite procéder à la critique épistémologique à l’intérieur même des sciences pour montrer que la tradition classique avec Descartes, Malebranche, Leibniz a eu tort de séparer radicalement philosophie et science. La philosophie n’est pas une tabula rasa. La logique mathématique naissante a été décisive pour la constitution de l’épistémologie qui occupe une place fondamentale en philosophie. Elle permet d’entretenir des rapports aux sciences. Pour nous, l’investigation philosophique dans cette logique rend le philosophe « appliqué ». 5 Mots-clés : philosophie, science, épistémologie, logique, appliqué, sciences. Indications bibliographiques 1-Carl Gustav Hempel, Eléments d’épistémologie, Etats-Unis, Armand Colin, 1966. 2-E. Von Glasersfeld, The construction Knowledge, Salinas, Intersystems publications, 1987. 3-Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, Paris, Puf, 1934. 4- Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Paris, J.Vrin, 1938. 5-Jean-François Malherbe, Epistémologie anglo-saxonnes, Paris, Puf, 1981. 6- Lena Soler, Introduction à l’épistémologie, ellipses, 2000. Métiers sur lesquels ce cours de méthodologie peut déboucher 1-Métiers de journalisme scientifique 2-Métiers de l’enseignement 3-Didactique des sciences Programmation du cours Semaine 1 : Introduction au cours Plan du cours, bibliographie et Notes introductives Semaine 2 : Définition de la science et démarcation avec les autres formes de savoir. Semaine 3 : Typologie des épistémologies et les relations entre la science et la philosophie Semaine 4 : Préalables pour le dialogue Science-Philosophie Semaine 5 : Interrogations contemporaines Semaine 6 : Travail personnel de l’étudiant (TPE) Conclusion Dr NGUEMETA 6 Dr Philippe NGUEMETA Université de Yaoundé I Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines Département de Philosophie DESCRIPTIF DE L’UE 312 INTITULEE : PHILOSOPHIE DU LANGAGE L’objectif pédagogique de ce cours portant sur la philosophie du langage est d’initier les étudiants aux grands enjeux de la philosophie du langage et au tournant linguistique de la fin du XIXe siècle. Il s’agit de les familiariser avec les concepts majeurs de la philosophie du langage et aux grandes théories qui ont traversé son histoire. Plus spécifiquement, nous allons évaluer la profondeur du débat qui a agité le milieu philosophique sur les questions de la signification, de l’origine du langage. Les problèmes philosophiques posés par le langage ont fait l'objet d'analyses depuis Socrate. C’est précisément à partir du Cratyle de Platon, que la philosophie s’est occupée du langage: de son origine, de ses fonctions, du fondement de sa capacité à exprimer des significations. Mais si le champ de la philosophie du langage n'est pas nettement circonscrit aujourd’hui, peut-on réellement soutenir avec le personnage Cratyle qu’"une juste dénomination existe naturellement pour chacun des êtres" ? Autrement dit, le langage est-il naturel ou conventionnel? Procédés pédagogiques Pour réaliser cet objectif, nous traiterons d’abord de manière historique la question ontologique et épistémologique de la signification. En prenant appui dans le débat philosophique hérité de Platon dans le Cratyle. Cet ancrage historique aura pour but de développer une approche critique de chaque théorie philosophique. Ensuite, nous tenterons de montrer comment cette philosophie du langage, aidée par la logique, a permis une remise en cause de la méthode scientifique et l’avènement du courant analytique au XXe siècle. Enfin, en nous fondant sur la thèse du parallélisme logico- physique, nous montrerons que l’image du philosophe se construit et rappelle les techniques et exigences journalistiques. La corrélation entre le langage et les faits comme approche spécifiquement philosophique nous rapproche de l’univers médiatique. La philosophie du langage ne doit donc pas être comprise 7 comme étant un système isolé sans rapport avec le réel. Pour atteindre cet objectif, nous allons insister sur les enjeux de la rigueur à l’œuvre dans la philosophie du langage. Mots-clés : langage, logique, philosophie du langage, parallélisme logico- physique, signification, faits. Indications bibliographiques 1-Aristote, Les réfutations sophistiques, trad.fr J. Tricot, ed. Vrin, 2003. uploads/Science et Technologie/ phi-312-syllabus-philosophie-du-langage 1 .pdf
Documents similaires




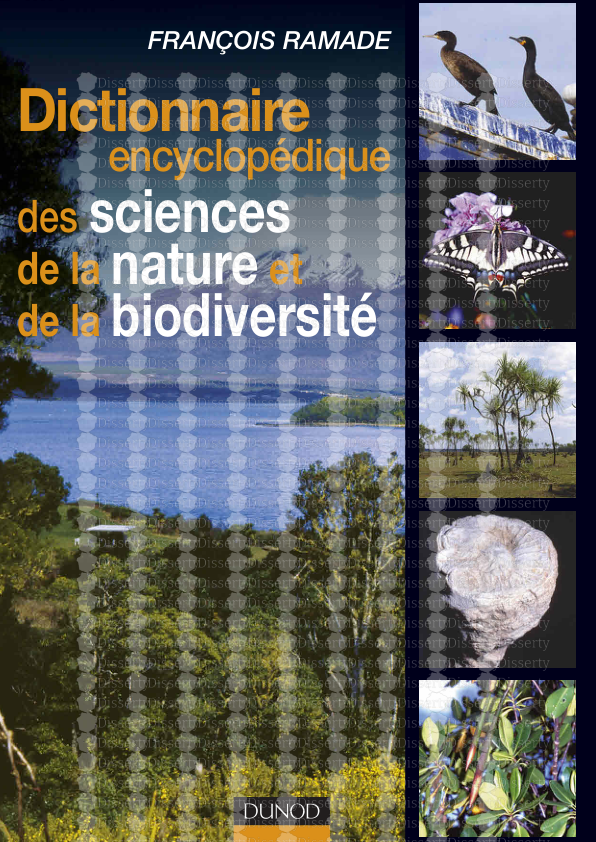





-
100
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 06, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6332MB


