Luc Boltanski Arnaud Esquerre Enrichissement Une critique de la marchandise Gal
Luc Boltanski Arnaud Esquerre Enrichissement Une critique de la marchandise Gallimard Pour Dominique Avant-propos Les acteurs sociaux, qu’ils achètent ou qu’ils vendent, sont constamment plongés dans l’univers de la marchandise dont dépend, pour une large part, et souvent plus qu’ils ne veulent l’admettre, leur expérience de ce qu’ils conçoivent comme la réalité. Composée de choses en circulation, la marchandise trouve son unité dans l’opération par laquelle un prix échoit à ces choses, chaque fois qu’elles changent de mains, contre des espèces monétaires. Mais, en même temps, ces choses n’en demeurent pas moins diversifiées, en sorte que l’univers de la marchandise se présente non comme une totalité opaque, ce qui la rendrait impénétrable, mais comme un ensemble structuré. C’est la référence à ces structures qui permet d’identifier chacune des choses échangées. Et c’est aussi parce qu’ils ont une compétence tacite de ces structures, intériorisées, que les acteurs sociaux peuvent s’orienter dans l’univers de la marchandise, se livrer au commerce et, particulièrement, porter un jugement sur la relation entre les choses et leur prix. Mais ces structures, et les relations qu’elles instituent entre les choses, leur prix et la valeur dont on les crédite, tirent parti de différentiels ancrés dans l’espace et ont un caractère historique. Elles se modifient dans le temps, en fonction des déplacements du capitalisme qui, dans la plupart des sociétés contemporaines, impose son carcan au commerce des choses. Les analyses de Walter Benjamin offrent sous ce rapport un cadre saisissant pour confronter les structures de la marchandise qui sous-tendent le commerce dans une grande partie de l’Europe du XXI e siècle, et peut-être du monde, à celles du XIXe siècle. Dans Paris, capitale du XIXe siècle 1, il nourrit sa méditation sur l’histoire et sa critique d’une « représentation chosiste de la civilisation » d’une réflexion sur la marchandise, à l’ère du capitalisme triomphant. Les marchandises se « manifestent » dans « l’immédiateté de la présence sensible » et, indissociablement — dit Benjamin — « en tant que fantasmagories », auxquelles s’abandonne le « flâneur » « cherchant un refuge dans la foule ». Benjamin met l’accent sur les formes alors radicalement nouvelles que prend la « ville-monde », où se concentrent non seulement la finance, le luxe et « l’esprit de la mode », mais aussi la bohème révolutionnaire, incarnée par Blanqui et, surtout, l’industrie et le prolétariat. Ce qui l’intéresse au premier chef est de montrer la façon dont des êtres — personnes et choses concentrées dans un même espace — incarnent une rupture radicale avec le passé, marquée par la formation du capitalisme industriel et financier, rupture que concrétisent les destructions opérées par Haussmann et la réorganisation du tissu urbain qui les accompagne. L’âge de la « marchandise-fétiche » entend asseoir sa légitimité sur une mise en scène futuriste des bienfaits de la « technique » et la « confiance aveugle dans le progrès » est l’instrument par lequel « l’historien, s’identifiant au vainqueur » sert « irrémédiablement les détenteurs du pouvoir actuel 2 ». Or le personnage du flâneur, si on le transpose dans le Paris du XXIe siècle, est plongé dans une tout autre réalité. Cette dernière n’est pas moins capitaliste que ne l’était celle à laquelle était confronté le flâneur évoqué par Benjamin. Pourtant le « luxe » ne s’y vante plus d’être « industriel ». Il s’efforce au contraire de faire oublier son enracinement dans une trame productive, d’autant plus facilement escamotée qu’elle est largement délocalisée dans l’orbite d’autres et lointaines « villes-mondes ». L’accumulation capitaliste se poursuit et même s’intensifie, mais elle prend appui sur de nouveaux dispositifs économiques et est associée à une diversification du cosmos de la marchandise en fonction des modalités de sa mise en valeur. Cet ouvrage s’attache ainsi à décrire cette transformation, particulièrement sensible dans les États qui ont été le berceau de la puissance industrielle européenne, et singulièrement en France, et à analyser la distribution de la marchandise entre différentes formes de mise en valeur. Notre travail s’oriente par conséquent dans deux directions que nous chercherons à articuler. Une première orientation est plutôt historique. Elle prend pour objet un changement économique qui, depuis le dernier quart du XX e siècle, a profondément modifié la façon dont sont créées les richesses dans les pays d’Europe de l’Ouest, marqués, d’un côté, par la désindustrialisation et, de l’autre, par l’exploitation accrue de ressources qui, sans être absolument nouvelles, ont pris une importance sans précédent. Selon nous, l’ampleur de ce changement ne se révèle qu’à la condition de rapprocher des domaines qui sont généralement considérés séparément, soit, notamment, les arts, particulièrement les arts plastiques, la culture, le commerce d’objets anciens, la création de fondations et de musées, l’industrie du luxe, la patrimonialisation et le tourisme. Nous chercherons à montrer que les interactions constantes entre ces différents domaines permettent de comprendre la façon dont chacun d’entre eux génère un profit. Notre argument sera qu’ils ont en commun de reposer sur l’exploitation d’un gisement qui n’est autre que le passé. Nous désignerons ce type d’économie par le terme d’« économie de l’enrichissement » en jouant sur l’ambiguïté du terme d’« enrichissement » : d’un côté, nous l’utilisons au sens où l’on parle de l’enrichissement d’un métal, d’un cadre de vie, d’un fond culturel, d’un vêtement, ou encore d’un ensemble d’objets rapprochés au sein d’une collection, pour mettre l’accent sur le fait que cette économie repose moins sur la production de choses nouvelles qu’elle n’entreprend d’enrichir des choses déjà là, surtout en les associant à des récits. D’un autre côté, le terme d’« enrichissement » renvoie à l’une des spécificités de cette économie qui est de tirer parti du commerce de choses qui sont, en priorité, destinées aux riches et qui constituent aussi, pour les riches qui en font commerce, une source supplémentaire d’enrichissement. Il nous semble que la prise en compte de cette économie de l’enrichissement et de ses effets est nécessaire pour saisir les transformations de la société française contemporaine et certaines des tensions qui l’habitent. Une seconde orientation est plutôt analytique. Elle vise à comprendre comment des marchandises très diverses peuvent donner lieu à des transactions qui, au moins pour la plupart d’entre elles, paraîtront, aux yeux des acteurs qui s’y engagent, soit en tant qu’offreurs, soit en tant que demandeurs, comme ayant un caractère normal, plus ou moins conforme à des attentes préalablement constituées. Par le terme de « marchandise », nous désignons toute chose à laquelle échoit un prix quand elle change de propriétaire. Or, si le cosmos de la marchandise n’était pas sous-tendu par des modes d’organisation qui sont en partie implicites, on ne comprendrait pas comment, étant donné sa diversité phénoménale, les acteurs pourraient s’y orienter. La dextérité commerciale des acteurs est certes très variable et dépend de leur niveau de socialisation marchande. Néanmoins, sans une compétence minimale, un acteur serait simplement égaré et incapable de faire son chemin dans le monde, tant le rôle et le nombre des transactions marchandes ont pris de l’importance dans les sociétés modernes. C’est en ce sens que nous parlerons de structures de la marchandise. En prenant appui sur ces structures sous-jacentes, les acteurs peuvent adopter une position réflexive face à la relation entre ces deux espèces d’entités hétérogènes — soit, d’une part, des choses et, de l’autre, des prix —, dont l’union constitue la marchandise en tant que telle, au lieu de ne recevoir cet assemblage que synthétiquement et d’en subir passivement les effets. Mais, pour comprendre la façon dont la raison peut chercher à se saisir de la relation entre les choses et leur prix, nous devrons prendre en compte la référence à un troisième genre d’entité, que nous désignerons en reprenant le terme qu’utilisent les acteurs — si l’on veut, le terme indigène —, c’est-à- dire celui, polysémique, de valeur. C’est en effet très généralement en faisant référence à un être de la chose qui serait sa « valeur » propre que l’on rend réflexive la relation entre cette chose et son prix, qu’il s’agisse de critiquer ce prix ou de le justifier. Plutôt que de tenir la valeur pour une propriété à la fois substantielle et mystérieuse des choses — une façon de voir qui a imprégné l’économie classique et qui perdure au-delà —, nous traiterons la valeur comme un dispositif de justification ou de critique du prix des choses. Les structures que nous chercherons à dégager partitionnent l’univers de la marchandise en distribuant l’ensemble des objets marchands entre différentes façons d’en justifier (ou d’en critiquer) le prix, c’est-à-dire entre différentes façons de les mettre en valeur. Nous verrons que les différentes façons de mettre les choses en valeur présentent des jeux de différences obtenus par permutation d’oppositions élémentaires, en sorte qu’on peut les décrire sous la forme d’un groupe de transformation, ce qui permet de concilier l’homogénéité du cosmos de la marchandise (il comprend toute chose à laquelle, en changeant de mains, échoit un prix) et la diversité des objets qui la composent en fonction de la façon dont ce prix est justifié. uploads/s1/ enrichissement-une-critique-de-la-marchandoltanski-arnaud-esquerre-amp-arnaud-esquerre.pdf
Documents similaires


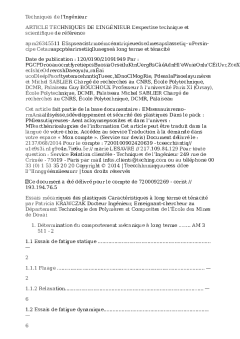







-
67
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 22, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 7.5794MB


