47 Issue No. 12 Arts rupestres sahariens : état des lieux depuis 2010 et perspe
47 Issue No. 12 Arts rupestres sahariens : état des lieux depuis 2010 et perspectives 2010 الفنون الصخرية الصحراوية: الواقع والمأمول منذ عام Jean-Loïc Le Quellec* ملخص مقاالً يف العدد الرابع من حويلة أجبديات يهدف إىل اتلعريف بالفن 2009 نرش ادلكتور محدي عبد املنعم عباس يف اعم الصخري وادلور املهم اذلي يلعبه هذا انلوع من ابلقايا األركيولوجية يف دراسة جانب مهم من تاريخ اجلنس البرشي قبل ظهور الكتابة، ويأيت هذا املقال استجابة لدلعوة اليت أطلقها ادلكتور محدي عباس سلفًا؛ حيث يقدم املقال اذلي بني أيدينا ؛ أما األعمال 2014 حىت2010 قائمة باألعمال ابلحثية اخلاصة بالفن الصخري يف منطقة الصحراء يف الفرتة ما بني أعوام اليت أجريت قبل تلك الفرتة فيمكن الرجوع إيلها من خالل االطالع ىلع مؤلفات دكتور ‘ألفريد موزويلين’ يف الفرتة ما .2009 حىت2000 ، وكذلك االطالع ىلع مؤلفايت يف الفرتة ما بني أعوام1999 حىت1990 بني أعوام Jean-Loïc Le Quellec 48 Abgadiyat 2017 « Toute connaissance est, aujourd’hui, nécessairement, une connaissance comparée ». Paul Valéry 1) Introduction Dans cette même revue, Hamdi Abbas Ahmed Abd-el-Moniem a publié en 2009 un plaidoyer pour l’utilisation de l’art rupestre comme une source archéologique à croiser avec les données paléo-environnementales pour écrire l’histoire de l’humanité avant l’écriture.1 En réponse à cet appel, voici donc un bilan des recherches en art rupestre conduites sur l’ensemble du Sahara durant les années 2010 à 2014. Pour les deux décennies antérieures, on consultera les synthèses établies par moi-même pour la période 2000-2009,2 et par Alfred Muzzolini pour les années 1990-1999.3 Le fait marquant de ces dernières années est une insécurité croissante dans toute la moitié nord de l’Afrique, ayant pratiquement conduit à l’arrêt progressif de tous les programmes de recherche, presque partout au Sahara. Pourtant, de nombreux documents nouveaux ont été publiés, que je vais d’abord passer en revue pays par pays. J’examinerai ensuite successivement : les approches thématiques, les analyses stylistiques et statistiques, les récents développements sur la chronologie et les datations, quelques méthodes nouvelles et diverses tentatives d’interprétation, pour finir ce tour d’horizon en évoquant les problèmes de préservation et de conservation. La bibliographie sera aussi exhaustive que possible, et d’éventuelles omissions ne sauraient être qu’involontaires: à l’avance, je prie les lecteurs et les auteurs de travaux éventuellement oubliés de m’en excuser. Les conventions AEC (avant l’ère commune) et EC (de l’ère commune) seront utilisées pour les datations, conjointement avec les datations14 C calibrées. Celles-ci, indiquées par « calBC », ont été calculées avec OxCal 4.2 en utilisant la courbe de calibration de Bronk Ramsey & Lee 2013 et elles sont généralement arrondies à la dizaine la plus proche. 2) Nouveaux documents Encore trop rares sont les auteurs qui publient des corpus détaillés des sites qu’ils ont visités, mais cette tendance commence fort heureusement à s’inverser, malgré les difficultés actuelles. (a) Algérie Deux stations de gravures en « style de Tazina » ont été signalées dans les oueds Azidj et Ti-n-Soghmar, du nord de l’Immidir, zone riche en potentialités.4 Les inventaires de sites rupestres de la région de Taserert-Iharaien, dans la Tasīli- n-Ajjer ont été considérablement enrichis grâce aux observations de voyageurs attentifs, qui y ont signalé de nombreuses peintures en style d’Iheren, ainsi que la présence inattendue de peintures en style des Têtes Rondes.5 D’autres peintures en style d’Iheren ont été signalées à Ihetsen, avec en particulier une remarquable scène de chasse aux éléphants.6 Bernard Fouilleux, l’un des meilleurs connaisseurs des peintures tassiliennes, a corrigé plusieurs oublis et localisations erronées concernant les sites de Ti-n-Kani et Ti-n-Tazarift étudiés par Ulrich et Brigitte Hallier.7 Dans l’oued Afar, une série de vingt-deux représentations d’hippopotames a été relevée,8 et une rare peinture d’oryctérope a été signalée dans l’Adrar Heggĕren.9 L’inventaire des peintures en style des Têtes Rondes de Tissoukaï et d’Ido complète fort utilement les données autrefois recueillies par Henri Lhote et Charles Brenans.10 À Tajouiset, l’abri dit « des éléphants » a fait l’objet d’un relevé très soigné, comme il en existe encore trop rarement dans la Tasīli-n-Ajjer.11 Il en est de même de celui de Tikadiouine, pour lequel Fabio Arts rupestres sahariens : état des lieux depuis 2010 et perspectives 49 Issue No. 12 Maestrucci et Gianna Giannelli ont présenté un relevé beaucoup plus complet que les précédents ; ce qui en autorise ainsi une nouvelle lecture.12 Les célèbres abris d’Iheren et « Tahilahi » ont motivé une monographie13 dont plusieurs dessins, à l’apparente précision parfois trompeuse, doivent être considérés avec une certaine circonspection, car il en est de manifestement erronés. En général, il convient d’être prudent quant aux relevés, car il arrive souvent qu’ils soient tantôt surinterprétés, et tantôt incomplets, comme c’est le cas pour des peintures du plateau de Tadjelahin et d’autres sites tassiliens; heureusement, les moyens techniques actuels font que les publications présentent aussi, et de plus en plus souvent, de bonnes photographies.14 La multiplication des monographies d’abris ces dernières années est, de toute manière, une excellente chose.15 Un relevé complet de l’abri de Ta-n- Timzar a notamment enrichi notre connaissance du répertoire graphique des peintres en style des Têtes Rondes,16 et le célèbre relevé des peintures d’Iheren (Fig. 1) a été revu par Yves Martin.17 Jean-Dominique Lajoux a publié une troisième édition de son ouvrage sur les peintures tassiliennes, avec plusieurs documents nouveaux,18 mais cette heureuse initiative s’accompagne hélas d’un texte souffrant de nombreux partis pris, erreurs et approximations, que l’on rectifiera en lisant les travaux de Monique Vérité, qui a publié la première biographie du célèbre Henri Lhote. Comme elle a pu avoir accès à nombre de documents familiaux inédits, elle corrige nombre d’affirmations contestables, et il en ressort un portrait nuancé de cet aventurier au caractère bien trempé.19 Par ailleurs, il est pour le moins piquant de constater que le livre de Lajoux a été considéré comme « une prise de position courageuse en faveur d’une méthode appropriée pour l’enregistrement de l’art rupestre, et une dénonciation de l’utilisation abusive et non- éthique de la science »20 alors que les photos de cet auteur montrent assez qu’il a lui-même mouillé les peintures.21 Yves Martin confirme du reste, en cherchant à minimiser la chose, qu’un « simple humectage » fut « par instant pratiqué » lors des missions Lhote de 1962 et de 1970-1971.22 Plusieurs abris du piémont sud-occidental du plateau tassilien ont fait l’objet d’un pré- inventaire, à Timghas, Ta-n-el-’Askar, Tillellin, Tedjeleh Ekrar et Wa-n-Oghalia. On peut y voir des peintures en styles des Têtes Rondes, d’Oẓan Eheré et de Tachekelawat, ainsi que des figures caballines et camelines dont il faut souhaiter qu’elles feront bientôt l’objet d’études particulières.23 Pour l’instant, seul l’abri de Tillellin, intéressant par ses (Fig. 1) Détail des peintures de l’abri éponyme d’Iheren, ayant permis la définition du style du même nom. Photo Jean-Loïc Le Quellec. Jean-Loïc Le Quellec 50 Abgadiyat 2017 peintures en style des Têtes Rondes, a été publié en détail.24 L’attention a été attirée sur les images rupestres de la Téfedest,25 et un projet d’« analyse archéologique totale » a été monté dans cette région, le volet consacré à l’art rupestre ayant donné lieu à la publication du relevé de plusieurs ensembles intéressants (Timedwin, Timalain–Ti-Melulin, Wa-n-Buya, Wa-n-Tahart, Wa-n-Tissemt), avec des réflexions « forcément subjectives », suivant la présentation qu’en font leurs auteurs. On retiendra notamment une technique particulière, dite de « détourage », qui semble propre à cette région.26 En Ahaggar, plusieurs sites à peintures et gravures ont été repérés, avec en particulier une intéressante série de « nasses » gravées, formant une nouvelle extension à ce motif énigmatique.27 Dans l’Atlas saharien, les stations à gravures de Mahisserat et de Thyout, très anciennement connues (Fig. 2), ont été révisées,28 de même que celles de Khanguet el-Hadjar et de Kef el-M’Saoura. Pour ces deux derniers sites, l’ambition était de « dépasser le stade descripitif » en pratiquant « une lecture anthropologique de l’art pariétal de l’Algérie orientale », mais on peut regretter que celle-ci ne s’appuie sur aucune démonstration précise. Ainsi, un anthropomorphe est vu comme figurant « un tout jeune berger s’occupant de son animal favori et le caressant tout en martelant la scène sur la paroi » (sic!) : aucun élément n’objective cette lecture, et pourtant les auteurs en font l’un des « atouts décisifs pour l’interprétation du site ».29 De même, ils ne nous expliquent pas comment ils en arrivent à conclure que « chaque scène reste […] représentative d’un clan, et en raconte son histoire ». Enfin, il est à noter que l’inventaire des gravures de grands Buffles antiques de l’Atlas a été complété.30 (b) Libye et désert Libyque Un large glacis portant près d’une centaine de gravures, dans la région des Aramāt, a reçu le nom du guide targui qui les a fait connaître, et s’appelle donc Wa-n-Kalia. Environ 80 % de ces images sont des zoomorphes, dont un tiers de girafes et un cinquième de bovinés.31 Un bref séjour dans Jebel Ben Ghnēma (Fig. 3) a permis à Francis Auvray, Richard Wolff et (Fig. 3) Gravure de bœuf porteur provenant du Jebel ben Ghnēma et conservée au Musée de Jerma en Libye. Photo Jean-Loïc Le Quellec. (Fig. 2) Détail uploads/s3/ 2017-arts-rupestres-sahariens-etat-des-pdf.pdf
Documents similaires

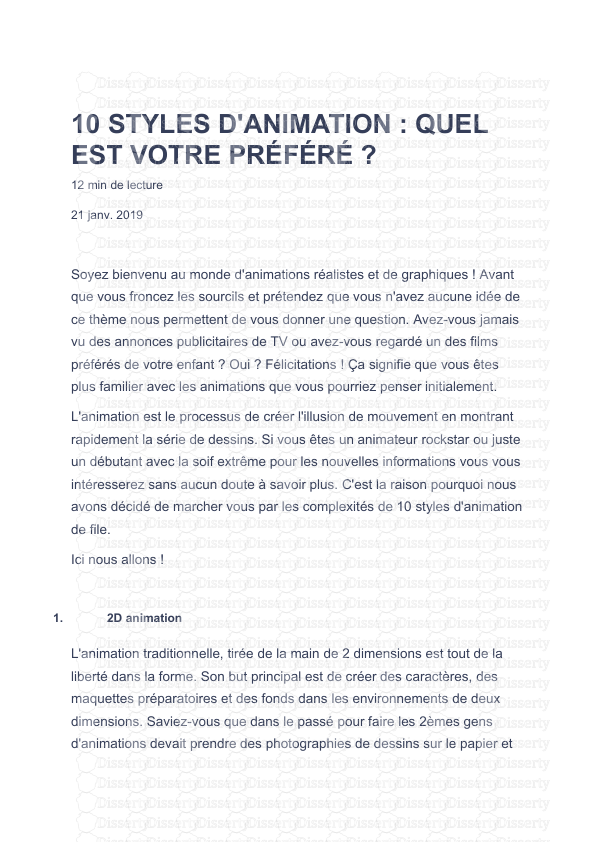








-
36
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 22, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.6625MB


