Communication et langages À la rencontre d'Akeji, peintre calligraphe japonais
Communication et langages À la rencontre d'Akeji, peintre calligraphe japonais d'aujourd'hui Raymond Voyat Résumé La calligraphie est un art majeur au Japon. Cet art est maintenu vivant aujourd'hui, dans le respect le plus strict de la tradition, par des artistes reconnus. Le respect de la tradition implique non seulement la manière d'exercer cet art, mais la manière de vivrede l'artiste qui le pratique. Dans l'article ci-dessous, Raymond Voyat, spécialiste de la culture japonaise, propose une approche de la calligraphie japonaise à travers l'œuvre d'un grand artiste japonais contemporain, M. Akeji, auquel le musée d'AIbi vient de consacrer une importante exposition. Citer ce document / Cite this document : Voyat Raymond. À la rencontre d'Akeji, peintre calligraphe japonais d'aujourd'hui. In: Communication et langages, n°122, 4ème trimestre 1999. Dossier : Revue de la presse. pp. 19-29. doi : 10.3406/colan.1999.2963 http://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1999_num_122_1_2963 Document généré le 15/10/2015 x û_ À la rencontre d'Akeji, 1 peintre calligraphie | japonais d'aujourd'hui u Raymond Voyat La calligraphie est un art majeur au Japon. Cet art est dessous, Raymond Voyat, spécialiste de maintenu vivant aujourd'hui, dans le res- la culture japonaise, propose une pect le plus strict de la tradition, par des approche de la calligraphie japonaise à artistes reconnus. Le respect de la tradi- travers l'œuvre d'un grand artiste japonais tion implique non seulement la manière contemporain, M. Akeji, auquel le musée d'exercer cet art, mais la manière de vivre d'AIbi vient de consacrer une importante de l'artiste qui le pratique. Dans l'article ci- exposition. Pour le mot calligraphie, le Nouveau Petit Robert, éd. 1993, donne à la page 289 : « 1 . Art de bien former les caractères d'écriture; écriture formée selon cet art ». Sens qui ne rend pas vraiment le poids dont est investi le mot japonais shodô, « la Voie de l'écriture ». Le simple « bien écrire » est donc beaucoup plus léger en français. LE GESTE ET LE VERBE Entourés de redoutables déserts et de montagnes inaccessibles, et bordés par les eaux du Pacifique, la Chine, la Corée et le Japon constituent une immensité géographique de caractère « insulaire », dont la civilisation privilégie le visuel. L'une des légendes racontant la naissance de l'idéogramme évoque un fonctionnaire mythique, Cang Jie. Celui-ci - il avait quatre yeux (déjà l'importance du regard) et vivait quelque 5 000 ans avant notre ère - avait remarqué que les traces de pattes d'oiseaux sur le sable ressemblaient à des signes. D'où son idée de les copier au moyen d'un stylet sur des planchettes pour reproduire des objets usuels à l'inventaire desquels il travaillait. Donc, au départ, une démarche qui permettait de reconnaître des objets concrets au moyen d'un dessin simplifié. D'autres légendes décrivent des entrelacs de lianes, des marques dans l'écorce des arbres, les veines de rocher, résultats des hasards de la 20 Calligraphie nature, mais que les hommes interprétèrent comme autant de signaux ou de messages cryptés par les dieux. Il s'agissait d'une « écriture céleste » que s'approprièrent chamans et hermé- neutes, seuls capables de la déchiffrer. Ici, donc, l'idéogramme est signe divinatoire, dont l'interprétation, tout en visant les besoins de la communauté villageoise, préparait l'évolution vers l'abstraction. L'Occident judéo-chrétien, lui, dit avant que de voir: « Or, Dieu dit » (entrée de la Genèse [1 ,3]), ou « Au commencement était le Verbe » (incipit de l'évangile de Jean [1,1]). Le Très-Haut se manifeste par la force de son Verbe, qui crée en nommant. Mais en Extrême-Orient, et pour paraphraser Jean, « Au commencement était le Trait ». Car c'est le geste du démiurge qui crée. C'est aussi le Trait primordial du calligraphe qui évoluera vers une complexité à l'image des phénomènes, puisque le grand dictionnaire de référence du xvme siècle finira par accueillir 44000 idéogrammes. Sur les 10000 qui demeureront plus ou moins en usage, 3000 resteront courants dans des combinaisons formant 12 000 à 13000 mots. Face à cette exubérance visuelle, la phonétique de la langue restera assez pauvre, avec 400 syllabes, pourtant enrichies, en Chine, de quatre tons. Cette différence de poids entre le Verbe et le Geste est fondamentale et contraint l'esprit occidental à une discipline d'autant plus délicate que l'art de l'Extrême-Orient n'est pas seulement un message esthétique et ne se comprend qu'en partie avec la raison. L'essentiel, en effet, se vit grâce à une identification qui présuppose un éveil intérieur, satori (éveil bouddhique), qui suscite une prise de conscience dans la contemplation. L'art spiritualise la nature, où l'homme s'intègre en y occupant alors une place authentiquement médiatrice. ^ L'art de la calligraphie - tout écrit étant image, il ne différencie ^ pas le signe et la peinture - fait partie, avec la musique, des dis- ^ ciplines que tout lettré investi de pouvoir se doit de pratiquer. À la H fois philosophie, éthique, religion, selon des critères qui se che- g> vauchent sur « la Voie ». D'ailleurs l'ensemble procède des 5 anciennes croyances animistes, et du Tao, du confucianisme, du ç bouddhisme (en particulier du zen), ces disciplines formant un ■â tout en s'enrichissant mutuellement. ■| Cela dit, il est tentant d'établir une parenté spirituelle entre le cal- | ligraphe oriental et le moine copiste du Moyen Âge. Ou, jusqu'à E aujourd'hui encore, le copieur de rouleaux de la Torah. Comme <S le calligraphe reprenant le Trait primordial sur le support vide de À la rencontre d'Akeji, peintre calligraphie japonais 21 son papier, un moine, en traçant les mots, lettre après lettre, du texte sacré, répétait le geste créateur qui l'identifiait à son Créateur grâce à un acte de foi réactualisant l'histoire du salut. Quant à la Grâce, accordée ou non par Dieu au croyant, elle n'est pas sans rappeler l'illumination bouddhique, qui ne saurait s'obtenir, mais ne peut que survenir. Certes, les racines sacrées de la calligraphie furent peu à peu sécularisées par le pouvoir qui, en s'appropriant l'écriture, institua l'échange autographe entre mandarins fonctionnaires, chargés de gérer un pays aux innombrables langues et dialectes. D'abord messager d'une volonté magique, puis support de textes sacrés, l'idéogramme est devenu un moyen d'unification politique récupéré par une administration de plus en plus centralisée. Mais, en même temps, moyen de communication des lettrés, penseurs, poètes et particuliers. Et cela sans que l'un supplante et annule l'autre. Et jusqu'à aujourd'hui, l'unicité de l'écriture fait contraste avec l'abondance des parlers régionaux. LA DIFFUSION DE L'IDÉOGRAMME AU JAPON Même s'il est possible que le Japon ait connu certaines formes de paléo-écriture antérieures à l'idéogramme (c'est une thèse que défend Akeji), ce sont les moines venus de Chine, passant par la Corée, qui, vers la fin du vie siècle, introduisirent, en même temps que le bouddhisme, l'écriture. Une écriture aboutie, achevée, grâce aux perfectionnements techniques dont elle avait bénéficié au cours des siècles : amélioration de la fabrication du papier, mais surtout celle du pinceau, dont la légende affirme qu'un certain Meng Tian, général de l'époque Qin, en serait l'inventeur, vers la fin du ine siècle avant notre ère. Le pinceau, remplaçant le stylet qui gravait des matériaux durs (os d'animaux, carapaces de tortues, pierre), allait permettre de rythmer le trait, qu'il soit plein, délié, arrondi ou cursif, sur un support absorbant, facile à transporter et à diffuser, même s'il était fragile. Sans oublier que le pinceau allait rendre possible de représenter l'homme dans la nature, donc la peinture. Une tradition veut que le prince Shôtoku (574 - 622) ait lui- même calligraphié un des premiers textes bouddhistes, une glose du sûtra du Lotus. Une autre source donne l'année 538 comme année de l'introduction officielle du bouddhisme, ce qui montre en tout cas que le bouddhisme a conquis d'abord la noblesse et les élites et s'est diffusé ensuite du haut vers le bas de la hiérarchie sociale. 22 Calligraphie II est aussi intéressant de noter la flexibilité de l'idéogramme, qui a pu intégrer le vocabulaire original japonais sans perdre le sien. À moins que ce ne soit l'agilité de l'esprit japonais qui ait réussi à « naturaliser » l'idéogramme, comme il lui a adjoint, par la suite, les unités syllabiques (aujourd'hui au nombre de 48) de l'écriture katakana (kata = fragmentaire, ka = écriture et na = non officiel). C'étaient, à l'origine, des abréviations mnémotechniques permettant de prononcer les textes bouddhistes. S'y ajoutèrent, plus tard encore, les unités syllabiques (aussi au nombre de 48) de l'écriture hiragana (hira = rond, facile, ga [affaiblissement de ka] = écriture et na = non officiel), système graphique simplifié destiné aux femmes, qui en feront un moyen d'expression poétique. Si le sens évolue, la forme demeure néanmoins étonnamment stable. LES MOYENS DU CALLIGRAPHE Pour représenter l'idéogramme, le calligraphie dispose de différentes écritures : archaïque pour les sceaux, religieuse pour la copie des textes sacrés, standard pour les livres, cursive pour la correspondance. Il dispose enfin d'une écriture privée, dite « comme de l'herbe », « faite de traces d'encre », écriture dont le trait lie idéogrammes et syllabes, donnant au message une forme et un rythme personnels qui le rend très difficile à déchiffrer à ceux uploads/s3/ akeji.pdf
Documents similaires








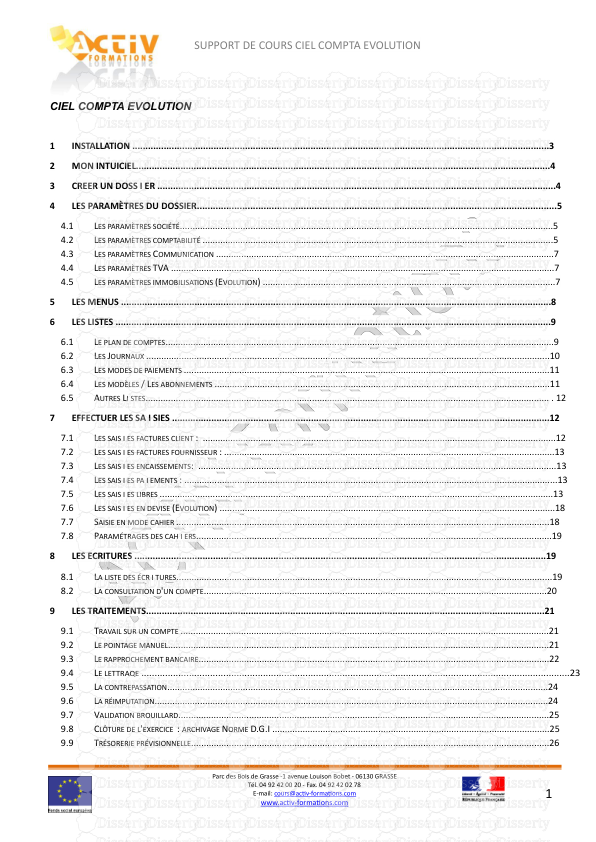

-
102
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 06, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 3.7973MB


