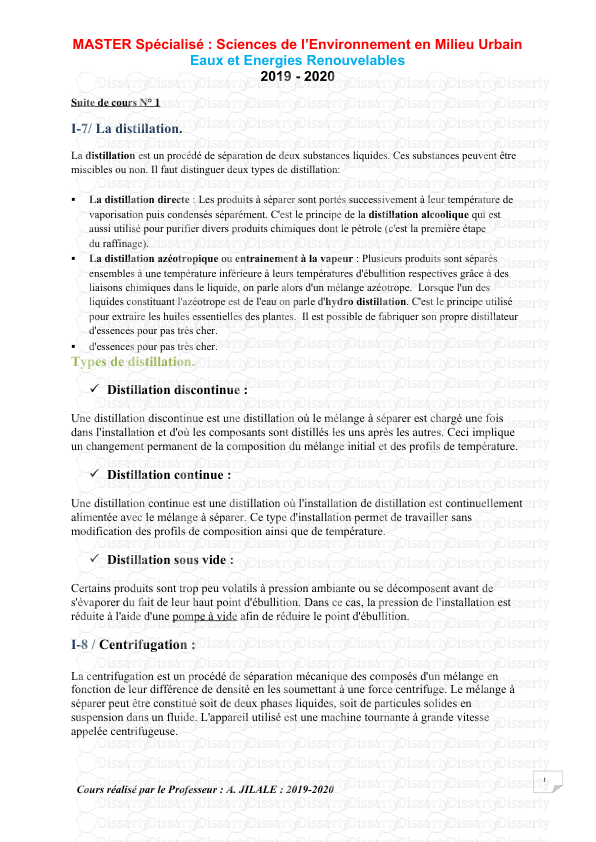1 MASTER Spécialisé : Sciences de l’Environnement en Milieu Urbain Eaux et Ener
1 MASTER Spécialisé : Sciences de l’Environnement en Milieu Urbain Eaux et Energies Renouvelables 2019 - 2020 Suite de cours N° 1 I-7/ La distillation. La distillation est un procédé de séparation de deux substances liquides. Ces substances peuvent être miscibles ou non. Il faut distinguer deux types de distillation: La distillation directe : Les produits à séparer sont portés successivement à leur température de vaporisation puis condensés séparément. C'est le principe de la distillation alcoolique qui est aussi utilisé pour purifier divers produits chimiques dont le pétrole (c'est la première étape du raffinage). La distillation azéotropique ou entrainement à la vapeur : Plusieurs produits sont séparés ensembles à une température inférieure à leurs températures d'ébullition respectives grâce à des liaisons chimiques dans le liquide, on parle alors d'un mélange azéotrope. Lorsque l'un des liquides constituant l'azéotrope est de l'eau on parle d'hydro distillation. C'est le principe utilisé pour extraire les huiles essentielles des plantes. Il est possible de fabriquer son propre distillateur d'essences pour pas très cher. d'essences pour pas très cher. Types de distillation. Distillation discontinue : Une distillation discontinue est une distillation où le mélange à séparer est chargé une fois dans l'installation et d'où les composants sont distillés les uns après les autres. Ceci implique un changement permanent de la composition du mélange initial et des profils de température. Distillation continue : Une distillation continue est une distillation où l'installation de distillation est continuellement alimentée avec le mélange à séparer. Ce type d'installation permet de travailler sans modification des profils de composition ainsi que de température. Distillation sous vide : Certains produits sont trop peu volatils à pression ambiante ou se décomposent avant de s'évaporer du fait de leur haut point d'ébullition. Dans ce cas, la pression de l'installation est réduite à l'aide d'une pompe à vide afin de réduire le point d'ébullition. I-8 / Centrifugation : La centrifugation est un procédé de séparation mécanique des composés d'un mélange en fonction de leur différence de densité en les soumettant à une force centrifuge. Le mélange à séparer peut être constitué soit de deux phases liquides, soit de particules solides en suspension dans un fluide. L'appareil utilisé est une machine tournante à grande vitesse appelée centrifugeuse. Cours réalisé par le Professeur : A. JILALE : 2019-2020 2 MASTER Spécialisé : Sciences de l’Environnement en Milieu Urbain Eaux et Energies Renouvelables 2019 - 2020 Principe : La séparation des composés d'un mélange est réalisable par décantation, sous l'action de la seule gravitation mais elle nécessite parfois une longue durée pour acquérir de bons résultats et est donc souvent inefficace. Il est donc plus efficace d'utiliser la centrifugation. Si on laisse reposer une suspension solide dans une phase liquide, on observe que les particules, sous l'action de la pesanteur et de la poussée d'Archimède, tendent à tomber vers le fond ou à remonter vers la surface selon leur densité et leur taille. Ce procédé, la décantation, est cependant relativement lent pour les très fines particules (sensibles à l'agitation thermique) et les liquides particulièrement visqueux. On a eu l'idée de décupler le pouvoir séparateur du champ de pesanteur vertical en lui substituant un champ centrifuge radial. Il s'agit donc d'entraîner un appareil (le "bol") à grande vitesse, en rotation autour d'un axe. Son accélération, proportionnelle à la distance à l'axe de rotation, varie comme le carré de la vitesse. À 10 000 tr/mn, on obtient, à 10 cm de l'axe, une accélération mille fois plus grande que celle de la pesanteur. Dans le cadre du traitement des effluents. La centrifugation fait appel à la force centrifuge exercée sur les particules incluses dans la solution. Cette séparation s’effectue selon la densité des particules sous la force exercée par l’accélération à haute vitesse de la solution à séparer. Les trois étapes de la centrifugation : Avant et après la centrifugation I-9 / La Recristallisation. La cristallisation est une opération unitaire du génie chimique consistant à isoler un produit sous forme de cristaux1. La cristallisation est l’une des opérations physiques les plus anciennes pratiquées, avec l'évaporation de l’eau de mer pour isoler du sel. La recristallisation est une étape de purification, en fin de synthèse. Le solide à purifier est dissous à reflux dans le minimum de solvant approprié. La solution obtenue est filtrée à chaud pour éliminer les impuretés éventuelles insolubles. Le filtrat est refroidi lentement pour faire cristalliser le produit. La suspension obtenue est filtrée pour séparer les impuretés solubles dans le solvant du produit désiré. Cours réalisé par le Professeur : A. JILALE : 2019-2020 3 MASTER Spécialisé : Sciences de l’Environnement en Milieu Urbain Eaux et Energies Renouvelables 2019 - 2020 La recristallisation désigne en chimie une méthode de purification qui repose sur la différence de solubilité entre le composé à purifier et ses impuretés dans un solvant donné. La solubilité augmentant généralement avec la température, on dissout habituellement le composé dans le minimum de solvant porté à ébullition1. Généralement on dispose d'un composé A contaminé par une petite quantité d'impureté B. Cristallisation fractionnée. En chimie, la cristallisation fractionnée est un procédé de purification reposant sur le fait que deux composant d'un mélange ont en général des solubilités différentes dans un solvant et vont donc précipiter à des concentrations différentes. En pratique on utilise le fait que la solubilité est souvent croissante en fonction de la température. On chauffe une solution du mélange à séparer et on refroidi lentement pour laisser à chaque composant du mélange le temps de précipiter. I-10 / La sublimation. En physique, la sublimation est le passage direct d'un corps de l'état solide à l'état gazeux1, sans passer par l'état liquide. Par conséquent, cette transformation se fait sans passer par une étape de fusion (de solide en liquide), ni une étape d'évaporation (de liquide en gaz). Le procédé inverse se nomme déposition ou condensation solide ou encore sublimation inverse. Appareil simple de sublimation. De l'eau habituellement froide circule dans un doigt réfrigérant afin de permettre le dépôt désiré de mélange en cours de sublimation. 1 Entrée d'eau froide 2 Sortie eau froide3 sortie du gaz 4 Chambre de sublimation 5 Mélange de sublimation6 Matière de base 7 Chauffage extérieur. Cours réalisé par le Professeur : A. JILALE : 2019-2020 4 MASTER Spécialisé : Sciences de l’Environnement en Milieu Urbain Eaux et Energies Renouvelables 2019 - 2020 Tout solide stable est susceptible d'être sublimé si on le chauffe à une pression inférieure à celle de son point triple. La sublimation nécessite de fournir une énergie au corps qui la subit et est une transition de phase endothermique. La chaleur de sublimation (enthalpie de sublimation) peut être calculée comme la somme de l'enthalpie de fusion et de l'enthalpie de vaporisation. Application : Dans une imprimante à sublimation thermique, la cire pigmentée remplace l'encre. Elle est chauffée à près de 200 °C par des micros résistances réparties sur la tête d'impression. Elle passe ainsi instantanément de l'état solide à l'état gazeux puis, projetée sur la feuille, elle refroidit à son contact et redevient solide. DEUXIEME PARTIE LES METHODES DE SEPARATION. A-Techniques chromatographiques GENERALITES : Le terme de "chromatographie" a été créé par Mikhail TSWETT en 1905, pour décrire une technique de séparation de pigments végétaux (chlorophylles et caroténoïdes) sur des colonnes remplies d’une substance absorbante. Il évoque la couleur des substances analysées, mais il est possible que l’origine du nom soit tout autre : en effet, le nom de l’auteur signifie "couleur" en russe, et il est donc possible que ce dernier ait voulu donner son nom à la technique qu’il avait mise au point (Jaussaud, 1996). Les méthodes chromatographiques regroupent des techniques très variées qui peuvent être classées selon trois modalités différentes : *Classification selon la nature physique des phases • Classification selon le phénomène mis en œuvre • Classification selon le procédé opératoire. 1-1-Classification selon la nature des phases : • la phase mobile est un fluide, soit un liquide, soit un gaz. • la phase stationnaire est soit un solide, soit un liquide. La combinaison de ces possibilités conduit à diverses possibilités : • chromatographie liquide—solide (cas de Tswett) (LSC) • chromatographie liquide—liquide (LLC) • chromatographie gaz—solide (GSC ou GC) • chromatographie gaz—liquide (GLC ou GC) • la chromatographie supercritique (SFC) La SFC représente un cas intermédiaire entre LC et GC, les fluides supercritiques possédant des propriétés à la frontière entre celles des liquides et celles des gaz. Cours réalisé par le Professeur : A. JILALE : 2019-2020 5 MASTER Spécialisé : Sciences de l’Environnement en Milieu Urbain Eaux et Energies Renouvelables 2019 - 2020 1-2-Classification selon le phénomène chromatographique : Ce dernier dépend de la nature (et de la structure) de la phase stationnaire utilisée. On distinguera : • la chromatographie d'adsorption (LSC, GSC) (lorsque la phase stationnaire est un solide); par extension on pourrait y rattacher la chromatographie d'affinité, qui correspond à un cas où les propriétés d'adsorption de la phase stationnaire sont spécifiques vis-à-vis d'un (ou une famille de) composé(s). • la chromatographie de partage (LLC, GLC), lorsque la uploads/s3/ cours-2-2020-jilale-1.pdf
Documents similaires


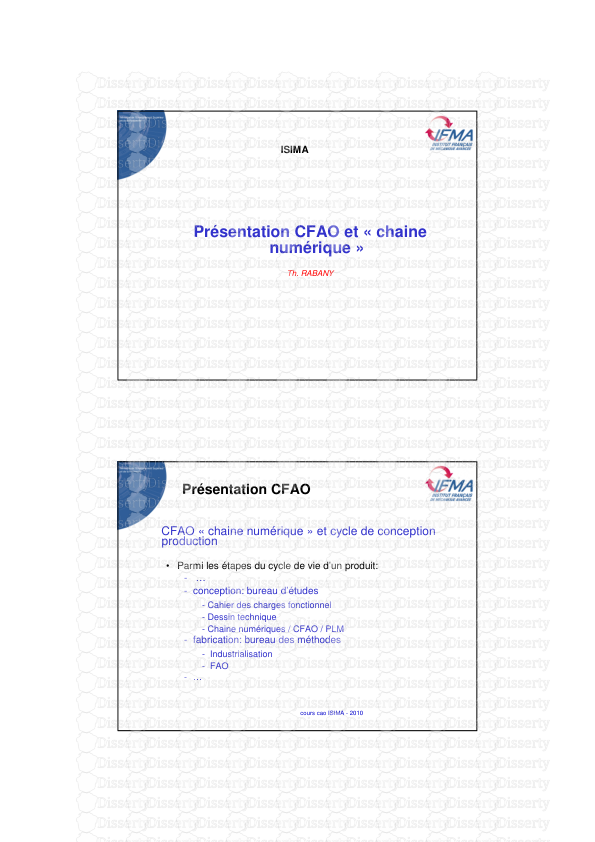

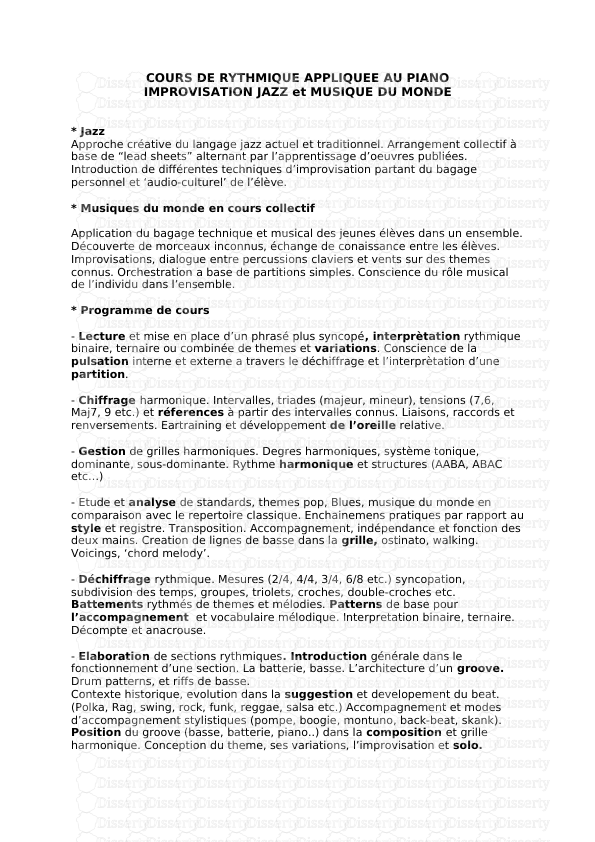





-
142
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 06, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3455MB