TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage 31 | 2015 L’impac
TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage 31 | 2015 L’impact du contact entre les langues Créoles et français : Quelques différences dans la valence verbale Creoles and French: some differences in valency patterns Sibylle Kriegel Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/tipa/1448 DOI : 10.4000/tipa.1448 ISSN : 2264-7082 Éditeur Laboratoire Parole et Langage Référence électronique Sibylle Kriegel, « Créoles et français : Quelques différences dans la valence verbale », TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage [En ligne], 31 | 2015, mis en ligne le 22 décembre 2015, consulté le 26 mai 2020. URL : http://journals.openedition.org/tipa/1448 ; DOI : https://doi.org/ 10.4000/tipa.1448 Ce document a été généré automatiquement le 26 mai 2020. La revue TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Créoles et français : Quelques différences dans la valence verbale1 Creoles and French: some differences in valency patterns Sibylle Kriegel Introduction 1 Même si plus de 80% du lexique des langues créoles proviennent de la langue de base européenne respective, elles ont des systèmes linguistiques autonomes. Cette autonomie se manifeste surtout dans le domaine de la morphosyntaxe. Afin d’illustrer les différences entre les créoles et leurs langues de base européennes, on donne souvent l’exemple du marquage temps-mode-aspect. Cette contribution abordera un domaine moins étudié, celui de la valence verbale, et illustrera quelques différences entre le français et deux créoles français de l’océan Indien, les créoles mauricien et seychellois, variétés très proches ayant une histoire largement mais pas entièrement commune. 2 L’Ile Maurice est colonisée par la France à partir de 1721. Avec l’essor de l’industrie de la canne à sucre, les colons importent des populations serviles surtout de Madagascar, puis d’Afrique de l’Est. L’existence d’une langue créole est attestée dès 1773, donc seulement une cinquantaine d’années après le début de la colonisation. Les Seychelles sont peuplées essentiellement par des colons mauriciens et leurs esclaves à partir de 1770. Suite aux guerres napoléoniennes, les deux îles ou archipels passent sous la domination de la couronne anglaise. Les Britanniques abolissent l’esclavage en 1835, ce qui n’a pas le même impact à l’Ile Maurice qu’aux Seychelles. Alors que les colons mauriciens compensent le manque de main d’œuvre en engageant des travailleurs sur le sous-continent indien (travail engagé), la population seychelloise augmente grâce à l’arrivée de main d’œuvre d’Afrique de l’Est. Après avoir été colonies anglaises pendant plus de cent cinquante ans, les deux pays sont aujourd’hui indépendants. Aux Seychelles, le créole est première langue nationale avant l’anglais et le français. L’Ile Maurice est un pays plurilingue où l’anglais est langue officielle de facto, le français y Créoles et français : Quelques différences dans la valence verbale TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage, 31 | 2015 1 est considéré comme la langue de la culture et les registres oraux sont dominés par le créole. 1. L’expression du réfléchi 3 Pendant la créolisation, les pronoms personnels clitiques réfléchis des langues romanes ont disparu. Dans les langues romanes, les formes réfléchies ou pronominales couvrent un domaine fonctionnel très large et très hétérogène. Ainsi, le pronom personnel clitique réfléchi 3 personne ‘se’ du français (et ses équivalents pour les autres personnes qui ne se différencient pas des pronoms personnels clitiques objet : ‘me’, ‘te’, ‘nous’, ‘vous’) assume des fonctions très diverses qui vont de la co-référence entre le sujet et l’élément réfléchi jusqu’à l’expression de la diathèse passive. La disparition de ‘se’ (ainsi que ‘me’, ‘te’ etc.) dans les créoles français a fait l’objet d’un bon nombre d’études (pour un survol de la littérature voir Kriegel 1996). Il a été remplacé par plusieurs nouvelles techniques dans les cas où il est nécessaire d’un point de vue fonctionnel, notamment quand le pronom personnel réfléchi a le statut d’actant et ne correspond pas à une entrée dans le dictionnaire. Dans la synchronie de la majorité des créoles à base française, il existe deux techniques principales. Comme l’illustrent les exemples suivants du créole seychellois, les deux techniques sont parfois attestées au sein d’un seul et même texte (voir les exemples (1) et (3)) : 4 I. verbe + (déterminant possessif) + ‘corps’ (ou ‘tête’, p.ex. en créole haïtien) 5 (1) créole seychellois Prezidan James Michel in met son lekor azour Président nom propre COMPL mettre REFL à jour avek bann devlopman avec PL développement […] 6 (Seychelles’ Nation 22/10/2012, 1) Le Président James Michel „s’est mis à jour“/s’est familiarisé avec les développements […] 7 (2) créole seychellois Mon demann mon lekor be kot zot ale? 1SBJ.SG demander REFL ben où 3.SBJ.PL aller 8 (enregistrement aux Archives des Seychelles, octobre 2012) Je me suis demandé, ben, où sont-ils allés ? 9 II. verbe + pronom personnel objet + (intensificateur) 10 (3) créole seychellois Créoles et français : Quelques différences dans la valence verbale TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage, 31 | 2015 2 I ti osi dir ki in met li azour avek bann proze 3.SBJ.SG PST aussi dire COMP COMPL mettre REFL à jour avec PL projet 11 (Seychelles’ Nation 22/10/2012, 1) Il a aussi dit qu’il s’était « mis à jour »/ familiarisé avec les projets. 12 Les deux techniques ne sont pas attestées en français moderne. Dans cette contribution, je m’intéresse à la technique I qui emploie le déterminant possessif et le concept du corps humain dans l’expression du réfléchi : contrairement au créole mauricien où l’emploi du concept du corps humain reste limité à quelques contextes précis (voir Corne 1989, Kriegel 1996, Mufwene 2000) elle s’avère productive en créole seychellois. 13 Il s’agit d’un processus de grammaticalisation répandu dans des langues n’ayant aucun lien de parenté avec les créoles étudiés dans cette contribution (p.ex. le basque, le sanscrit, l’arabe) tout comme dans un grand nombre de langues créoles à base lexicale diverses et de langues africaines (Heine & Kuteva 2005 : 60). Même de façon tout à fait intuitive, on peut concevoir que le concept qui désigne le corps humain ou une partie du corps humain est prédestiné à fournir le matériau pour constituer une marque du réfléchi. Il s’agit donc d’abord d’une tendance universelle qui se déploie dans bon nombre de langues. Cependant, nous sommes en mesure de déterminer d’autres facteurs qui entrent probablement en jeu dans cette évolution en créole seychellois (et mauricien), notamment le contact de langues. Des modèles potentiels pour la construction réfléchie avec le concept du corps humain peuvent être retrouvés dans plusieurs langues ayant participé à la situation de contact dans l’océan Indien lors de la formation des créoles : Présence d’un modèle dans différentes variétés de français 14 Même si elle est marginale, la présence de formes réfléchies en ‘corps’ est connue en ancien et moyen français (voir ex. dans Rheinfelder 1967 : 162) et elle est aussi attestée pour des variétés impliquées dans le contexte de la créolisation comme le constate Chaudenson (2003 : 393) : « (…) le FEW (II/2, 1212) montre que cette construction (…) apparaît encore, à l’époque moderne, dans les parlers de l’Ouest français qui sont particulièrement intéressants dans notre approche ». Présence de modèles dans les substrats 15 Une construction réfléchie impliquant le concept du corps humain est notamment attestée en malgache, langue qui a participé à la genèse des créoles de l’océan Indien (voir Carden 1993 pour cette éventuelle influence substratique en créole mauricien)2. 16 Contrairement à d’autres analyses qui favorisent exclusivement un modèle substratique ou « superstratique », je pense que les deux ne s’excluent pas. Tout au contraire, il pourrait s’agir d’une convergence au sens de Kriegel & Ludwig & Pfänder (soumis) qui définissent la convergence comme étant un processus qui décrit le choix et le renforcement mutuel de traits linguistiques de langues en contact que les locuteurs perçoivent comme étant similaires (perceived similarity). 17 Pour conclure, on observe donc la perte des clitiques réfléchis du français dans les créoles français et leur remplacement en cas d’une nécessité fonctionnelle, entre autres, par le concept qui désigne le corps humain. Le choix de cette technique • • Créoles et français : Quelques différences dans la valence verbale TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage, 31 | 2015 3 s’expliquerait par une interaction entre différents facteurs, à savoir une tendance universelle de grammaticalisation ainsi que par l’existence de modèles « super »- et, substratiques qui convergent pour donner lieu à l’émergence des formes réfléchies avec le déterminant possessif +lekor. On pourrait établir un lien entre le fait que la structure est plus répandue en créole seychellois qu’en créole mauricien et le passage à l’écrit accéléré du créole seychellois. 2. La diathèse passive en ganny 18 Tout comme les pronoms personnels clitiques réfléchis, le verbe ‘être’ a largement disparu dans les créoles français. Parmi ses multiples fonctions en français, il s’utilise comme auxiliaire du passif. 19 (4) La maison est construite. 20 Dans le cas non marqué d’une construction active et transitive le patient prend la place de uploads/s3/ creoles-et-francais-quelques-differences-dans-la-valence-verbale-pdf.pdf
Documents similaires
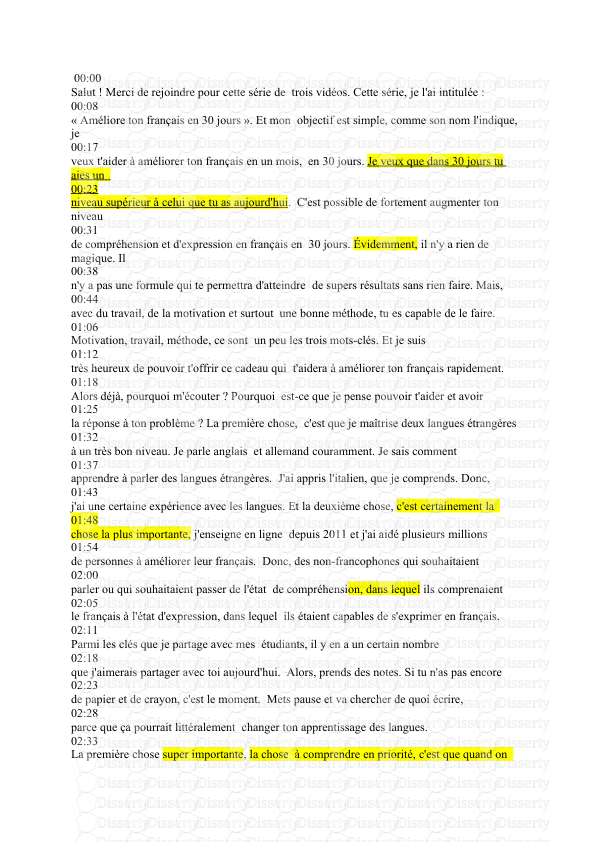









-
43
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 03, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2779MB


