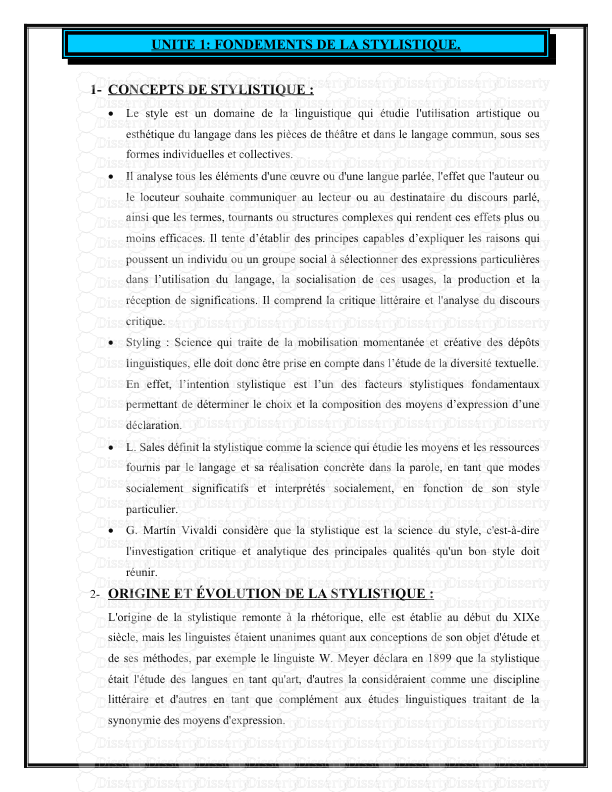UNITE 1: FONDEMENTS DE LA STYLISTIQUE. 1- CONCEPTS DE STYLISTIQUE : Le style
UNITE 1: FONDEMENTS DE LA STYLISTIQUE. 1- CONCEPTS DE STYLISTIQUE : Le style est un domaine de la linguistique qui étudie l'utilisation artistique ou esthétique du langage dans les pièces de théâtre et dans le langage commun, sous ses formes individuelles et collectives. Il analyse tous les éléments d'une œuvre ou d'une langue parlée, l'effet que l'auteur ou le locuteur souhaite communiquer au lecteur ou au destinataire du discours parlé, ainsi que les termes, tournants ou structures complexes qui rendent ces effets plus ou moins efficaces. Il tente d’établir des principes capables d’expliquer les raisons qui poussent un individu ou un groupe social à sélectionner des expressions particulières dans l’utilisation du langage, la socialisation de ces usages, la production et la réception de significations. Il comprend la critique littéraire et l'analyse du discours critique. Styling : Science qui traite de la mobilisation momentanée et créative des dépôts linguistiques, elle doit donc être prise en compte dans l’étude de la diversité textuelle. En effet, l’intention stylistique est l’un des facteurs stylistiques fondamentaux permettant de déterminer le choix et la composition des moyens d’expression d’une déclaration. L. Sales définit la stylistique comme la science qui étudie les moyens et les ressources fournis par le langage et sa réalisation concrète dans la parole, en tant que modes socialement significatifs et interprétés socialement, en fonction de son style particulier. G. Martín Vivaldi considère que la stylistique est la science du style, c'est-à-dire l'investigation critique et analytique des principales qualités qu'un bon style doit réunir. 2- ORIGINE ET ÉVOLUTION DE LA STYLISTIQUE : L'origine de la stylistique remonte à la rhétorique, elle est établie au début du XIXe siècle, mais les linguistes étaient unanimes quant aux conceptions de son objet d'étude et de ses méthodes, par exemple le linguiste W. Meyer déclara en 1899 que la stylistique était l'étude des langues en tant qu'art, d'autres la considéraient comme une discipline littéraire et d'autres en tant que complément aux études linguistiques traitant de la synonymie des moyens d'expression. Ce n'est qu'en 1954 que P. Guiraud dans La Stylistique admet l'existence d'une stylistique linguistique. Cet auteur affirme que l'objectif du même objectif est la forme des énonciations linguistiques, du point de vue de la sélection du moyen d'expression et de son utilisation facultative (la sélection ou l'élection de moyens d'expression compris comme le style adopte un être déterminé en faisant une déclaration). Pour C. Bally, les faits de style sont liés au monde de la parole, la variable dans l’utilisation du langage. Cette variation est conçue comme un choix parmi les possibilités d’une langue, comme une possibilité d’innovation à des fins affectives et expressives. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, la linguistique s'est enrichie, les linguistes se concentrant sur l'étude de la langue en tant que système. Styling, sociolinguistique et pragmatique, qui orientent les études linguistiques un peu au-delà de la prière ils utilisent la théorie de l'analyse textuelle, qui traite du message transmis par l'expéditeur au destinataire. Aristote était soucieux d'analyser le langage figuré dans sa rhétorique et en partie dans sa poétique. Les érudits hellénistiques regroupés à Alexandrie ont dû étudier le langage figuré pour bien comprendre et commenter les poèmes d'Homère qu'ils avaient l'intention d'éditer. D'autre part, les Romains ont étudié la langue littéraire également dans la rhétorique à Herennio, et Quintiliano lui a consacré une certaine place dans ses institutions oratoires. La stylistique était initialement considérée comme une branche de la rhétorique et de la critique littéraire. Au cours du Moyen Âge, un modèle stylistique reflétant la division tripartite des domaines en plébéiens, nobles et ecclésiastiques fut établi : la "roue de Virgile" ou Rota Virgilii, ainsi appelée parce que le poète romain cultivait les trois dans sa poésie (Bucólicas, Geórgicas, épopée Eneida) I. Style sublime : • a) Statut social des personnages : militaires, chefs de guerre. • b) Personnages héroïques typiques : Hector, Ajax. • c) Animal associé à de tels personnages : le cheval. • d) Arme : l'épée. • e) Radio de son champ d’action : la ville ou le camp. • f) Arbre symbolique ou significatif : le laurier ou le cèdre. II. Style moyen : • a) Statut social : agriculteur. • b) Caractères typiques : Triptolemo, Celio. • c) Animal associé : le bœuf. • d) Arme ou ustensile correspondant : la charrue. • e) Lieu d’action : le terrain. • f) Arbre important : le pommier. III. Style humble : • a) Statut social : pasteur libre (pastor ociosus). • b) Personnages représentatifs : Títiro, Melibeo. • c) Animal associé : le mouton. • d) Arme ou ustensile : le personnel. • E) Lieu : la dehesa. • f) Arbre : le hêtre. Au XVIIIe siècle, Buffon, dans l’illustration française, affirmait que « le style, c’est l’homme »: c’est-à-dire ce qui est individuel, personnel ou subjectif dans son écriture littéraire. Au 19ème siècle, cette vision subjective du style a été développée à travers le romantisme. Une vision existentielle et historiciste affirmait que l'œuvre littéraire devait refléter l'expérience de vie des individus et que l'œuvre ne pouvait être ni parfaite ni achevée, mais ouverte à l'évolution pour être réellement vivante: Humboldt affirmait que le monde intérieur et créatif, ergon, manifesté par le langage, energeia; Ce postulat a nourri l'idéalisme linguistique allemand et ses auteurs, Wundt, Hugo Schuchardt, Benedetto Croce, Karl Vossler et Leo Spitzer, ont défendu une conception purement individuelle du langage, centrée sur l'analyse de l'energeia ou pouvoir créatif cristallisé dans le langage littéraire particulier d'un auteur ou d'une époque. Cependant, dans l’enseignement universitaire, l’essentiel était d’analyser le style de manière unitaire et atomisée, en raison de la grande influence encore exercée par la rhétorique classique. Le développement des théories du formalisme russe (dont les contributions incluent la notion de désautomatisation) et la découverte de la fonction poétique par Roman Jakobson et la théorie de la déviation étaient très importants à cet égard. Les grands théoriciens de la rhétorique ont fait d'importants progrès en collectant et en codant tout le matériel de la rhétorique classique, comme l'a fait par exemple Heinrich Lausberg. Au XXe siècle, la stylistique était dominée par trois courants principaux : Stylistique descriptive , principalement de dimension française, inspirée du structuralisme de Ferdinand de Saussure et développée par Charles Bally. La stylistique génétique ou générative , qui prolonge la stylistique de l'idéalisme allemand et provient de Benedetto Croce. Au vingtième siècle, il continua à se développer avec les travaux de Damaso Alonso et Amado Alonso, héritiers également de la tradition philologique de Ramón Menendez Pidal ; certains l'appellent "style individuel" ou "critique stylistique" ou "science de la littérature", selon Dámaso Alonso. Stylistique fonctionnelle ou stylistique structurelle . Eugenio Coseriu le soulève en ajoutant le concept de norme à la dichotomie de Saussure entre langage et parole et en introduisant le rôle opérationnel de la fonction poétique selon Roman Jakobson. La déviation de la norme joue un rôle créateur dans la littératie et considère en fait le style comme une déviation par rapport à la norme dans ce qui a un aspect créatif. Il est développé aux États-Unis et compte parmi ses érudits Michel Riffaterre et S. P. Levin. 3- CONCEPTS DE TEXTES : Il est appelé texte à l'ensemble des phrases et des mots cohérents et ordonnés qui permettent d'être interprétés et de transmettre les idées d'un auteur (locuteur ou diffuseur). Le mot texte est d'origine latine textus qui signifie « tissu ». Le texte est l'unité supérieure de communication et la compétence organisationnelle du locuteur. Son extension est variable et correspond à un tout compréhensible ayant un but communicatif dans un contexte donné. Le caractère communicatif, pragmatique et structurel permet leur identification. Originaire du latin textus, le mot texte décrit un ensemble d'énoncés permettant de donner un message cohérent et ordonné, que ce soit par écrit ou par le mot. C'est une structure composée de signes et d'une écriture spécifique qui donne de l'espace à une unité significative. Un texte est l'expression orale ou écrite d'un acte de communication, c'est-à-dire de mots qui ensemble forment un message, qui ont une cohérence, voire un but. Par "oral" ou "écrit", nous entendons que non seulement les textes sont écrits, mais aussi les choses qui sont dites. Un texte est une composition de signes encodés dans un système d'écriture qui forme une unité de sens. C'est aussi une composition de caractères imprimables (avec graphème) générés par un algorithme de chiffrement qui, bien qu'ils n'aient aucun sens pour personne, peuvent être déchiffrés par leur destinataire d'origine. En d'autres termes, un texte est un réseau de signes ayant une intention de communication qui acquiert un sens dans un contexte donné. 4- CLASSEMENT DES TEXTES SELON LE BUT DE L’AUTEUR. FRAGMENTS EXEMPLES DE CHACUN. Textes argumentatifs : Organisez les informations de manière claire et structurée afin que le destinataire puisse effectuer une action spécifique, car elles ont un caractère normatif ou pédagogique. Ils organisent des informations temporairement, principalement. Ils essaient de convaincre le destinataire uploads/s3/ estilistica-1.pdf
Documents similaires










-
90
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 31, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6274MB