Ficus carica Pour les articles homonymes, voir Figuier (homonymie). Ficus caric
Ficus carica Pour les articles homonymes, voir Figuier (homonymie). Ficus carica Figuier Classification Règne Plantae Sous-règne Tracheobionta Division Magnoliophyta Classe Magnoliopsida Sous-classe Hamamelidae Ordre Urticales Famille Moraceae Genre Ficus Nom binominal Ficus carica L., 1753 Classification phylogénétique C lassification phylogénétique Ordre Rosales Famille Moraceae Statut de conservation UICN LC : Préoccupation mineure Ficus carica L. aux noms vernaculaires Figuier, Figuier comestible1 ou Figuier commun2, est un arbre fruitier de la famille des Moracées qui donne des fruits comestibles appelés figues. On l'appelle plus rarement Figuier de Carie en référence à la cité antique en Asie mineure ou « Arbre à cariques »3. Le Figuier comestible est l'emblème du bassin méditerranéen, où il est cultivé depuis des millénaires. C'est le seul représentant européen du genre Figuier qui regroupe près de six cents espèces, la plupart tropicales. Le figuier mâle, parfois appelé « Figuier sauvage », qui ne donne pas de fruits comestibles, est aussi appelé « Caprifiguier » (caprificus, c'est-à-dire « Figuier de bouc »). Sommaire [masquer] 1 Étymologie 2 Histoire 3 Distribution 4 Description o 4.1 Reproduction o 4.2 Pollinisation 5 Culture o 5.1 Taille o 5.2 Multiplication o 5.3 Ennemis et maladies o 5.4 Résistance au froid 6 Usages o 6.1 Utilisation du suc de figuier 6.1.1 Antiquité 6.1.1.1 Hébreux 6.1.1.2 Grecs 6.1.1.3 Romains 6.1.2 Moyen Âge et époque moderne 6.1.3 Époque contemporaine 6.1.3.1 Culture populaire 7 Bibliographie 8 Notes et références o 8.1 Articles connexes o 8.2 Liens externes Étymologie[modifier | modifier le code] Le nom générique Ficus est le nom latin du figuier. L'adjectif spécifique carica signifie originaire de la Carie, ancienne province d'Asie mineure d'où le figuier est supposé provenir. Histoire[modifier | modifier le code] Depuis l’origine des hominidés les ficus sont une source alimentaire et médicinale : les bourgeons, les feuilles et les fruits sont récoltés et transformés. C’est toujours le cas dans le Yunan chinois [archive] Ficus carica est un des plus anciens fruitiers domestiqué. Mordechai E. Kislev [archive] et al montrent une paleo-domestication par sélection intentionnelle de figuiers parthenocarpiques (sans fécondation) au 12éme millénaire BCE, autrement dit au début du néolithique, dans la vallée du Jourdain. L'iconographie montre des figuiers cultivés en Mésopotamie et en Egypte antique, ils sont en général conduit en gobelet sur tronc court. Caton l'Ancien dans De Agri Cultura mentionne des cultivars "d'Afrique, de Cadix, de Sagonte", "la télane noire". Le figuier est mentionné dans la Bible 4 ; au IIIe siècle av. J.-C., le philosophe péripatéticien Théophraste, au Livre V de son ouvrage Histoire des Plantes, recommande le figuier pour les échafaudages, comme pour tout support vertical. Distribution[modifier | modifier le code] Figuier. Cette espèce semble originaire d'une vaste zone de climat tempéré chaud, englobant le pourtour du bassin méditerranéen jusqu'à l'Asie centrale (Azerbaïdjan, Afghanistan, Iran, Pakistan). La culture de l'espèce s'est propagée dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde. Le figuier s'est plus ou moins naturalisé en Europe et en Amérique du Nord. Description[modifier | modifier le code] Figuier bicolore. Le figuier est un petit arbre, le plus souvent de trois à quatre mètres de haut - certaines variétés peuvent cependant atteindre 10 mètres de hauteur pour dix mètres de périmètre en conditions favorables (zone peu gélive, sol frais et fertile) - au tronc souvent tortueux, au port souvent buissonnant. Toutes les parties de la plante (rameaux, feuilles, fruits) contiennent un latex blanc et irritant. La sève de figuier contient des furocoumarines responsables d’irritation, de phototoxicité voire de photoallergie. Les feuilles sont caduques, rugueuses, finement velues, assez grandes (jusqu'à 25 cm de long). Elles sont munies d'un long pétiole et d'un limbe palmatilobé, profondément divisé en trois à sept lobes crénelés (le plus souvent cinq) de forme variable, séparés par des sinus arrondis. Les fleurs du figuier ont de nombreuses formes (voir reproduction). À maturité, les fruits, ou figues, sont selon les variétés de couleur verdâtre, jaune, marron-rouge ou violet plus ou moins foncé, parfois bicolore ou strié. Pour la production, seule les variétés femelles et surtout parthénocarpiques sont cultivées, elles peuvent être bifères ou unifères plus rarement trifères [4] [archive] : Les unifères fructifient une seule fois en fin d'été. Les figues apparaissent sur le bois de l'année à l'aisselle des feuilles. Seules mûrissent les premières qui se trouvent en partie basse du rameau à maturité. Les figues apparues plus tardivement, se trouvant donc en partie haute des rameaux de l'année, avortent lorsque les températures baissent. Les bifères donnent deux récoltes par an, une au printemps ou au début de l'été, l'autre en fin d'été ou à l'automne selon la variété et le climat. Les figues apparues tardivement en position apicale sur les rameaux de l'année précédente ne chutent pas et passent l'hiver à l'état de petits bourgeons pour reprendre leur développement dès que la température devient favorable. Puis sur le bois de l'année, les figues se développent normalement. Les trifères dites aussi cimaruoli. Les figues apparues en partie haute des rameaux de l'année continuent à se développer normalement en fin d'été pour arriver à maturité très tardivement et parfois seulement au printemps suivant. Cela n'est possible que sous un climat très chaud comme celui du sud de l'Italie ou de l'Espagne. Les variétés bifères sont à réserver aux zones les plus chaudes (pas de températures inférieures à -12°C en hiver et pas trop de gelées tardives au printemps). En effet, la culture de variétés bifères dans des zones trop septentrionales verraient la première production brûlée par les gels de printemps et la seconde n'aurait pas le temps d'arriver à maturité avant les premiers gels d'automne. La maturité des variétés unifères telles que Ronde De Bordeaux ou Pastilière sont souvent plus précoces que la deuxième vague des bifères et arrivent à produire sans problème pendant la plus courte période hors gel des zones nordiques. Reproduction[modifier | modifier le code] Comme tous les angiospermes, les fleurs de figuiers permettent la pollinisation ; le fruit (figue), qui est en fait une infrutescence, assure la dispersion des graines. Les figuiers sauvages ont pour particularité d'avoir une reproduction dépendant d'une symbiose avec un insecte : le blastophage (sauf pour les variétés parthénocarpiques dites parfois autofertiles). Cet insecte assure la pollinisation des fleurs femelles. En retour, le figuier abrite et nourrit l'insecte, dont le cycle se déroule quasi entièrement dans la plante. Les fleurs sont regroupées en une inflorescence d'un type particulier appelée sycone ou figue. Ces inflorescences consistent en un réceptacle floral, charnu à maturité, refermé sur lui-même (conceptacle), à l'exception d'une minuscule ouverture (ostiole) à l'opposé du point d'insertion du pédoncule, d'une forme générale de petite poire, et qui contient plusieurs centaines de fleurs atrophiées. Le figuier est considéré comme une espèce dioïque bien que les deux types de figuiers soient morphologiquement hermaphrodites. La dioécie est seulement fonctionnelle. Dans le bassin méditerranéen, la quasi-totalité des sycones de caprifiguiers sont parasités par le blastophage, et ne donnent donc pas de figues comestibles. On peut donc dire que le caprifiguier est biologiquement bisexué, mais fonctionnellement mâle dans son aire de répartition traditionnelle. Les figuiers peuvent donc produire quatre types de fleurs variant selon leur sexe et le sexe de l'arbre qui les porte notamment au niveau du type de leur style (hétérostylie)5 : les figuiers dit mâles ou (caprifiguiers) portent : des fleurs mâles présentant 2 à 5 étamines autour d'un ovaire avorté, entourées de sépales. des fleurs femelles à style court (0,5 mm, brévistyles) sur un ovaire à un ovule, entouré de sépales. Le court style permet au blastophage de pondre. Les larves se développent en consommant les tissus de l'ovaire et l'insecte assure ainsi sa descendance mais cela empêche toute production de graine, la figue ne mûrira donc pas. Ce type de figuiers ne produit donc que des figues-pouponnières qui ne sont jamais comestibles. les figuiers dit femelles ou souvent cultivés ou domestiques portent : des fleurs mâles stériles à étamines non développées des fleurs femelles à style long (1,5 mm, longistyles) sur un ovaire à un ovule, entouré de sépales. Le long style ne permet pas au blastophage de pondre dans l'ovaire mais il peut polliniser la fleur pour la féconder, ce qui induit la maturation des figues comestibles qui contiennent donc des graines viables. Le figuier « femelle » est protogyne et produit essentiellement des fleurs femelles longistyles. Suivant les saisons et les cultivars, ces fleurs nécessitent la caprification pour fructifier, ou bien se développent en fruit par parthénocarpie même en l'absence du blastophage. En France, la majorité des figuiers cultivés est parthénocarpique et ne nécessite donc pas la présence de blastophages pour produire des fruits. Les graines présentes dans ces figues parthénocarpiques ne contiennent pas d'embryons. Les quatre types de fleurs du figuier donnent différents types de fruits (mamme, profichi, mammoni, fioroni, fichi) produits en trois générations distinctes voire plus si les conditions climatiques sont très favorables6. Les figuiers « mâles » donnent le type de figues suivant7 : uploads/s3/ ficus-carica 1 .pdf
Documents similaires
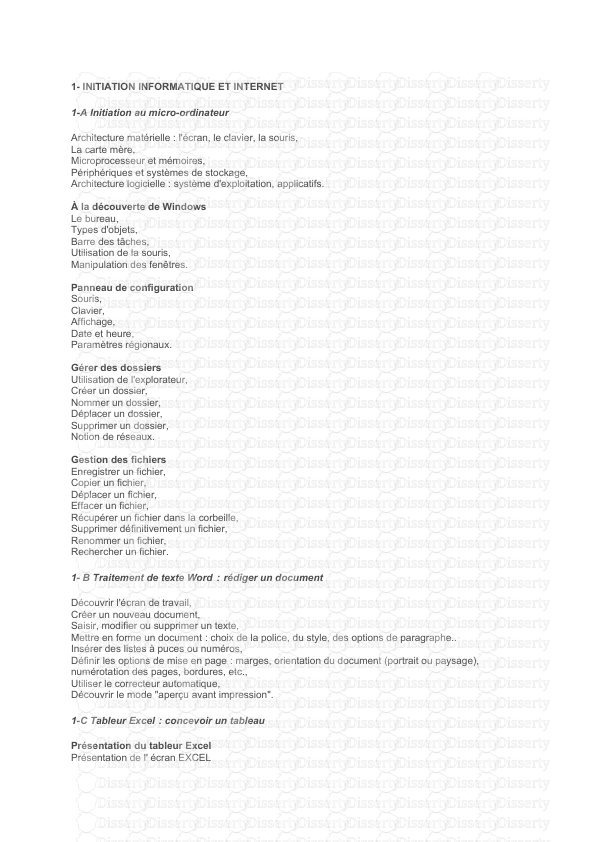









-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 11, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7463MB


