Accueil Numéros 10 Champs et contrechamps L ’atelier du regard La nouvelle revu
Accueil Numéros 10 Champs et contrechamps L ’atelier du regard La nouvelle revue du travail 10 | 2017 Genre(s) au travail Champs et contrechamps L’atelier du regard Sur un dessin ouvrier dans le Paris du XIXe siècle A looking workshop. Working class drawings in 19th century Paris El taller de la mirada. Sobre un dibujo obrero en el París del siglo XIX OLIVIER IHL https://doi.org/10.4000/nrt.3129 Résumés Français English Español Résumé : La sociologie visuelle gagnerait beaucoup à s’intéresser au monde du dessin et de la gravure, pas seulement à la photographie ou au film. Elle pourrait, ce faisant, faire de ce monde graphique plus accessible au monde populaire un espace de découverte et de savoir. C’est pour en convaincre le lecteur que cet article s’attache à ce type d’images, notamment à sa façon de capturer et mettre en scène certaines des transformations qui caractérisent le Paris du 19èmesiècle. Intitulé “Madame, madame, un sous-jupe à vendre”, l’un de ces dessins - une caricature de Louis Marie Bosredon (1815-1881)- est ici étudié comme un révélateur de changements sociaux et urbains. Du à un artiste ouvrier proche du socialiste Charles Fourier, il fut diffusé en décembre 1857. Un exemple qui illustre une méthode de recherche, celle qui en rompant avec la distinction stricte entre art et science fait du dessin ouvrier un moyen d’observation participante à part entière. Abstract : Visual sociology could benefit by taking a closer look at the world of drawings and engravings and not just photography or cinema. By so doing, it would make the graphic world more accessible to a wider audience and turn it into a real space for discovery and knowledge. This is the ambition underlying the present article, which focuses on images of a particular kind and notably the way in which some of the transformations affecting Paris in the 19th century were captured and depicted. Entitled Madame, madame, un sous-jupe à vendre (“Lingerie for sale”), a caricature drawn by Louis Marie Bosredon (1815-1881) is viewed here as a vehicle for revealing social and urban change. Drawn by a working class artist who was a supporter of the socialist Charles Fourier, it was first published in 1857. The research method used here deviates from any strict distinction between art and science in such a ways as to transform working class drawings into fully-fledged vehicles for participant observation. Resumen : La sociología visual ganaría más interesándose en el mundo del dibujo y del grabado, no solamente en la fotografía o en el filme. Al hacer esto, podría hacer de este mundo gráfico más accesible al mundo popular un espacio de descubrimiento y de saber. Para Français Portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales OPENEDITION Nos plateformes OPENEDITION BOOKS OPENEDITION JOURNALS HYPOTHESES CALENDA Bibliothèques et institutions OpenEdition Freemium Nos services OpenEdition Search convencer al lector, este artículo se vincula a este tipo de imágenes, sobre todo, a su manera de capturar y de poner en escena algunas de las transformaciones que caracterizan al París del siglo XIX. Titulado “Madame, madame, un sous-jupe à vendre”, uno de estos dibujos —una caricatura de Louis Marie Bosredon (1815-1881) — se estudia aquí como un revelador de cambios sociales y urbanos. Debido a un artista obrero cercano al socialista Charles Fourier, fue difundido en diciembre de 1857. Un ejemplo que ilustra un método de investigación, el que rompiendo con la distinción estricta entre arte y ciencia hace del dibujo obrero un medio de observación que participa de pleno derecho. Entrées d’index Mots-clés : sociologie visuelle, dessin ouvrier, Paris, xixe siècle Keywords: visual sociology, working class art, Paris, 19th century Palabras claves: sociología visual, dibujo obrero, París, siglo xix Texte intégral Figure n° 1 – Lithographie de Louis-Marie Bosredon, chez Lemercier, Paris, rue de Seine, 1857 BNF, Estampes et photographie : SNR – 3 (BOSREDON, M. L.), cliché pers. ACCUEIL CATALOGUE DES 558 REVUES OPENEDITION SEARCH Tout OpenEdition Une énigme graphique En se constituant en champ de recherche (Terrenoire, 2006), la sociologie visuelle s’est principalement intéressée à la photographie et au film. Elle a délaissé, en revanche, les pratiques de représentation graphique qui restent, du coup, largement à découvrir. Le dessin ouvrier constitue l’un de ses temps forts. Sa capacité à mettre en scène les transformations urbaines ou le règne de la marchandise dans une Europe en cours d’industrialisation en fait, il est vrai, une source précieuse. Intitulée « Madame, madame, une sous-jupe à vendre », la caricature de Louis Marie Bosredon (1815-1881) met en scène ces changements sociaux. Due à un graveur proche des idées de Charles Fourier, elle fut publiée par le célèbre imprimeur Lemercier en décembre 18571. On y voit deux enfants d’ouvrier, en blouse et chemise d’apprentis, s’amusant de la ressemblance du cintrage d’un tonneau avec la crinoline d’une grande bourgeoise tandis qu’un commis marchand fronce les sourcils devant ce qu’il perçoit comme une marque d’irrespect. 1 Que l’arrivée, au cœur de la capitale, des commerces « spécialistes en tout genre » (Dasquet, 1956, 35) soit raillée, le fait ne surprendra pas. Avec leurs vastes bâtiments, avec leurs nouvelles méthodes (prix fixe, expédition par tapis roulant, inflation d’objets publicitaires), ces enseignes ont bouleversé le monde de la boutique (Boudet, 1952, 400). Tant et si bien que nombre de dessinateurs ont tourné en dérision le triomphalisme de la Belle Jardinière ou du Bon Marché (Miller, 1987). On pense aussi à Alphonse Karr persiflant leurs procédés de vente et de travail dominés par « la passion désordonnée pour le paraître » (Le Voleur du 5 février 1845). En recomposant l’espace public, ces palais de la mode servirent d’emblèmes au capitalisme naissant (Sewell, 2010), des emblèmes tantôt décriés, tantôt encensés. 2 Mais comment s’assurer de la valeur de ces estampes et caricatures ? Comment les constituer en données de recherche ? Howard Becker distingue l’image sociale, celle qui a une fonction marchande ou artistique, et l’image du social dont la portée découle, elle, d’une capacité à capter les changements opérant dans la société (Becker, 1974). Une invitation à affiner la méthodologie permettant de traiter cette « information visuelle ». D’autant que, bien avant la photographie sociale ou l’avènement du documentaire (Maresca & Meyer, 2013 ; Garrigues, 2000), des « journalistes du crayon » ont mis en image les transformations du Paris haussmannien. Un dessin du social qu’il convient d’arracher aujourd’hui à une marginalité longtemps perpétuée par les techniques quantitatives et l’exclusivisme de l’écrit dans les sciences sociales (Grady, 2001). 3 L’une des difficultés essentielles consiste ici à objectiver l’intention à laquelle chaque « image du social » est indexée (Joly, 2004). Posons clairement la question : dénoncer l’appropriation bourgeoise des formes de vie urbaine, est-ce ce bien, dans ce cas, la volonté du dessinateur ? Cet article s’emploie à le vérifier. Il veut éclairer le lien qui attache une telle planche aux aspirations d’un artiste ouvrier comme Louis Marie Bosredon. Non pas pour renouer avec un contexte général, comme s’il ne s’agissait que d’« agrafer » ce dessin à un milieu social ou à une chronologie, mais bien pour explorer sa raison graphique. Une expression qui doit être entendue, non pas au sens de Jack Goody (1979), celui de sa transcription écrite, mais au sens matériel du terme, à savoir les circonstances dans lesquelles, concrètement, cette estampe a pu être « prise » : référents professionnels, localisation géographique, environnement familial, trajectoire éditoriale. Une voie d’enquête qui conduit à restituer l’image à sa dimension première, celle d’un objet visuel destiné à former le regard de nouvelles générations de graveurs. 4 Comment déchiffrer le langage visuel dans lequel s’inscrit la caricature de Bosredon ? C’est évidemment toute la difficulté de penser en image. Pour l’historien des idées, la précaution n’est pas de mise. Le dessin, même ancré dans le passé, est réputé dépendre 5 Figure n° 2 – « Honoré Daumier, Plus que ça d’ballon... excusez ! » d’une intention conceptuelle. Autrement dit, de l’idée générale à laquelle l’image paraît à nos yeux venir se soumettre. D’où, par exemple, l’assurance de Jean Laran et Jean Adhémar : l’image de Bosredon serait « une caricature sur les crinolines » (1942, 81). Lancée par l’impératrice Eugènie, la « reine de la mode » ou « la Comtesse Crinoline » (Dolan, 1994, 24), cette mode servirait à contester le régime de Napoléon III. À leur tour, les historiens de la caricature l’ont fait valoir. Si la Poire symbolisa Louis- Philippe pendant la monarchie de Juillet, la crinoline désigna Napoléon III en offrant un moyen de contourner la censure (Farwell, 1994). En 1856, Charles Vernier publia, dans ce but, une série de caricatures sous le titre Crinolinomanie. L’ensemble comprenait des œuvres signées Cham, Jean Marcelin, Charles Bertall, Felix Nadar, ou Daumier. L’année suivante, c’est le publiciste Philippe Busonî qui mena campagne sur le même thème dans L’Illustration. Comment savoir toutefois si Bosredon participe de cette stratégie graphique ? 6 Sa biographie ne laisse guère de traces d’une défiance contre le régime de Louis- Napoléon Bonaparte. Au contraire, comme une partie importante de socialistes, au lendemain uploads/s3/ l-x27-atelier-du-regard.pdf
Documents similaires








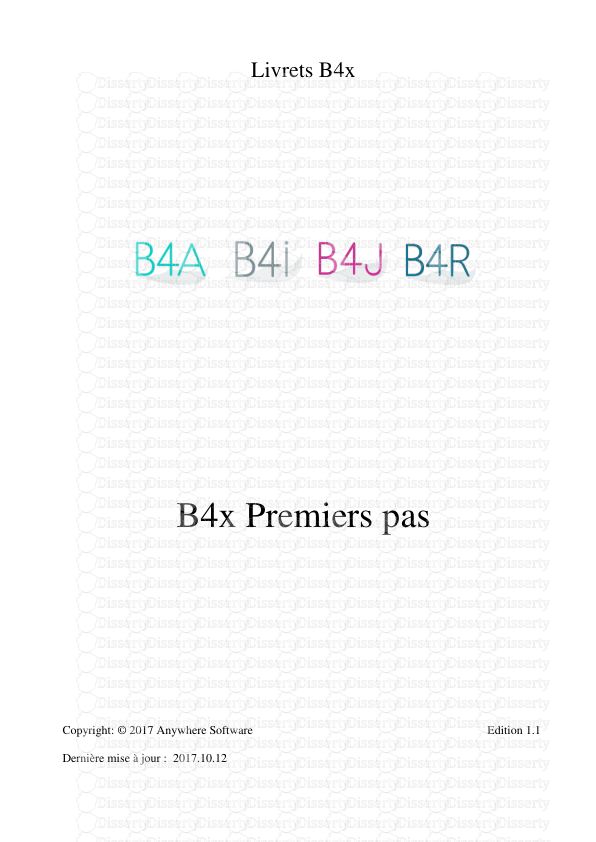

-
73
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 13, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.4013MB


