Retours d’expériences HMONP habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son n
Retours d’expériences HMONP habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre 2 HMONP Cette étude a été réalisée pour l’Ordre des architectes dans le cadre d’un atelier de la thématique formation du CNOA, composé de conseillers nationaux, de conseillers régionaux et de présidents de Conseils régionaux de l’Ordre : Jean-Mathieu COLLARD, Dominique TESSIER, Annicka JULIEN, Isabelle LATAPPY, Frédéric SKARBEK, Victor-John VIAL-VOIRON et Bérengère PY avec la participation d’Olivier Chadoin, Docteur en sociologie, enseignant- chercheur du LET - Laboratoire Espaces Travail Editeur : CNOA Coordination : Hien TRAN, chargée de mission formation Maquette : Balthazar Editing Mise à jour : juin 2012 HMONP 3 Sommaire Introduction...........................................................................................................................................................6 Caractéristiques générales des architectes ayant répondu. ...............................................................7 Des professionnels expérimentés..................................................................................................................7 Lieux..........................................................................................................................................................................8 Types de contrats.................................................................................................................................................9 Relations entre acteurs. ..................................................................................................................................10 Durée......................................................................................................................................................................10 Grille de suivi de la mise en situation. ......................................................................................................11 Jurés. .......................................................................................................................................................................12 Tuteurs. ..................................................................................................................................................................12 L’évaluation et ses outils...............................................................................................................................13 Une faible mobilité des jurés.......................................................................................................................14 Participation des directeurs d’études et tuteurs ...............................................................................16 Ajournements de candidats à l’issue du jury........................................................................................16 Insertion des A.D.E. titulaires de l’habilitation. ...................................................................................18 Le regard des tuteurs sur les impétrants. ...............................................................................................19 La VAE ou dispense de mise en situation professionnelle..............................................................20 Quelles perspectives ?. .....................................................................................................................................21 Conclusion ..........................................................................................................................................................23 Cahier statistique..............................................................................................................................................24 4 HMONP L’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre (H.M.O.N.P .) a été créée par décret en juin 2005 dans le cadre de la réforme des études d’architecture conduisant à la structure européenne dite LMD (Licence-Master-Doctorat). Cette habilitation, spécifique au droit français, ouvre à ses titulaires la possibilité de porter le titre d’architecte en s’inscrivant à l’Ordre, et d’exercer la maîtrise d’œuvre dans le cadre prévu par la loi du 3 janvier 1977. La réforme des études d’architecture étant appliquée depuis 2005 et, le DPLG n’étant plus délivré depuis 2007, une première génération d’étudiants a réalisé le nouveau cursus complet d’études au sein des écoles nationales supérieures d’architecture. Une enquête a été réalisée par le Conseil national de l’Ordre des architectes auprès d’un échantillon d’architectes, membres de jurys et tuteurs, ayant participé au dispositif H.M.O.N.P . au cours des cinq dernières années dans les différentes écoles du territoire français. L’analyse des réponses a été réalisée avec l’appui d’Olivier Chadoin, sociologue. Cette étude balaie toutes les étapes et les points clés qui jalonnent le parcours H.M.O.N.P . La volonté du Conseil national de l’Ordre des architectes est de mieux appréhender ce parcours, faisant le lien entre la formation initiale dispensée au sein des écoles d’architecture et l’inscription au tableau permettant l’exercice de la profession d’architecte en son nom propre. C’est sur l’expérience des architectes que sont basées les observations et analyses de ce document, qu’ils soient tuteurs, recevant dans leur agence des titulaires du diplôme d’État d’architecte, et architectes jurés, désignés pour siéger lors du jury final menant à la H.M.O.N.P . Cette étude met donc en avant des points forts du dispositif et des pratiques, elle illustre également des faiblesses et des dysfonctionnements dans la mise en œuvre de la H.M.O.N.P . Elle permet de mieux comprendre ce parcours du point de vue des professionnels, à travers leurs rôles de tuteurs ou de jurés. Lionel Carli, Président HMONP 5 Introduction Lors du passage de l’enseignement de l’architecture à la structure universitaire européenne dite L.M.D. ou 3/5/8 (Licence en 3 ans, Master en 2 ans, et Doctorat en 8 ans), la réforme des études d’architecture a créé l’Habilitation à la Maîtrise d’œuvre en son Nom Propre. On distingue donc désormais les titulaires d’un Diplôme d’État d’Architecte (les A.D.E. : architectes diplômés d’État) et les titulaires de la H.M.O.N.P . Les seconds sont les seuls à avoir la possibilité de : s’inscrire au Tableau de l’Ordre des architectes ; porter le titre d’architecte ; établir un projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire. Les premiers décrets datent de 2005. Les candidats à la H.M.O.N.P . sont formés et habilités depuis 2007. La première génération d’étudiants arrivant à la fin de leur cursus initial, menant au grade de master, s’est ainsi présentée à la H.M.O.N.P . La profession, à travers son Ordre, mais également ses syndicats, avait souligné les enjeux liés à la séquence professionnalisante (cf. livre blanc 2004). En effet, disposer de la H.M.O.N.P . permet à ses titulaires d’endosser les responsabilités personnelles prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 1977, à savoir : n La possibilité de s’inscrire au Tableau de l’Ordre des architectes et porter le titre. n La capacité d’établir un projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. Dans ce contexte, le Conseil national a souhaité initier un bilan de la réforme des études et de la mise en œuvre de la H.M.O.N.P ., en menant une enquête auprès : n des architectes désignés par l’Ordre pour siéger au sein des jurys H.M.O.N.P . 95 confrères ont accepté de nous répondre. n et des architectes ayant encadré des mises en situation professionnelle. 92 confrères ont participé à cette enquête. 6 HMONP Caractéristiques générales des architectes ayant répondu C’est dans le réseau ordinal que se situe le vivier des architectes désignés par les Conseils régionaux de l’Ordre pour siéger dans les jurys H.M.O.N.P . : 6 sur 10 sont conseillers ordinaux ou anciens conseillers ordinaux. La répartition de la population ayant répondu par mode d’exercice montre une répartition assez proche de la réalité statistique du monde des agences d’architecture avec plus de la moitié des professionnels exerçant en libéral1. Toutefois on note que le nombre d’associés (chez les tuteurs comme chez les jurés) est bien supérieur à celui 1 CNOA, La profession en chiffres, www.architectes.org des inscrits à l’Ordre sous ce statut (32 % en 20092). Comme on le verra plus après, c’est là l’indice d’un engagement fort des agences les plus structurées dans l’accueil régulier d’A.D.E. en mise en situation professionnelle. Voir le Cahier statistique ● ● Graphique 1, page 24 ● ● Tableau 2, page 25 2 CNOA Des professionnels expérimentés Les jurés et tuteurs sont le plus souvent des professionnels qui disposent d’une expérience professionnelle supé rieure à 10 ans. Sur la base du nombre de participations à des jurys ou du nombre d’accueils d’A.D.E. en mise en situation, nous avons une population qui se caractérise par une bonne expérience de la H.M.O.N.P . Des “jurés habitués” Les jurés sont à plus de 90 % des architectes ayant plus de 10 ans d’expérience. De 2007 à 2010, les jurés interrogés ont en moyenne participé à 3 sessions de jury. En 2010, le nombre moyen de candidats évalués est d’un peu plus de 10 par jury. HMONP 7 > 10 ans 90 entre 1 à 5 ans 3 > 5 ans 2 Graphique A : Durée de l’expérience professionnelle des jurés et tuteurs Jurés Tuteurs > 10 ans 79 entre 1 à 5 ans 4 > 5 ans 9 Des « tuteurs réguliers » La majorité des tuteurs (plus de 50 % en 2010) interrogés reçoit 1 A.D.E. en MSP . Entre 2007 et 2010, les tuteurs qui accueillent deux A.D.E. représentent entre 5 et 10 %. Là encore ce sont les agences qui ont le plus d’expérience qui sont les plus représentées (86 %). L’accueil des candidats est continu dans 20 % des structures et discontinu dans les autres. • Les jurés et tuteurs sont donc des familiers de la H.M.O.N.P . Voir le Cahier statistique ● ● Tableau 3, page 26 ● ● Tableau 4, page 26 ● ● Tableau 5, page 27 Lieux La mise en situation professionnelle se réalise majoritairement dans des agences structurées, relativement à la démographie du secteur ; actuellement, la moyenne en France par agence d’architecture est de 1,7 salarié en 20113. Ainsi, les agences qui accueillent des MSP sont le plus souvent des agences d’au moins trois salariés (70 %), et où le tuteur H.M.O.N.P . exerce le plus souvent en tant qu’associé. Ce n’est pas en soi une difficulté mais il reste que l’on peut s’interroger sur la faible présence des petites structures qui, notamment en province, sont les plus nombreuses. Ce constat souligne celui fait à propos de la capacité des agences, en fonction de leur taille, à accueillir des jeunes diplômés en mise en situation professionnelle4. 3 CNOA, IFOP , Observatoire de la profession, 2011, p. 27 4 L’hypothèse d’une augmentation de l’usage régulier de l’accueil d’A.D.E. en MSP selon la taille des structures gagnerait à être mieux éclairée qualitativement. Voir le Cahier statistique ● ● Tableau 6, page 27 PRÉCONISATION Le Conseil national propose de généraliser le contact entre les écoles d’architecture et les Conseils régionaux de l’Ordre afin de procéder aux vérifications essentielles pour les mises en situation professionnelles (risques en matière de sanctions administratives ou disciplinaires notamment, liquidation judiciaire le cas échéant). 8 HMONP Types de contrats La mise en situation professionnelle peut être réalisée avec différents types de contrats. La majorité des candidats H.M.O.N.P . signent des contrats à durée déterminée, voire des CDI (qui sont surtout le fait des agences de plus de 3 salariés). Certains ont eu recours à des contrats de uploads/s3/ hmonp-retours-experiences-juillet2012.pdf
Documents similaires



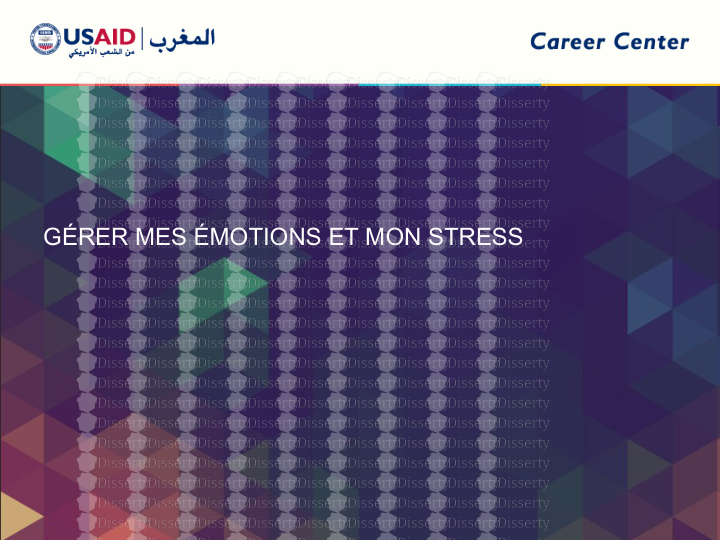

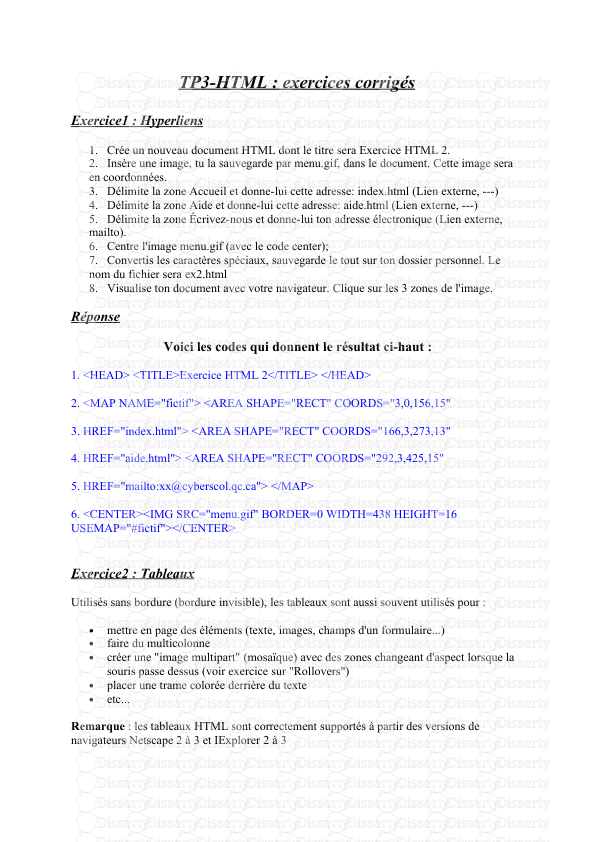




-
69
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 18, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.8783MB


