Soufisme et Art visuel iconographie du sacré par Shaker Laibi (Paris, L'Harmatt
Soufisme et Art visuel iconographie du sacré par Shaker Laibi (Paris, L'Harmattan, 1998) [Extraits] Shaker Laibi, écrivain, poète et peintre né en Irak en 1956, a écrit plusieurs livres et articles dont L'Orient féminisé. Il vit à Genève et termine actuellement un doctorat à l'université de Lausanne en sociologie de l'art ayant pour sujet L'approche sociologique de l'anonymat de l'artiste dans l'art islamique. Le marginal et l'institutionnel dans l'art islamique Art religieux et art sacré Il est supposé que la formation d'une quelconque iconographie ne repose pas uniquement sur les faits connus et affichés, mais aussi sur les phénomènes de marginalité et d'exclusion. L'ambition des pages suivantes est de réhabiliter ce qui est écarté de l'art islamique. Le contexte encadrant celui-ci n'accorde que peu d'attention au travail visuel. Les détails, les petites touches n'étaient pas toujours, paraît-il, une préoccupation permanente. Au lieu d'avancer dans les recherches visuelles, les faiseurs d'objets, les artisans et les théoriciens de cette culture se figeaient devant leurs performances et leur iconographie accomplie. Dans certains domaines, l'exclu de la culture et de l'histoire islamiques est parfois plus important que les faits institutionnalisés, particulièrement dans les arts plastiques. Ce qui était oublié dans l'histoire de l'art islamique est aussi l'histoire de cet art. Il existe une négligence généralisée qui surplombait les valeurs de petits morceaux construisant la globalité de la mosaïque culturelle. Ainsi on n'examinerait pas, par exemple, les couleurs d'un point de vue plastique (car chose faite d'un point de vue optique) bien qu'elles soient porteuses, même physiquement, de la philosophie de cet art. Les auteurs classiques comme les chercheurs actuels sont parvenus, à des degrés différents, à mettre à l'écart le sujet chromatique en tant que tel. Les anciens traités sont très fragmentés et ne donnent que des approches vagues de la conception de leur époque sur les couleurs. Al- Fahrist, un répertoire des ouvrages qui ont été écrits en Islam depuis son début jusqu'à la vie d'Ibn Al-Nadim 1 l'auteur du répertoire, indique les titres de quelques livres qui ont été consacrés entièrement, semble-t-il, aux couleurs, tels que : Kitab Al-Luma Fi AI-Alwan (Le Livre des lustres sur les couleurs ) d'un certain Al-Nimrî, Un traité sur les teintures qui donnent des couleurs d'Al-Kindi, Kitab AI-Alwan (Le Livre des couleurs) de Hounain Ibn Ishaq, Kitab A1-Asbagh (Le livres des colorants) et Kitab AI-Sibgh al-ahmâr (Le Livre du colorant rouge) de Jabir Ibn Haiân et Kitab Jami' a'mal al-asbâgh w-aI-midâd w-aI-hibr (Le Livre de la fabrication des colorants, de l'huile et de l'encre) d'un certain Doubays. Les philosophes de l'islam abordaient le même sujet à partir des arguments logiques et de son rapport avec les phénomènes naturels. En règle générale, les couleurs ont été un peu marginalisées. Si elles représentent un principe fondamental de tout art, elles jouent un rôle déterminant dans la spéculation soufie islamique comme nous le verrons dans ce livre. L'art islamique, en somme, à la façade religieuse et idéale, s'installe sur l'exclusion de ce qu'il estime secondaire commençant par la figure humaine, en passant par le rejet de toute représentation de la réalité objective, en faveur de la seule et vraie réalité pour lui : celle de l'invisible. Le grand paradoxe de l'art islamique réside dans son souhait de représenter une réalité qui se situe en dehors du réel visible et son insistance pour le démontrer par ses propres moyens. Son problème est de représenter une réalité qui n'est pas à portée de vue. Paradoxe venant de cette différenciation radicale entre "vue" et " clairvoyance" que révèle la langue arabe en supposant deux termes opposés, sans tenir compte de leur corrélation, et accentuée au cours de l'histoire de cet art. Le premier est l'oeil et le second "l'oeil de l'âme", termes qui sont irréconciliables pour cette langue. Par l'exclusion du réel de l'art, l'astuce géométrique éveille les ombres et ce qui reste caché à l'intérieur du réel; elle accomplit historiquement des oeuvres célèbres, "supérieures" dans cet art : l'abstraction islamique, connue également sous le nom d'arabesque qui ne sera pas, à son tour, à l'abri de la modification en plusieurs degrés par la suite. Cette trouvaille de l'abstraction n'était pas la seule pratique picturale dans la vie culturelle. Celle-ci n'obéissait pas à la règle du jeu. Dans les miniatures, les tapisseries, les broderies, les poteries, etc., la représentation figurative a été permanente. Nous insistons, en partie, sur l'existence d'un autre genre artistique, qui se distingue du phénomène pictural prédominant, par sa nature graphique et chromatique, par l'élan de ses formes et les sources philosophiques qui le nourrissent. Voilà notre thèse : il y a une iconographie parallèle à celle bien connue qu'on appelle l'art islamique. Ses caractéristiques émergent d'une pensée mystique, ésotérique s'opposant à l'art officiel moins mystique, tout en ayant un lien commun avec lui. Nous l'appelons iconographie du sacré car elle se rapporte au soufisme par comparaison avec l'autre appartenant à une vision religieuse. La différence va toucher le support lui-même qui fait paraître les motifs et les formes. Si l'art islamique utilisait les murs, les coupoles, les miniatures, les métaux, les bois et d'autres supports, la nôtre utilise principalement le talisman : (parchemins et papiers) comme support. Cette différence est de nature sémiologique ; bien qu'un support soit la condition primordiale et matérielle du travail visuel, il a, en même temps, une relation intime avec son contenu. Pour accomplir son oeuvre, il faut choisir, initialement, la surface convenable à ses besoins ; une toile pour son pinceau, une feuille pour sa plume ou un mur de caverne pour son couteau primitif. Ce choix n'est pas innocent; il est en rapport avec la signification de l'oeuvre. Mais qu'est-ce qu'un support? "toute surface permettant de réaliser une oeuvre picturale", "c'est un terme désignant le subjectile préparé pour la peinture", "exemples : toile, panneau, papier, carton, mur, etc.". "Le bristol, l'ivoirine, peuvent aussi donner de bons supports","élément concret, matériel, qui sert de base à une oeuvre graphique". Si ces définitions proposées par les manuels sont justes, le talisman oriental paraît très adaptable à leurs signifiés (et tout ce qu'ils entraînent) puisqu'il s'agit, selon les prescriptions de fabrication et la pratique courante, de papier retravaillé, façonné et dessiné dans la plupart des cas. Notons, en passant, que les papiers servant de support sont éphémères; ils ne résistent guère au temps. Nous trouvons également des talismans fabriqués pour une autre catégorie de gens, riches ceux-là. Ce sont les tablettes en argent, en plomb et en cuivre, ou des talismans gravés sur des gemmes telles la calcédoine, l'agate, la sardoine, le jaspe vert, la néphrite, la serpentine et l'hématite2. Parlant des besoins, on n'évoque pas seulement des besoins purement esthétiques mais aussi ceux qui dissimulent toute relation entre l'oeuvre et son environnement. Le support décrit à sa manière quelques aspects culturels, philosophiques et sociaux de l'oeuvre. Il n'était jamais une matière neutre : en plus de sa qualité de médium, c'est un révélateur. Un support pictural et graphique est aussi un support culturel et philosophique. S'il est vrai qu'il y a un rapport entre la magie et l'art, le talisman le prouve et l'accentue puisqu'il "porte" littéralement cette magie dérivée, dans notre cas, vers l'ésotérisme. Le support talismanique affiche une activité graphique (dessins, gravures) basée sur des formes et des figures symboliques. Un talisman se réalise souvent sur une feuille enroulée ou pliée (ou sur des tablettes métalliques) qui sera portée de manière invisible. Nous prétendons qu'un talisman de ce genre a une qualité plastique autant qu'une valeur gnostique, car il a su, pour un oeil préoccupé par le visuel, échapper au culte du beau. Il sera traité plutôt comme étant un support semblable à d'autres supports parus dans l'histoire de l'art, et particulièrement dans l'art islamique. Le talisman devenu support d'expressions artistiques soufies est un bon prétexte qui amène à réexaminer le concept général de support, son évolution dans le temps et ses divers usages. Remarquons que la nature matérielle du support subit des mutations selon le fonctionnement de l'oeuvre, son message et ses récepteurs. L'homme n'a utilisé pendant longtemps que les murs, les coupoles et les vitraux comme supports principaux considérés, d'une part, parce qu'aggissant directement dans l'espace, c'est-à-dire avec les gens qui fréquentent ces lieux, et d'autre part, les dimensions des supports variaient à leur tour selon ce même fonctionnement ; les miniatures seront de petits formats puisqu'elles doivent être faciles à transporter, tandis que les peintures murales seront de grands formats car destinées à s'adresser à un large public. Au cours de l'histoire, les changements successifs auxquels se soumettent les supports avaient conduit à oublier toutes les leçons concernant la texture, la dimension et le format des supports pour prendre en considération la toile seulement (le tableau réalisé en toile) comme étant l'unique support digne du vrai art, puis d'une pratique valable de l'art. Les talismans en tant que travaux graphiques répondent à des concepts et des besoins spirituels ; d'où leurs petits formats, leurs symboles et leurs modes spécifiques de fabrication. Une des critiques envers l'art islamique est la uploads/s3/ soufisme-et-art-visuel.pdf
Documents similaires





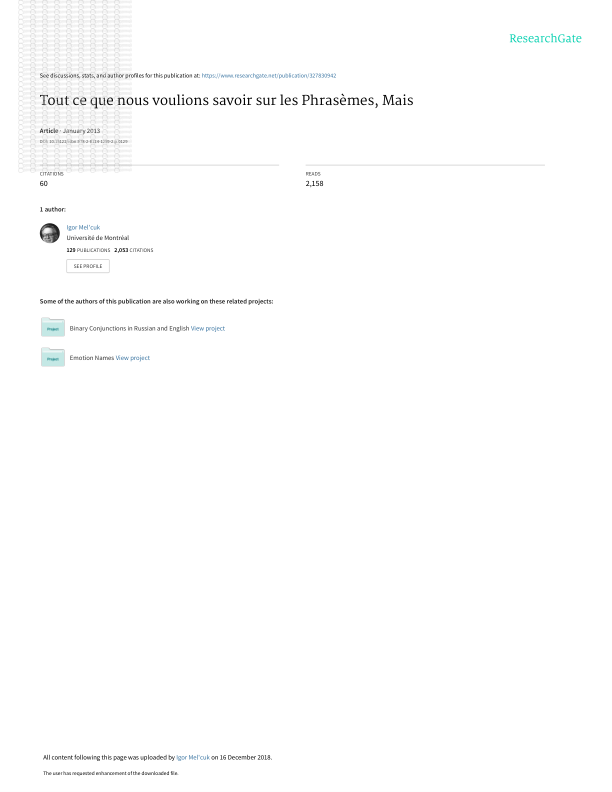




-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 13, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5045MB


