CeROArt Conservation, exposition, Restauration d'Objets d'Art 2 | 2008 : Regard
CeROArt Conservation, exposition, Restauration d'Objets d'Art 2 | 2008 : Regards contemporains sur la restauration Dossier Sculpture africaine. Blessures et altérité Au-delà de l’exposition « Objets Blessés. La réparation en Afrique » GAETANO SPERANZA Résumés Au delà de la notion de “blessure” relative à l’objet, l’auteur s’attache aux traumatismes culturels résultant de la rencontre entre la sculpture africaine et le monde occidental. Un exemple particulier est celui des instruments de musique ethnographiques, dont la restauration est souvent tributaire des conceptions occidentales. Beyond the notion of « injury » for the object, the author dwells on cultural traumatisms resulting from the meeting between African sculpture and the western world. A particular example is the one of ethnographical musical instruments for which restoration is often tributary of western conceptions. Entrées d'index Mots-clés : restauration, Afrique, ethnographie, réparation, instrument de musique, harpe, objet ethnographique Keywords : restoration, ethnographical object, ethnography, musical instrument, Africa, harp, repair Página 1 de 19 Sculpture africaine. Blessures et altérité 04/03/2011 http://ceroart.revues.org/624 Texte intégral Introduction Objets blessés Fig.1 Statuette Loango Le Musée du Quai Branly a présenté du 19 juin au 16 septembre 2007 l’exposition « Objets Blessés. La réparation en Afrique ». Après avoir rappelé le sens de l’exposition et les lignes essentielles de son catalogue, cet article analyse un exemple concret de réparation et de restauration d’une harpe. Nous avons voulu ensuite élargir le sens de « blessure » pour rappeler d’autres traumatismes « culturels » résultant de la rencontre entre la sculpture africaine et le monde occidental (la transformation de la harpe d’instrument de musique en support de sculpture, la collecte arbitraire, Picasso le cannibale blanc, les dégâts de l’art universel). Contrairement aux blessures physiques, ces traumatismes culturels, bien plus lourds de conséquences, ne peuvent être réparés. 1 L’exposition est née d’une constatation simple : la réparation, très répandue dans tout le continent africain, est pratiquement absente dans les collections occidentales d’objets africains. En outre, aucune exposition n’avait jamais montré cette activité fondamentale dans la vie sociale et économique africaine et aucune étude ne lui avait été consacrée. 2 Le catalogue1 essaye pour la première fois de rassembler les quelques renseignements encore disponibles et de présenter un embryon d’interprétation. Une linguiste, une restauratrice et une ethnologue examinent le sens général de cette activité. Un évêque chrétien, une sociologue musulmane et un initié bamana malien en explorent la signification religeuse. Trois ethnologues examinent les cas de terrain du Maghreb, des Dogons et du Gabon (désert, savane et forêt). Enfin une critique d’art rappelle l’importance que la blessure et la réparation ont eue dans l’art occidental contemporain. 3 En premier lieu nous avons constaté que la réparation augmente la valeur symbolique individuelle ou collective de l’objet. La cassure d’un objet, notamment d’un objet rituel, est le signe d’un dysfonctionnement social, la réparation n’est donc pas qu’un acte physique, elle contribue rituellement à rééquilibrer la vie du groupe. 4 La réparation en Afrique, différente de notre restauration, n’a pas pour objectif d’empêcher d’ultérieures dégradations, ni de rendre à l’objet sa lisibilité initiale, elle renouvelle la vie d’un objet et sa fonction, elle doit donc être visible. 5 Página 2 de 19 Sculpture africaine. Blessures et altérité 04/03/2011 http://ceroart.revues.org/624 L’œil de la statuette rituelle a été remplacé par un clou © Paris, musée du Quai Branly, © Direction des Musées de France Fig.2 Statue Ibo Página 3 de 19 Sculpture africaine. Blessures et altérité 04/03/2011 http://ceroart.revues.org/624 Statuette Ibo et détail du bras réparé © Paris, musée du Quai Branly, © Direction des Musées de France Fig.3 Une calebasse Détail de l’important travail de réparation, apparenté à la broderie. © Paris, musée du Quai Branly, © Direction des Musées de France Ces réparations, notamment pour les objets rituels, masques et statues, sont assez rustres et les matériaux assez simples : fibres végétales, lanières de cuir ou de tissus, fil de fer, agrafes et plaques métalliques… 6 La seule exception à cette simplicité est représentée par les calebasses, objets d’utilisation courante, simples et remplaçables. Les récipients de formes, dimensions et utilisations différentes, fabriqués à partir des calebasses, sont souvent complétés ou décorés par des ajouts très élégants le plus souvent réalisés en fibres végétales (manches, bords, décorations…). Ce travail très fin se retrouve naturellement dans les réparations, la calebasse représente ainsi un monde esthétique à part. 7 Página 4 de 19 Sculpture africaine. Blessures et altérité 04/03/2011 http://ceroart.revues.org/624 Harpes Réparer, restaurer La décision de réparer un objet plutôt que de le remplacer et l’exécution de la réparation ont des règles complexes et concernent de nombreux acteurs : anciens d’une famille ou d’un village, artisans, utilisateurs, forgerons, griots, marabouts… 8 Si la réparation donne une nouvelle vie à l’objet, elle confère aussi un pouvoir à celui qui la réalise. 9 Le concept simple de « réparation autochtone » est rapidement devenu plus complexe. D’une part il est vite apparu que ce concept comprenait un important substrat métaphysique, religieux, social. 10 D’autre part les objets sont abîmés ou modifiés par des « restaurations » pendant et après leur collecte, alors même qu’ils sont rentrés dans nos collections et dans nos musées occidentaux. 11 Enfin la presque absence d’objets réparés dans nos collections, nous fait réfléchir sur le sens de ce que nous avons dans nos réserves et de ce que nous exposons. 12 Cet exemple exprime bien les difficultés conceptuelles que l’on rencontre en abordant les questions de la détérioration, de la réparation et de la restauration et met en évidence les différences entre ces deux derniers concepts. 13 La harpe Zandé est fabriquée le plus souvent par le musicien qui en jouera. En cas d’accident elle sera réparée par le harpiste de façon à ce qu’elle puisse jouer à nouveau. 14 Pour comprendre les accidents les plus fréquents il faut connaître la structure organologique de l’instrument2. 15 Les éléments essentiels d’une harpe sont un manche arqué en bois dur et une caisse de résonance en bois tendre creuse, de forme ovale cintrée ou non. Le manche peut porter à son sommet une tête finement sculptée3, il présente cinq trous à distance régulière Une planchette de bois à cinq trous (cordier) est posée longitudinalement sur la caisse et fixée à celle-ci avec une filasse torsadée. 16 Le manche s’emboîte dans la caisse et il est rendu solidaire de celle-ci par du tissu. 17 La caisse et le cordier sont recouverts par une peau découpée et cousue en forme qui est mouillée et laissée sécher pour s’adapter exactement aux formes de la caisse et en ferme la partie supérieure en formant table d’écoute. Cette partie supérieure de la peau est percée de deux trous (ouïes). Les cinq cordes sont fixées au cordier et aux cinq clés qui traversent les trous du manche. 18 L’instrument est donc un système solidaire et rigide qui peut être accordé en tournant les clés, les cordes sont ainsi tendues entre manche et cordier et émettent un son très propre (dans d’autres peuples on trouvera des harpes de structures et de formes différentes, avec huit ou même dix cordes…). 19 On ne rentrera pas ici dans la difficile question musicale, sauf pour rappeler que cet instrument accompagne un chant, que la harpe peut être accordée différemment pour chaque chant, que le plus souvent deux ou trois instruments 20 Página 5 de 19 Sculpture africaine. Blessures et altérité 04/03/2011 http://ceroart.revues.org/624 Expositions jouent ensemble, tandis qu’un seul harpiste chante, que c’est le chanteur qui accorde les instruments …. La qualité du son de la harpe dépend de certaines de ses caractéristiques organologiques : la profondeur de la caisse, l’écartement des cordes, la rigidité de l’ensemble … La harpe peut avoir une longue vie et être transmise à plusieurs générations, mais elle subit des accidents, certains fréquents et facilement réparables, d’autres plus structurels. La partie la plus solide, qui traverse les âges, est le manche. 21 Les cordes, traditionnellement en fibres végétales, sont fragiles et doivent être remplacées souvent. Les clés peuvent casser et doivent être retaillées et remplacées. 22 La peau, trop tendue, peut se déchirer ou ses coutures peuvent lâcher. Les souris peuvent manger la peau autour des ouïes et modifier le son de la harpe. Le cordier peut casser sous une tension trop forte des cordes. La caisse en bois tendre peut être abîmée et rendue inutilisable par l’humidité… 23 L’instrument est donc vivant, il faut le conserver dans de bonnes conditions (par exemple en l’accrochant au toit de la case par un crochet sculpté ad hoc) et il doit être entretenu continuellement, réparé souvent et reconstitué de temps en temps. L’objectif unique de ces interventions est de faire en sorte que la harpe puisse jouer de nouveau. 24 Une fois arrivée dans un musée la harpe n’est plus réparée, mais restaurée. 25 J’ai eu deux occasions de montrer des harpes dans deux expositions différentes. 26 La première fois en 1999 dans une exposition consacrée à ce type d’instruments au Musée de la Musique. Il s’agissait de montrer pour la première fois cet instrument localisé dans une grande région de l’Ouganda uploads/s3/ speranza-g-sculpture-africaine-2008.pdf
Documents similaires








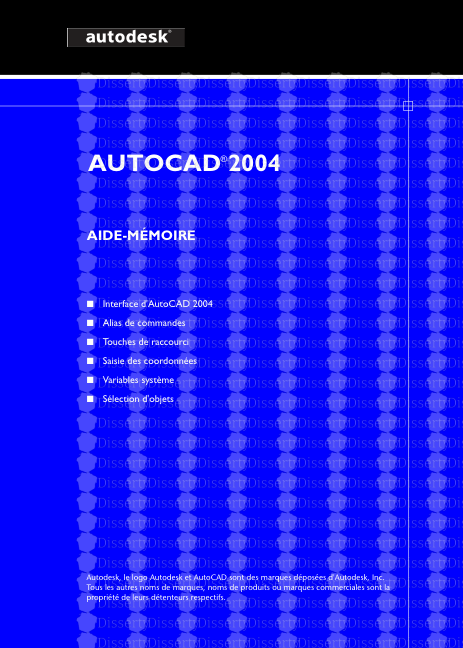

-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 28, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3131MB


