Recueil Dalloz Recueil Dalloz 2009 p.1639 L'autonomie de la volonté dans le règ
Recueil Dalloz Recueil Dalloz 2009 p.1639 L'autonomie de la volonté dans le règlement Rome II (1) Olivera Boskovic, Professeur à l'Université d'Orléans, directrice du Centre de recherche juridique Pothier (EA1212) 1 - L'article 14 du règlement Rome II, qui en est sans doute un des textes les plus marquants, introduit l'autonomie de la volonté en matière non contractuelle. Il permet aux parties de choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle. Il s'agit là, du point de vue d'un juriste français, d'une véritable révolution conceptuelle. Certes, notre droit connaissait l'accord procédural, mais des différences considérables séparent ce dernier de l'accord de fond au sens de l'article 14. Cette consécration est le résultat d'un choix de politique juridique qui peut susciter des réactions contrastées, mais qui est incontestablement dans le sens de l'histoire. Le principe étant posé, mieux vaut s'interroger sur les modalités de son admission. Et l'on constate que le législateur européen ne s'est pas contenté d'affirmer la possibilité d'un choix de loi en matière non contractuelle (I). Il a mis un soin particulier à en réglementer la mise en oeuvre (II). I - La consécration de l'autonomie de la volonté 2 - Au-delà du principe d'un choix de loi en matière non contractuelle (A), l'article 14 permet aux parties, à certaines conditions, de choisir la loi applicable avant même la survenance du fait générateur (B). Ce parti pris, fondamental, des auteurs du règlement cristallise la plupart des difficultés. A - Le principe d'un choix de loi en matière non contractuelle 3 - La position du législateur européen ne se comprend qu'à la lumière du débat qui oppose partisans et opposants de l'autonomie de la volonté en matière extracontractuelle. Quelques interrogations subsistent. 1 - Le débat 4 - Traditionnellement réservée au droit des contrats et des régimes matrimoniaux, l'autonomie de la volonté a progressivement envahi des matières qui lui étaient à l'origine étrangères (2). La matière extracontractuelle n'a pas fait exception. Alors que dans sa thèse soutenue en 1961, Pierre Bourel pouvait se demander si l'on pouvait imaginer « matières plus étrangères à l'idée d'autonomie de la volonté que les délits et les quasi-contrats », aujourd'hui on constate que la doctrine européenne est majoritairement favorable à l'autonomie de la volonté en cette matière. Les auteurs y voient un vecteur de prévisibilité et de sécurité juridique appréciable. De plus, on fait remarquer que le choix de la loi applicable permet de corriger, comme en toute matière, l'incertitude ou le caractère insatisfaisant de la règle de conflit ainsi que de réduire la durée et donc le coût des procédures. Face à ces objectifs, dont l'importance n'échappe à personne, l'impérativité des règles délictuelles et quasi contractuelles, voire même les risques d'abus dans la mise en oeuvre du principe d'autonomie ne font pas le poids. Le débat se reporte alors sur les modalités et l'étendue de l'autonomie de la volonté : choix antérieur ou postérieur à la survenance du fait dommageable, véritable autonomie de la volonté ou option de législations, voire même une simple option en faveur de la loi du for. 5 - En France, ce débat a eu lieu indirectement à propos de l'accord procédural. En effet, l'autonomie de la volonté n'a jamais accédé à la positivité en France. Néanmoins, la Cour de cassation a consacré (3), pour la première fois précisément en matière délictuelle, la possibilité pour les parties d'éluder la règle de conflit et de renoncer à invoquer la loi normalement compétente. Destiné à la fois à assouplir les obligations des juges du fond en matière d'application d'office de la loi étrangère et à corriger une règle de conflit parfois inadaptée, cet instrument ne s'est pas révélé totalement satisfaisant. Bien qu'un débat ait existé sur ce point, il semble tout d'abord qu'il permet essentiellement de revenir à la loi française (4). Par ailleurs, il présente une série d'inconvénients, dont celui d'être limité à un cadre judiciaire. Une véritable autonomie de la volonté a au contraire l'avantage de permettre le choix de la loi applicable en dehors de toute action en justice, ce qui est particulièrement important dans la perspective d'une transaction (5). Ces arguments ont convaincu le législateur européen. 2 - La position du législateur européen 6 - L'article 14 du règlement Rome II prévoit que « les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage ou lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage » (6). Le texte consacre une véritable autonomie de la volonté, un choix de loi au sens du droit international privé (7). Il est vrai que plusieurs précédents législatifs pouvaient être trouvés en droit comparé, mais le règlement va particulièrement loin (8). 7 - Le texte européen ne prévoit, en effet, aucune limitation de l'éventail des lois susceptibles d'être choisies. Aucun lien objectif avec la situation n'est exigé. Toutefois, prenant modèle sur l'article 3 § 3 et de la convention de Rome, le règlement pose une limite concernant les situations purement internes. Si, au moment de la survenance du fait générateur du dommage, tous les éléments de la situation sont localisés dans un seul pays, les parties ne pourront pas, par un choix d'une loi étrangère, déroger aux dispositions impératives de la loi de ce pays (9). De la même manière, à l'instar de l'article 3 § 4 du règlement Rome I, si, au moment de la survenance du fait générateur, tous les éléments de la situation sont localisés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres, le choix de la loi d'un Etat tiers ne pourra pas avoir pour effet d'écarter les dispositions impératives du droit communautaire. 8 - En revanche, l'autonomie de la volonté est exclue dans le domaine de la concurrence déloyale et des atteintes à la libre concurrence ainsi qu'en matière de propriété intellectuelle (10). Comme seule explication, on trouve l'affirmation de la Commission selon laquelle l'autonomie de la volonté n'est pas appropriée dans ces domaines, mais il semble que l'exclusion s'explique en réalité par le fait que la règle de conflit est, dans ces deux matières, mise au service de l'intérêt général (11). La fonction de régulation qu'elle assume interdirait que la désignation de la loi applicable soit laissée à la discrétion des parties (12). Intéressante, l'idée méritait néanmoins d'être démontrée et on peut regretter que la solution n'ait pas été justifiée de manière plus précise (13). En ce sens, il est significatif de noter que la proposition du Groupe européen de droit international privé (GEDIP) permettait le choix de la loi applicable en toute matière, mais postérieurement à la survenance du différend. 9 - A la réflexion, on peut douter de l'opportunité de certains choix du législateur européen. La possibilité d'un choix illimité apparaît ainsi tout particulièrement contestable. Dans une matière dans laquelle l'autonomie de la volonté ne s'imposait pas, le choix parmi un certain nombre de lois prédéterminées (14) aurait sans doute été préférable. Au-delà de ces appréciations en termes d'opportunité, le texte suscite des interrogations. 3 - Quelques interrogations 10 - Une première question concerne la possibilité de choisir des règles non étatiques. On sait que cette question a fait couler beaucoup d'encre en matière contractuelle et que, après avoir été un temps envisagée dans la proposition de règlement Rome I en date du 15 décembre 2005, elle ne se retrouve pas dans le texte final du règlement (15). Qu'en est-il en matière non contractuelle ? On pense notamment aux Principes de droit européen de la responsabilité civile (Principles of European Tort Law). Les parties peuvent-elles choisir de telles règles pour régir l'obligation non contractuelle ? Cette question n'est pas envisagée par le texte, lequel traite de la « loi » applicable. Par conséquent, il semble que la seule possibilité d'envisager l'application de telles règles consiste à affirmer qu'elles peuvent s'appliquer dans les limites des dispositions impératives de la loi objectivement applicable. Ce raisonnement est tout à fait classique. On sait que cette possibilité était déjà ouverte, en matière contractuelle, sous l'empire de la convention de Rome. Mais quelle est l'incidence concrète d'une telle affirmation en matière non contractuelle ? Par exemple, s'agissant du droit français, il est admis que les règles relatives à la responsabilité délictuelle sont impératives avant la survenance du fait dommageable. Cela signifie qu'un choix ex ante des principes européens ne sera pas possible. En revanche, les règles n'étant pas en principe impératives après la survenance du fait dommageable, les parties sont libres de transiger. Un choix de règles non étatiques est donc parfaitement envisageable. 11 - Plus fondamentalement, il est intéressant de se demander si, aux côtés de ces nouvelles règles, l'accord procédural, connu du droit français, subsiste. Dans la mesure où, en vertu de l'article 1 § 3, la procédure, exclue du champ d'application du règlement, reste soumise à la loi du for, une réponse affirmative semble s'imposer. Cette possibilité ne devra pas être négligée, notamment dans les matières dans lesquelles l'autonomie de la volonté est uploads/S4/ autonomie-volonte.pdf
Documents similaires



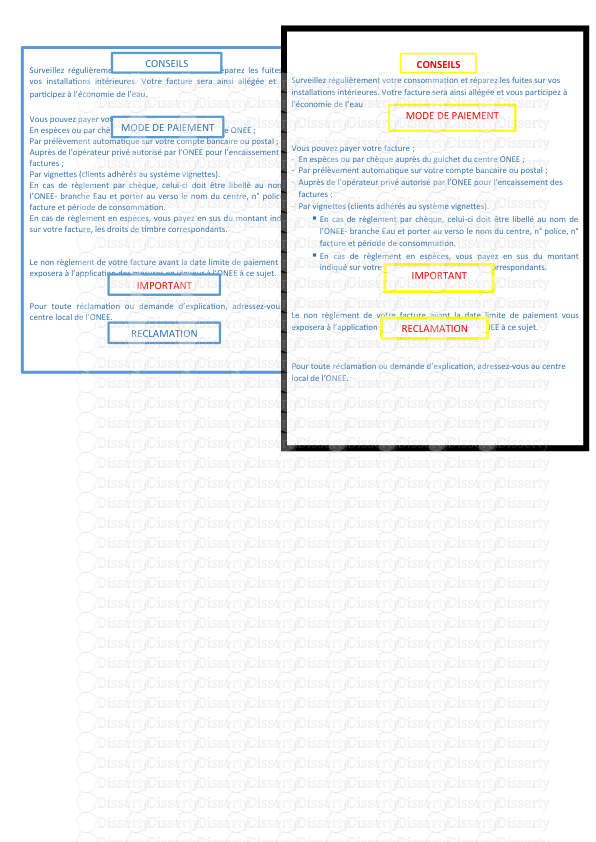






-
51
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 08, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1745MB


