© Éditions Bernard Grasset, 1972. 978-2-246-00519-3 A Paul Thoulouze La Fondati
© Éditions Bernard Grasset, 1972. 978-2-246-00519-3 A Paul Thoulouze La Fondation Guggenheim et l’Université de New York à Buffalo (Faculty of Arts and Letters) ont accordé l’une la bourse, l’autre le temps libre qui ont facilité la rédaction du présent ouvrage. L'auteur les remercie. Sa reconnaissance va également à tous ses amis, à Eugenio Donato principalement, et à Josué Harari, dont la collaboration quotidienne et les nombreuses suggestions sont partout présentes dans les pages qui suivent. I Le sacrifice Dans de nombreux rituels, le sacrifice se présente de deux façons opposées, tantôt comme une « chose très sainte » dont on ne saurait s’abstenir sans négligence grave, tantôt au contraire comme une espèce de crime qu’on ne saurait commettre sans s’exposer à des risques également très graves. Pour rendre compte de ce double aspect, légitime et illégitime, public et presque furtif, du sacrifice rituel, Hubert et Mauss, dans leur Essai sur la nature et la fonction du sacrifice1, invoquent le caractère sacré de la victime. Il est criminel de tuer la victime parce qu’elle est sacrée... mais la victime ne serait pas sacrée si on ne la tuait pas. Il y a là un cercle qui recevra un peu plus tard et qui conserve de nos jours le nom sonore d'ambivalence. Si convaincant et même impressionnant que paraisse encore ce terme, après l’étonnant abus qu’en a fait le XXe siècle, il est peut-être temps de reconnaître qu’aucune lumière propre n’émane de lui, qu’il ne constitue pas une véritable explication. Il ne fait que désigner un problème qui attend encore sa résolution. Si le sacrifice apparaît comme violence criminelle, il n’y a guère de violence, en retour, qui ne puisse se décrire en termes de sacrifice, dans la tragédie grecque, par exemple. On nous dira que le poète jette un voile poétique sur des réalités plutôt sordides. Indubitablement, mais le sacrifice et le meurtre ne se prêteraient pas à ce jeu de substitutions réciproques s’ils n’étaient pas apparentés. Il y a là un fait si évident qu’il paraît un peu ridicule mais qu’il n’est pas inutile de souligner car les évidences premières, dans le domaine du sacrifice, ne pèsent d’aucun poids. Une fois qu’on a décidé de faire du sacrifice une institution « essentiellement », sinon même « purement » symbolique, on peut dire à peu près n’importe quoi. Le sujet se prête merveilleusement à un certain type de réflexion irréelle. Il y a un mystère du sacrifice. Les piétés de l’humanisme classique endorment notre curiosité mais la fréquentation des auteurs anciens la réveille. Le mystère, aujourd’hui, demeure aussi impénétrable que jamais. Dans la façon dont les modernes le manient, on ne sait pas si c’est la distraction qui l’emporte, l’indifférence ou une espèce de prudence secrète. Est-ce là un second mystère ou est-ce encore le même ? Pourquoi, par exemple, ne s’interroge-t-on jamais sur les rapports entre le sacrifice et la violence ? Des études récentes suggèrent que les mécanismes physiologiques de la violence varient fort peu d’un individu à l’autre et même d’une culture à l’autre. Selon Anthony Storr, dans Human Aggression (Atheneum, 1968), rien ne ressemble plus à un chat ou à un homme en colère qu’un autre chat ou un autre homme en colère. Si la violence jouait un rôle dans le sacrifice, au moins à certains stades de son existence rituelle, on tiendrait là un élément d’analyse intéressant car indépendant, au moins en partie, de variables culturelles souvent inconnues, mal connues, ou moins bien connues, peut-être, que nous l’imaginons. Une fois qu’il est éveillé, le désir de violence entraîne certains changements corporels qui préparent les hommes au combat. Cette disposition violente a une certaine durée. Il ne faut pas voir en elle un simple réflexe qui interromprait ses effets aussitôt que le stimulus cesse d’agir. Storr remarque qu’il est plus difficile d’apaiser le désir de violence que de le déclencher, surtout dans les conditions normales de la vie en société. On dit fréquemment la violence « irrationnelle ». Elle ne manque pourtant pas de raisons ; elle sait même en trouver de fort bonnes quand elle a envie de se déchaîner. Si bonnes, cependant, que soient ces raisons, elles ne méritent jamais qu’on les prenne au sérieux. La violence elle- même va les oublier pour peu que l’objet initialement visé demeure hors de portée et continue à la narguer. La violence inassouvie cherche et finit toujours par trouver une victime de rechange. A la créature qui excitait sa fureur, elle en substitue soudain une autre qui n’a aucun titre particulier à s’attirer les foudres du violent, sinon qu’elle est vulnérable et qu’elle passe à sa portée. Cette aptitude à se donner des objets de rechange, beaucoup d’indices le suggèrent, n’est pas réservée à la violence humaine. Lorenz, dans L'Agression (Flammarion, 1968), parle d’un certain type de poisson qu’on ne peut pas priver de ses adversaires habituels, ses congénères mâles, avec lesquels il se dispute le contrôle d’un certain territoire, sans qu’il retourne ses tendances agressives contre sa propre famille et finisse par la détruire. Il convient de se demander si le sacrifice rituel n’est pas fondé sur une substitution du même genre, mais en sens inverse. On peut concevoir, par exemple, que l’immolation de victimes animales détourne la violence de certains êtres qu’on cherche à protéger, vers d’autres êtres dont la mort importe moins ou n’importe pas du tout. Joseph de Maistre, dans son Eclaircissement sur les sacrifices, observe que les victimes animales ont toujours quelque chose d’humain, comme s’il s’agissait de mieux tromper la violence : On choisissait toujours, parmi les animaux, les plus précieux par leur utilité, les plus doux, les plus innocents, les plus en rapport avec l’homme par leur instinct et par leurs habitudes... On choisissait dans l’espèce animale les victimes les plus humaines, s’il est permis de s’exprimer ainsi. L'ethnologie moderne apporte parfois une confirmation à ce genre d’intuition. Dans certaines communautés pastorales qui pratiquent le sacrifice, le bétail est étroitement associé à l’existence humaine. Chez deux peuples du haut Nil, par exemple, les Nuer, étudiés par E. E. Evans- Pritchard, et les Dinka, étudiés plus récemment par Godfrey Lienhardt, il existe une véritable société bovine, parallèle à la société des hommes et structurée de la même façon2. En tout ce qui concerne les bovins, le vocabulaire nuer est ex- trêmement riche, tant sur le plan de l’économie et des techniques que sur celui du rite et même de la poésie. Ce vocabulaire permet d’établir des rapports extrêmement précis et nuancés entre le bétail d’une part et de l’autre la communauté. Les couleurs des animaux, la forme de leurs cornes, leur âge, leur sexe, leur lignage, distingués et remémorés parfois jusqu’à la cinquième génération, permettent de différencier entre elles les têtes de bétail, de façon à reproduire les différenciations proprement culturelles et à constituer un véritable double de la société humaine. Parmi les noms de chaque individu, il y en a toujours un qui désigne également un animal dont la place dans le troupeau est homologue à celle de son maître dans la communauté. Les querelles entre les sub-sections ont fréquemment le bétail pour objet ; tous les dommages et intérêts se règlent en têtes de bétail, les dots matrimoniales consistent en troupeaux. Pour comprendre les Nuer, affirme Evans-Pritchard, il faut adopter la devise : « Cherchez la vache ». Entre ces hommes et leurs troupeaux, il existe une espèce de « symbiose » – l’expression est encore d’Evans-Pritchard – qui nous propose un exemple extrême et presque caricatural d’une proximité caractéristique, à des degrés divers, des rapports entre les sociétés pastorales et leur bétail. Les observations faites sur le terrain et la réflexion théorique obligent à revenir, dans l’explication du sacrifice, à l’hypothèse de la substitution. Cette idée est partout présente dans la littérature ancienne sur le sujet. C'est d’ailleurs pourquoi beaucoup de modernes la rejettent ou ne lui font qu’une place minime. Hubert et Mauss, par exemple, se méfient d’elle, sans doute parce qu’elle leur paraît entraîner un univers de valeurs morales et religieuses incompatibles avec la science. Et un Joseph de Maistre, c’est un fait, voit toujours dans la victime rituelle une créature « innocente », qui paye pour quelque « coupable ». L'hypothèse que nous proposons supprime cette différence morale. Le rapport entre la victime potentielle et la victime actuelle ne doit pas se définir en termes de culpabilité et d’innocence. Il n’y a rien à « expier ». La société cherche à détourner vers une victime relativement indifférente, une victime « sacrifiable », une violence qui risque de frapper ses propres membres, ceux qu’elle entend à tout prix protéger. Toutes les qualités qui rendent la violence terrifiante, sa brutalité aveugle, l’absurdité de ses déchaînements, ne sont pas sans contrepartie : elles ne font qu’un avec sa propension étrange à se jeter sur des victimes de rechange, elles permettent de ruser avec cette ennemie et de lui jeter, au moment propice, la prise dérisoire qui va la satisfaire. Les contes de fées qui nous montrent le loup, uploads/Finance/ rene-girard-la-violence-et-le-sacre 1 .pdf
Documents similaires


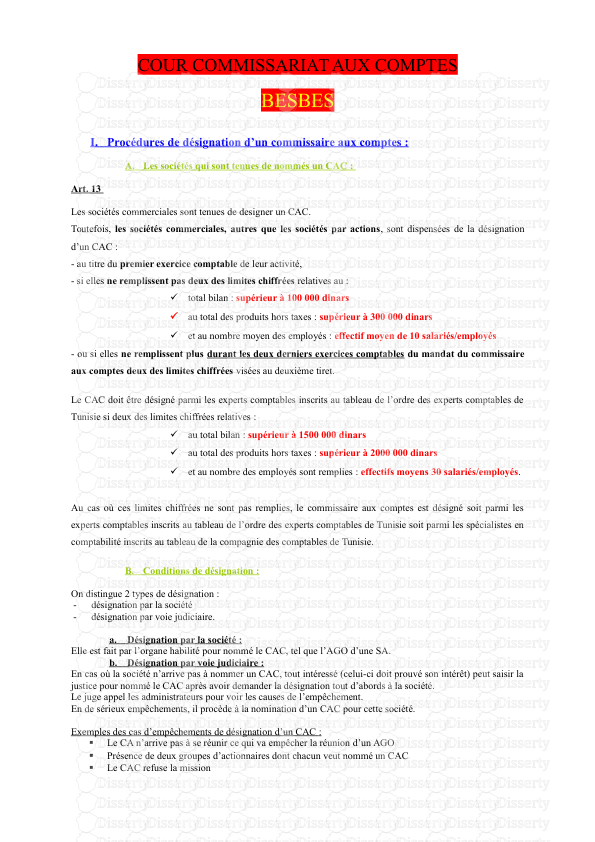





-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 10, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 2.0530MB


