Descartes Histoire de la Philosophie Professeur : Laurent Chalard laurentchalar
Descartes Histoire de la Philosophie Professeur : Laurent Chalard laurentchalard@gmail.com Mercredi 25 Septembre 2013 Mercredi 2 Octobre 2013 Mercredi 9 Octobre 2013 Mercredi 16 Octobre 2013 Mercredi 13 Novembre 2013 Mercredi 20 Novembre 2013 Mercredi 27 Novembre 2013 Mercredi 4 Décembre 2013 Mercredi 11 Décembre 2013 Mercredi 18 Décembre 2013 Mercredi 25 Septembre 2013 Introduction Descartes est né en 1596 en France. Il reçoit une très bonne éducation dans le collège « La flèche ». C’est un collège qui réunit beaucoup d’esprits, qui a de très bons collégiens. La période du collège sera déterminante pour la suite. Il va étudier l’algèbre, la géométrie, la physique, la religion, la poésie latine… A la fin de ses études il fait un peu de droit et s’engage dans l’armée en Allemagne (armée démobilisé), ce qui lui permet de voyager. Il est un brillant élève qui voyage sur le temps. Dans cette période de voyage il va vivre la plupart du temps dans les Provinces Unies (Hollande) qui étaient à l’époque un lieu de liberté, de tolérance, de connaissance ou il y rencontre de grands noms comme Beeckman. Il rencontre un jeune mathématicien qui lui fait comprendre que les mathématiques ont une portée plus grande qu’à l’école : les mathématiques peuvent s’appliquer à tout ce qui contient de l’ordre et de la mesure. Descartes devient vite obsédé par l’idée d’unir les différents savoirs, une sorte de MATHESIS UNIVERSALIS. Le premier livre qu’il publie est un abrégé de musique. Il cherche l’union des savoirs, des liens plutôt que de couper. C’est quelqu’un qui est profondément amoureux de la vérité, de la recherche de la connaissance. Cela a un sens majeur pour Descartes car pour lui découvrir la vérité c’est le plus grand bien que la vie puisse offrir. Il ne voulait pas la vérité absolument pour elle-même. Descartes dit qu’il veut distinguer le vrai et le faux afin de marcher avec assurance dans cette vie. Il y a toujours chez Descartes un lien avec la vie pratique. Le Discours de la Méthode C’est un livre qui parait en 1637 qui est censé être la préface de plusieurs traités. D’après Descartes dans les livres on approche beaucoup moins de la vérité « que les simples raisonnements que peut faire naturellement un homme de bons sens touchant les choses qui se présentent ». Les amis de Descartes ont passé leur temps pour qu’il écrive pour ci ou pour ça alors que ce dernier n’avait pas un zèle pour écrire. Le bon sens c’est que nous possédons chacun une faculté d’analyser d’après Descartes. Faire reposer la philosophie dans l’exercice du jugement personnel n’était pas quelque chose qui dominait à l’époque chez les philosophes scolastiques à qui s’en est pris Descartes. Il y a une nuit très célèbre chez Descartes, la nuit du 10 au 11 Novembre 1619. Il avait travaillé à l’unification des sciences avec beaucoup d’enthousiasme et était à Neubourg en Allemagne. Cette nuit il aura 3 songes. Dans le premier il rêve qu’il est dans son collège, il marche vers la cour, va dans l’église et croise quelqu’un qu’il ne salue pas et quelques mètres après il se retourne sauf qu’un vent terrible l’empêche d’aller retrouver cette personne et le ramène contre l’église. Il est d’autant plus étonné car il est le seul embêté par ses vents. Une des personnes autour lui donne une sorte de melon. Dans le deuxième songe il voit la foudre dans sa chambre et il va confiner ça dans un carnet sous le nom d’Olympica Dans le troisième songe il se voit à sa table de travail et il y a une encyclopédie sur sa table. Il tend son bras et quand il attrape le livre ce n’est plus une encyclopédie mais un corpus poétique, un CORPUS POETARUM dans lequel il trouve un poème d’AUSONE, Idylle XV. Il lit « Quod vita sectabor iter ? Quelle vie dois-je mener ? A l’époque philosophie et religion ne sont pas séparables. Le melon dans les représentations religieuses est le monde. Il a un effort pour reprendre à partir de son esprit toutes les connaissances. Il est obligé de renier en partie des éléments de la Bible dans sa quête de la vérité. Saint-Paul écrivait « ne cherchez pas à savoir, mais craignez ». Dans le deuxième songe l’Olympica fait référence aux châtiments humains donnés par les Dieux. Dans le troisième songe c’est l’idée que le savoir doit nous aider à guider notre vie. Descartes ne va pas renoncer à la connaissance et il va dire que le péché d’orgueil serait d’avoir la connaissance entière tout de suite. A l’inverse le fait de s’élever par un long chemin vers la vérité n’est pas un péché d’orgueil. « Je pensais que parce que nous avons été enfant avant d’être hommes et qu’il nous a fallu longtemps être gouverné par nos appétits et nos précepteurs qui étaient souvent contraire les uns aux autres et qui ni les uns ni les autres ne nous conseillaient toujours le meilleur… » L’enfant n’a pas dès sa naissance l’usage d’une raison critique. L’enfant est pour Descartes mis en mouvement par des appétits et il est crédule en ses précepteurs et ses proches. Si les jugements viennent de cette enfance, il va falloir être actif pour reprendre nos jugements. Finalement tous ces jugements sont douteux et Descartes veut être sûr que tous ces jugements sont vrais. Il aime que les choses soient certaines et que l’on soit dans l’évidence. Il n’aime pas être dans le doute et que ce qu’il tient pour vrai soit faux. Mercredi 2 Octobre 2013 Descartes a eu très tôt non seulement l’envie d’accroitre ses connaissances mais également de relier les sciences. Descartes ne suit pas un ordre des matières mais il veut suivre l’ordre des raisons et tourner du côté d’Euclide. En 1644 il écrit un vaste ouvrage dédié à la princesse Elisabeth Principes de la Philosophie, il écrit une lettre en préface dans lequel il prend l’image d’un arbre pour décrire la philosophie. La racine de la philosophie c’est la métaphysique et le tronc serait la physique. Il cite 3 branches : la mécanique (les arts mécaniques, la construction de ponts,…), la médecine, la morale. Descartes ne comprend pas les mathématiques avec la philosophie. Les Mathématiques sont par essence des idéalités pour Descartes les mathématiques sont présents partout. Les mathématiques n’ont pas pour prétention de nous donner une connaissance de la réalité extérieure. Il n’est pas à la recherche d’une adéquation entre la réalité et son jugement. A proprement parler la question de la vérité en mathématique ne se pose pas : il n’y a pas de vérité en mathématiques. Ce qui l’intéresse c’est la cohérence, la validité, la non-contradiction. La philosophie n’a pas simplement pour but de nous permettre de chercher la connaissance mais aussi une connaissance utile et pratique. Les arts mécaniques vont permettre de résoudre un début de philosophie, un mieux-vivre. L’ordre des raisons qui à partir de premiers principes permet d’en déduire une suite. Ce sont les premiers principes qui vont servir pour tous les restes. Ce n’est cependant pas un ordre arbitraire. Descartes essaye étape par étape de reconstruire le savoir. Descartes explique qu’il ne faut pas établir de contre-sens. Descartes dit que la volonté n’est pas de reformer l’état et que la seule chose qu’il veut remettre en place est les idées dans son esprit. « Pour toutes les opinions que j’avais reçu jusque alors en ma créance, je ne pouvais mieux faire que d’entreprendre une bonne foi de les en ôter, afin d’y en remettre par après ou d’autres meilleurs, ou bien les mêmes lorsque je les aurai ajusté au niveau de la raison. » Descartes a très tôt, dès 1629, intitulé Les règles pour la direction de l’esprit. Dans ce livre il a une intuition centrale dans toute son œuvre, c’est que nous n’avons pas une capacité illimitée de savoir, notre esprit et notre intelligence ont des limites mais au sein de ces limites il est possible d’avoir la certitude. La mémoire, notre entendement et notre imagination ne sont pas infinis. Descartes a reçu beaucoup d’opinion mais s’il se pose la question : suis-je certain de ma certitude ? Descartes va faire un travail pour s’assurer qu’il peut être certain de ses certitudes. Si on se fie à la connaissance sensible on va se dire que la terre ne tourne pas et est immobile. A l’époque il y a un grand bouleversement scientifique et Descartes cherche alors à fixer des certitudes. Descartes voudrait que ce soit en accord avec les règles extérieures mais il voudrait au moins avoir une certitude absolue : « ne tenir pour vrai que ce qu’apparait évidemment être tel ». L’évidence c’est quand je n’ai plus aucun moyen de douter. Le doute de Descartes n’est pas un doute sceptique. Ce que l’on prend pour connaissance est une croyance tant qu’on ne l’a pas démontré. Descartes n’est pas un stoïcien, uploads/Geographie/ histoire-de-la-philosophie-descartes.pdf
Documents similaires

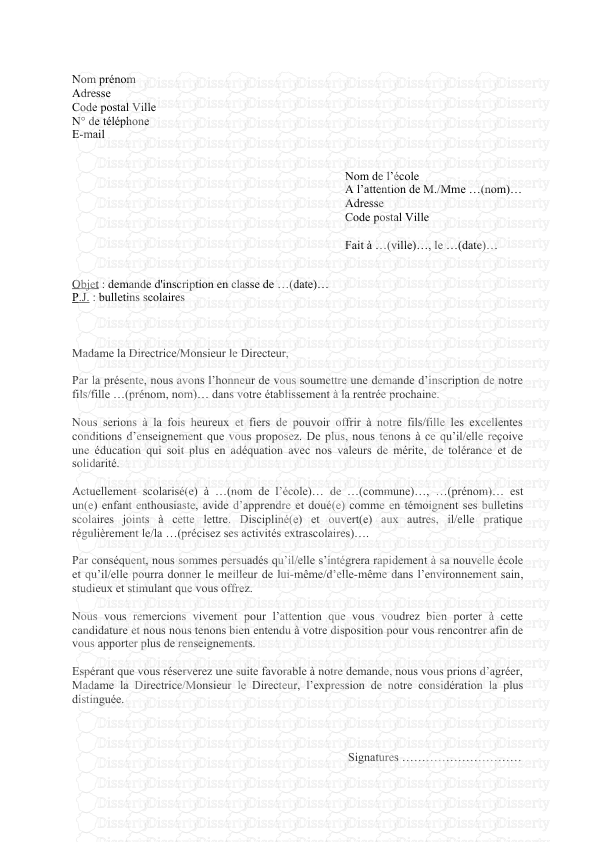








-
100
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 04, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1473MB


