Fantasmagories du capital Marc Berdet Parution :07/02/2013 Pages : 256 ISBN : 2
Fantasmagories du capital Marc Berdet Parution :07/02/2013 Pages : 256 ISBN : 2-355-22035-2 Marc Berdet Fantasmagories du capital L'invention de la ville-marchandise Zones Sommaire INTRODUCTION 1. FANTASMAGORIES PRÉMODERNES ROBESPIERRE AU COUVENT DES CAPUCINES BRETON AU CHÂTEAU D'OTRANTE 2. FANTASMAGORIES MODERNES FOURIER AU PALAIS-ROYAL MARX AU CRYSTAL PALACE BLANQUI DANS PARIS HAUSSMANNISÉ 3. FANTASMAGORIES POSTMODERNE EISENSTEIN À DISNEYLAND GROPIUS AU MALL OF AMERICA KESEY À LAS VEGAS CONCLUSION REMERCIEMENTS Un grand merci à Grégoire Chamayou pour son impulsion décisive et sa confiance, et à Rachel pour ses relectures pugnaces à toutes les étapes de ce livre. Merci aussi à Raphaël Koster pour ses remarques sur Disneyland et à Sébastien Broca pour sa relecture finale. Je remercie mes amis « matérialistes anthropologiques » de Berlin, Paris, Cambridge, Providence et Santiago pour l'émulation critique de ces trois dernières années, le Ciera pour la précieuse expérience qu'il donne aux jeunes chercheurs franco- allemands et les membres du Cetcopra de l'université Paris-I pour m'avoir encouragé à prendre une direction toujours plus anthropologique. Ce livre n'aurait pas pu être écrit sans le programme européen Marie Curie EIF dont j'ai bénéficié pendant deux ans, ni l'accueil chaleureux de Hans-Peter Krüger à la faculté de philosophie de l'université de Potsdam. INTRODUCTION « Le mot de Schiller d'après lequel “les contraires se heurtent au cœur de l'espace” est à nouveau à l'honneur, et un puissant coup de feu matérialiste pénètre les discours trop longtemps enfermés dans le virtuel et les simulacresnote. » Karl Schlögel Vu du ciel, le shopping mall a l'air d'un ballast posé sur un océan d'asphalte. Un parking s'étend de l'autre côté des autoroutes à six voies qui ceinturent le bâtiment. Il est si vaste que, de sa place de stationnement, il faut parfois prendre un bus pour atteindre l'entrée. Au-delà, la banlieue bitumeuse ouvre l'horizon jusqu'aux grands lacs du Minnesota. S'y répètent à l'infini, sur un sol quadrillé comme du papier d'écolier, une série de maisons individuelles toutes à peu près semblables : un carré de pelouse devant, un jardin particulier derrière. D'un peu plus près, le Mall of America évoque un château fort, les parkings attenants faisant office de douves. Comme au premier Moyen Âge, chaque angle de cette dalle de fer et de béton se trouve flanqué d'une tour rectangulaire. Celles-ci abritent les grandes enseignes du centre commercial : Nordstrom, Sears, Macy's et Bloomingdale's. Ces anchor stores doivent attirer comme des aimants le consommateur qui entre par le milieu d'un des segments. Des allées couvertes remplacent ici les courtines qui reliaient les tours du donjon. Chacune évoque un monde en miniature. Seule la galerie nord (North Garden) est sinueuse. Sous un toit transparent, le badaud passe de balcons fleuris en treillages en bois, de ponts suspendus en terrasses. La galerie sud (South Avenue) rappelle un luxueux boulevard typique d'une grande ville d'aujourd'hui. L'avenue est (East Broadway) fait miroiter les néons de la métropole du futur. Enfin, sous le toit de gare ferroviaire de West Market fourmillent des voitures à bras, des marchés divers et des vendeurs à la criée. Le long des façades Renaissance se succèdent places méditerranéennes, cafés viennois et kiosques à journaux. Au centre, le Nickelodeon Universe rassemble tous ces motifs dans un gigantesque parc d'attractions inspiré de personnages d'émissions pour enfants. La topographie du Mall of America (ouvert dans le Minnesota en 1992) reprend clairement, à quelques détails près, les polarisations mythiques qui structurent le plan de Disneyland : au nord, le monde idyllique et non violent de la nature ; au sud, les vitrines de la ville moderne ; à l'est, les technologies du futur ; à l'ouest, les cités du passé. Ces différentes artères convergent vers le parc d'attractions, apparemment libéré de toute nécessité commerciale. Le tout forme un corps merveilleux. Ce shopping mallnote exprime dans son espace les oppositions archétypiques des fantasmagories postmodernes. On retrouve à peu de chose près le même agencement au South China Mall, ouvert en 2005, à Dongguan, dans le Guangdong, actuellement le plus vaste du monde : à l'est, South California met en scène une nature idyllique ; au nord, le thème de San Francisco idéalise l'urbanité moderne ; au sud, le parc d'Amazing World renvoie aux plus grandes avancées technologiques ; à l'ouest, la variation autour d'Amsterdam présente l'urbanité classique des grandes villes européennes. Au centre, un boulevard à la française mène à ces différents pôles mythiquesnote. Ces pôles peuvent permuter, mais ils expriment la même structure : tous les shopping malls semblent s'organiser selon les points cardinaux d'une nature magnifiée, d'une cité idéalisée, d'une technologie futuriste et d'un réel quotidien plus ou moins esthétisé, qui demeure, à l'état brut, le repoussoir principal à partir duquel s'organise tout l'espace. Cette mise en tension de la nature, de la culture et de la technologie, qui redouble, contre le temps d'un présent aliénant, l'enchevêtrement de l'éternité, du passé et du futur, se joue au niveau de la structure, et pas de la surface où pullulent les images. Elle détermine le plan de l'espace et le récit qui s'y déroule, non ses détails figuratifs. Tous les motifs matérialisés dans le plan de masse du shopping mall se retrouvent disséminés pêle-mêle à l'intérieur. Margaret Crawford décrit avec brio cette anarchie apparente au West Edmonton Mall (ouvert au Canada en 1981) : À l'intérieur, le mall présente un spectacle étourdissant d'attractions et de divertissements : une réplique du bateau de Christophe Colomb, Santa Maria, flotte dans un lagon artificiel au fond duquel de véritables sous-marins naviguent dans un impossible paysage aquatique fait de corail importé et d'algues en plastique, au milieu desquels cohabitent des pingouins vivants et des requins en caoutchouc ; non loin d'un clinquant pont en fer victorien, des colonnes en fibre de verre s'écroulent dans un simulacre de ruine ; en face du Leather World et de Kinney's Shoes, des dauphins font leur numéro dans les airs ; de fausses vagues, d'authentiques tigres de Sibérie, des vases de la dynastie Ching et des orchestres mécaniques de jazz sont juxtaposés selon une séquence sans fin de cours éclairées par des toits transparents. Des colonnes disposées en miroir et des murs fragmentent la scène encore davantage, morcelant le mall en un kaléidoscope d'images au bout du compte illisiblesnote. Que ce soit aux États-Unis, en Chine, au Canada ou en Europe, la confusion imaginale règne à tous les étages : le passé et le futur s'enchevêtrent dans un présent insignifiant, le vrai et le faux s'emmêlent dans un « authentique » monde synthétique, le proche et le lointain s'amalgament dans une géographie comprimée, nature et culture se liquéfient dans les jeux d'eau, le même et l'autre s'embrouillent dans un ego omniprésent. Le mall est une machine optique qui fait défiler indifféremment, mélangées au réel, des images de l'histoire, de la nature et de la technique. Le mall est sans doute l'exemple contemporain le plus frappant de ce que nous entendons dans ce livre par fantasmagories, lieux clos saturés d'imaginaires, « rêvoirs collectifs » communs aux visiteurs des Expositions universelles du XIXe siècle, aux joueurs captivés par les néons de Las Vegas au XXe siècle et aux badauds fascinés par les galeries commerciales du XXIe siècle. Depuis près de trois siècles, le capital façonne des environnements oniriques qui, sur fond de règne de la marchandise, refoulent leur origine économique en vue de canaliser les plaisirs individuels et collectifs. L'histoire de l'espace urbain est en ce sens aussi celle d'une mobilisation toujours plus structurée de nos désirs intimes par l'architecture, et cela jusqu'à l'architecture dite « postmoderne ». Au XIXe siècle, le terme « fantasmagorie » apparaît à de nombreuses reprises sous les plumes de Poe, Baudelaire, Balzac ou Mallarmé. Il signifiait alors chimère, rêverie éveillée, représentation nébuleuse qui passe pour la réalité. Mais c'est à Walter Benjamin que nous empruntons cette notion, élaborée dans une discussion avec Adorno pour faire du monde imaginaire du capitalisme un objet privilégié de la théorie critique. Benjamin a thématisé la fantasmagorie durant les dernières années de la composition d'un ouvrage lui-même resté inachevé, Paris, capitale du XIXe siècle. Il n'en a donc qu'esquissé le concept et ne lui a pas donné une forme pleinement aboutie. Comme toute notion benjaminienne d'ailleurs, plutôt que d'être close sur elle-même, la fantasmagorie demeure ouverte à toutes les modulations historiques. Nous nous en emparons ici pour en faire un outil opératoire d'analyse critique du capitalisme moderne et postmoderne, en particulier des espaces dans lesquels il nous a imposé de vivre. Ce livre se compose comme une sorte de visite guidée, à la fois promenade urbaine et voyage dans le temps. Il propose d'arpenter plusieurs lieux emblématiques de cette longue histoire, de déambuler sur des sites légués par différents âges de l'imaginaire marchand. Nous explorerons tour à tour les passages parisiens, les premiers grands magasins, les Expositions universelles, le Paris d'Haussmann et les parcs de Disneyland, avant de revenir au shopping mall et de finir notre excursion sous les néons du Strip de Las Vegas. Ces différents espaces forment autant de strates fantasmagoriques caractéristiques de leur époque. uploads/Geographie/ marc-berdet-fantasmagories-du-capital 1 .pdf
Documents similaires







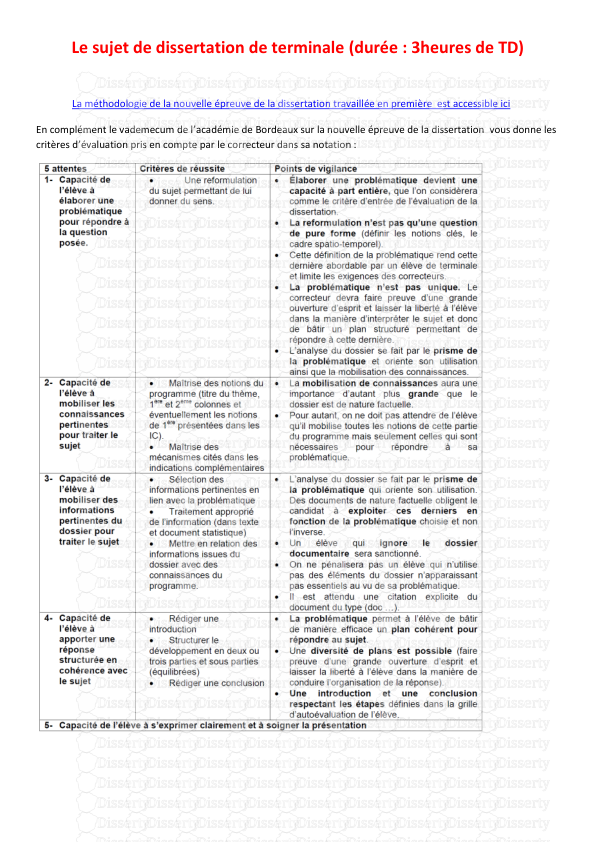


-
45
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 29, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.8077MB


