L'information géographique La mine de charbon : Comment faire comprendre l'orga
L'information géographique La mine de charbon : Comment faire comprendre l'organisation et le fonctionnement d'une mine ? Jean Chardonnet Citer ce document / Cite this document : Chardonnet Jean. La mine de charbon : Comment faire comprendre l'organisation et le fonctionnement d'une mine ? . In: L'information géographique, volume 5, n°2, 1941. pp. 32-37. doi : 10.3406/ingeo.1941.5075 http://www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_1941_num_5_2_5075 Document généré le 06/01/2016 Relief : appalachien Fig. 5. — Structura : plissée. l'érosién a enlevé les terrains tendres et a laissé en saillie les rochss dures (Bretagne). J. GARNIER. LA MINE DE CHARBON Comment faire comprendre l'organisation et le fonctionnement d'une mine? 32 Nul travail n'est en apparence plus simple que celui du mineur : c'est un carrier qui abat des blocs de houille, sous terre. La mine est, en réalité, un organisme bien plus complexe que la carrière : l'abattage du charbon nécessite des installations nombreuses, au fond comme à la surface; le charbon lui-même ne peut être utilisé tel qu'il sort de la mine, mais doit subir un traitement mécanique dans les usines « du jour »; il peut être partiellement traité dans des cokeries annexées à la mine, et les produits de récupération du four à coke donnent, à leur tour, naissance à une importante industrie chimique. La mine moderne comprend donc un ensemble d'installations nécessaires au travail de la mine et aux traitements très variés appliqués au charbon; elle offre l'un des exemples les plus complets d'intégration industrielle. LA FOSSE PROPREMENT DITE Vêtus de coutil léger — car il fait chaud au fond — , la tête couverte du chapeau de cuir bouilli aux larges bords, la traditionnelle barette, une lampe de mineur à la main, quittons le « carreau » de la mine et passons dans une cage d'ascenseur suspendue à un chevalement. 1° Les installations du fonds. — Le puits. — La cage commence à descendre à la vitesse d'un train express (8 à 12 mètres à la seconde) dans un puits assez large. De temps à autre, la lueur vive et fugitive d'une lampe électrique marque l'affleurement d'une galerie; car le puits dessert plusieurs « quartiers » superposés (fig. 1). Parfois un bétonnage clair, un cuvelage, entoure le puits sur quelques mètres de hauteur : les suintements dans la paroi rocheuse nous avertissent du rôle protecteur de cette cuirasse artificielle, sans laquelle les venues d'eau noieraient très rapidement la mine. Brusquement la cage s'est arrêtée au niveau d'une galerie. Jsz: Fig. 1 . — Coupe schématique verticale d'une fosse. Légende : puits servant au personnel et à l'évacuation de l'air vicié, galeries bowettas. tailles, puits servant à la montée du charbon et à l'entrée de l'air frais. Les flèches marquent le trajet de l'air dans la mine. Les galeries d'accès. — Une longue galerie, une « bowette » s'ouvre rectiligne et faiblement éclairée par la lueur courte de nos lampes ; creusée dans le roc, cimentée, assez large, elle rappelle le souterrain du métro en miniature. Toute blanche, elle est recouverte d'une poudre incombustible : les coups de poussière, dus à l'inflammation brusque de la poussière de charbon, sont ainsi évités. Une porte interrompt parfois notre longue marche; plus loin, il faut se baisser pour passer sous une planche dont l'équilibre instable supporte des masses de gravats : utiles protections contre les incendies qu'arrêtent la porte, ou la planche s'affaissant sous un souffle explosif et comblant ainsi la galerie. De gros tuyaux longent la bowette : grosses conduites d'air comprimé, conduite d'eau sous pression pour combattre les incendies, conduite destinée à évacuer l'eau qui sourd dans les galeries. Peu de vie dans ces inter- Fig. 2. — Coupe du bassin minier du Pas-de-Calais dans la région de Bruay (La coupe passe par le puits 7 bis des mines de Bruay.) minables souterrains : à des croisements quelques ouvriers, quelques mots laconiques échangés qui confirment que rien n'est à signaler; mais du fond obscur, une légère cloche, un ronflement de moteur introduisent dans ce silence la vie : des rails parcourent en effet la galerie, rangeons-nous pour laisser passer un train de wagonnets, de « berlines », chargés de charbon, qui, remorqués par une locomotive à air comprimé, s'acheminent vers le puits de sortie . Mais la galerie s'enfonce, elle n'est plus cimentée, elle est moins droite, la bowette boisée commence : des troncs d'arbres de 2 à 3 mètres forment des charpentes en trapèze, à quelque distance les unes des autres; derrière elles, un clayonnage de bois empêche les éboulements; la circulation des wagonnets devient plus active, des bruits parviennent, secs et discontinus : la vie pénètre la galerie; après avoir parcouru plus d'un kilomètre dans les souterrains, nous parvenons à la taille, là où la veine de charbon est soumise à l'extraction. La taille. — Les veines noires de houille apparaissent luisantes, de grosses empreintes de fougères s'inscrivent çà et là sur certains blocs; d'innombrables plissotements ploient la veine en tous sens, ailleurs une petite faille la terminent brusquement au contact de calcaires grisâtres. Le bassin houiller du Nord de la France est ainsi haché de grandes failles obliques; celle de Ruitz, dans la région de Bruay (fig. 2), a un rejet de 1.100 mètres environ, et le niveau dit de la « Poissonnière », proche du crétacé artificiel au Nord-Est de cet accident, plonge à 1 .500 mètres de profondeur au Sud. La figure 3 montre bien ce grand synclinal houiller couché au Nord et chevauché partiellement au Sud par le dévonien. Pénétrons dans la taille, couloir long et bas de plusieurs dizaines de mètres, où l'on ne peut se tenir debout; 50 à 60 ouvriers y travaillent : une dizaine de mineurs s'attaquent à la veine de charbon : la tête protégée de la barette, allongés, couchés ou à genoux, ils tiennent à la main, non plus le pic, mais le marteau pneumatique, un instrument acéré, mû à l'air comprimé, qui frappe de coups violents la couche de charbon, — travail pénible, pour le mineur, par sa position, par la forme musculaire nécessaire pour manier le marteau et l'enfoncer, par l'atmosphère chaude et encrassée de la taille, par le vacarme saccadé des marteaux en action (fig. 3). Les morceaux arrachés à la veine s'éboulent dans la galerie de la taille; des manœuvres les entassent sur de larges bandes caoutchoutées des « convoyeurs », roulant sur des cylindres, ou, à grandes pelletées, ils les jettent dans de grands couloirs en tôle, mus d'un lent mouvement en avant, puis d'un mouvement rapide en arrière; le charbon parvient ainsi au train de berlines. A côté du manœuvre qui déblaie le charbon, un boi- seur étaie le « toit » de la taille de bois verticaux et horizontaux, à mesure que l'extraction progresse. Mais il ne suffit pas de boiser la taille, car tôt ou tard, le bois cède et se brise sous la poussée; pour éviter des éboulements, il faut combler le vide laissé par l'extraction du charbon : un autre convoyeur apporte dans la taille des déblais de toute sorte; des manœuvres aveuglent le vide à grandes pelletées. La taille progresse ainsi, dans le même sens, par extraction et remblaiements successifs. Parfois la roche trop résistante ne se laisse pas abattre par le seul marteau- piqueur : le « boute-feu » fait une sape et tire des coups de mine pour faire sauter des barres de charbon plus dur. Sous la direction du chef porion, qui possède une connaissance pratique approfondie de son métier, mineurs, boiseurs, boute-feu, manœuvres se groupent, solidaires, dans l'équipe qu'impose le travail de la taille. Mais ce travail n'a été lui-même possible que grâce à l'association de nombreuses installations de surface aux installations du fond. Fig. 3. — La taille : à gauche le mineur abat le charbon avec un marteau-piqueur relié par un tube aux conduites d'air comprimé; à droite un manœuvre enleva le charbon abattu et le jette dans le couloir oscillant (1er plan). Premiers boisements dans la taille. (Mines de Lens.) (Comm. par M. Dion.) 2° Les travaux du jour (fig. 4). — Certains sont en effet nécessaires à la vie du « fond », d'autres traitent le charbon extrait. Les annexes du fond. — Ramener à la surface les lourdes berlines de charbon, assurer la descente quotidienne de plusieurs équipes, envoyer au fond déblais 33 et bois, ces opérations répétées nécessitent des instruments élévatoires nombreux et puissants. En général une fosse comprend au moins deux puits, l'un réservé à la montée du charbon dans des cages à plusieurs étages, l'autre servant au personnel et à la descente des bois, tous deux coiffés du chevalement grêle de poutrelles métalliques auquel sont accrochées les cages ; la manœuvre est commandée pour chaque puits d'un bâtiment proche des chevalements et utilise des moteurs électriques. 34 Fig. 4. — Le puits d'extraction et l'usine de lavage à gauche. (Mines de Lens : fosse n° 2.) (Comm. par M. Dion.) Il faut aussi ventiler la mine, y introduire de l'air frais, et évacuer l'air vicié : une dose d'oxyde de uploads/Industriel/ article-j-chardonnet.pdf
Documents similaires




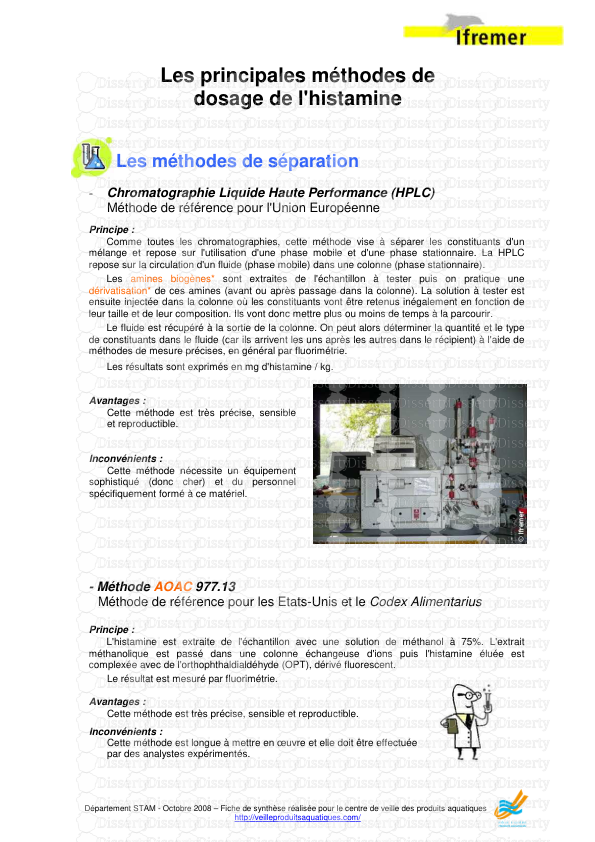





-
51
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 31, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 3.1128MB


