1: COURS DE CARBOCHIMIE Chef de Travaux José KUNANA MANANGA PLAN DU COURS Chap.
1: COURS DE CARBOCHIMIE Chef de Travaux José KUNANA MANANGA PLAN DU COURS Chap. 1 : Généralités sur le charbon 1.1 : Introduction générale 1.2 : Le charbon, une ressource naturelle complexe Chap. 2 : Procédés de conversion du charbon 2.1 : Pyrolyse du charbon 2.2 : Gazéification du charbon 2.3 : Liquéfaction du charbon 2.4 : Techniques de conversion « in situ » Chap. 3 : Etude de quelques procédés carbochimiques 3.1 : Procédé de récupération du Soufre 3.2 : Procédé Plomb et B,T,X 3.3 : La chimie du Benzol et Gaz de cokerie 3.4 : Le procédé UDEX 3.5 : Le procédé IFP BIBLIOGRAPHIE 1. Marc Ferretti : La valorisation du charbon – Gazéification, Liquéfaction, Carbochimie. Technique et Documentation Lavoisier, 1982 2. H. Jeanmart : Caractérisation de la biomasse / Cours 2008-2009 3. M. L. Bilanda : Cours de Chimie industrielle / Faculté Polytechnique UNILU. 2: CHAP.1 : GENERALITES SUR LE CHARBON 1.1 : INTRODUCTION GENERALE La stratégie optimale du développement énergétique sur le plan international fait l’objet de débats passionnés et varie d’ailleurs en fonction des conditions nationales très diverses. Mais, il est certain qu’avec l’épuisement graduel de réserves pétrolières, elle fera une place certainement importante au charbon, bien que variable suivant le pays. En effet, fixer le rôle futur du charbon n’est pas une tâche aisée. Il faut évaluer les possibilités de ce combustible, non pas à la lumière des services qu’il a rendu dans le passé, mais en tenant compte d’une véritable prospective technologique. Il est vrai que nos réserves en combustibles fossiles solides représentent près de 80% des ressources fossiles exploitables, soit sept fois plus que le pétrole et le gaz. Ainsi, il est normal que notre monde assoiffé d’énergie se tourne une fois de plus vers les combustibles solides, plus spécialement le charbon, quand les autres s’épuisent. L’augmentation du prix du pétrole conduit à l’introduction sur le marché de sources d’énergie de remplacement telles que les énergies nouvelles et renouvelables (énergie solaire, énergie éolienne, énergie géothermique,…), l’énergie nucléaire et même le charbon. Ainsi, un retour au charbon s’impose, dans la mesure où les énergies renouvelables semblent devoir rester marginales par rapport à l’immensité de nos besoins, et dans la mesure où l’énergie nucléaire ne saurait les satisfaire tous, soit parce que son développement sera freiné par des craintes irraisonnées, soit parce qu’elle ne se présente pas sous toutes les formes désirées. En effet, le charbon dispose de multiples atouts : son abondance est suffisante pour lui permettre de subvenir aux besoins énergétiques du monde pendant plusieurs décennies, couvrant par là-même la période nécessaire à la mise en place des nouvelles technologies (solaires, biomasse,…). En outre, le charbon est plutôt mieux reparti à la surface de la planète que ne le sont les ressources pétrolières confinées dans des régions privilégiées du globe. Son caractère universel en fait un combustible sûr. La structure chimique extrêmement complexe du charbon peut être très largement mise en valeur par des techniques déjà bien connues : gazéification, liquéfaction, etc. Mais l’intérêt du charbon n’est pas seulement énergétique. Devenant la principale source de l’atome de carbone, il est à la base d’une chimie organique assez différente de celle qui dérive du pétrole : c’est la carbochimie. La Carbochimie c’est au fait une branche de l’industrie chimique qui exploite les sous- produits de la distillation de la houille (combustible minéral solide riche en charbon). La carbochimie a constitué l’une des bases du développement de l’industrie chimique au cours du XIXe siècle. Mais avec l’abandon progressif du coke dans l’industrie lourde et l’invention de la voiture à essence en 1880, la carbochimie a été supplantée par la 3: pétrochimie qui est une branche de l’industrie chimique qui utilise comme matières premières les produits dérivés du pétrole ; autrement la chimie des dérivés du pétrole. 1.2 : LE CHARBON, UNE RESSOURCE NATURELLE COMPLEXE 1.2.1 : Le retour du charbon Le charbon est né avec la révolution industrielle du Moyen-âge. Du XI au XIIIème siècle, l’Europe occidentale connut une période d’intense activité technologique. Certes, l’Antiquité connaissait déjà les machines, mais elle n’en fit qu’un usage limité, utilisant l’engrenage principalement pour animer jouets et automates. La société médiévale remplaça le travail manuel par le travail des machines. Cette époque se signale aussi par une forte explosion démographique. Des populations en mouvement émigrèrent, défrichèrent, colonisèrent des territoires nouveaux, et construisirent des villes neuves. L’explosion démographique causa ravages et destructions dans l’environnement de l’Europe médiévale. On détruisit des milliers d’hectares de forêts pour augmenter la superficie des terres arables et des pâturages. Le bois était alors le principal combustible tant à usage domestique qu’industriel. Il servait à la construction des maisons, des moulins à eau et à vent, des ponts, des machines à tisser, des installations militaires et des forteresses, des navires, etc. Les conséquences d’un tel gaspillage se firent rapidement sentir. Ainsi, l’augmentation du prix du bois en raison de sa rareté croissante devint catastrophique. Il fallut importer du bois de Scandinavie, et chercher un combustible de remplacement. Le charbon fut ce nouveau combustible. 1.2.2 : Nouvelles utilisations Indépendamment de l’utilisation du charbon comme combustible, des nouvelles utilisations apparaissent avec le progrès technologique (machine à vapeur, pompe à feu, machine de Watt,…) : la traction et l’entraînement mécanique des machines. Cependant, l’utilisation du charbon sous sa forme naturelle présente de nombreux inconvénients. Ainsi, le français Philippe Lebon s’est attaché à mettre au point un procédé pour tirer de la houille un gaz utilisable comme source d’énergie. C’est au fait la toute première technique de gazéification. Il obtient ses premiers résultats en 1789. D’où le développement de l’éclairage au gaz quelques années plus tard. Dans le dernier quart du siècle, plusieurs inventions (dynamo de Gramme, lampe à filament, moteur asynchrone) ouvrent au charbon une voie nouvelle : l’électricité. L’Allemagne de Bismarck connait une gerbe de découvertes fondamentales en Physique et en Chimie qui sont immédiatement appliquées (colorants, explosifs, engrais, produits de synthèse, textiles artificiels,…), et qui lancent une puissante industrie. Cinquante sociétés 4: de la Ruhr créent dès 1858 un programme de recherche sur les dérivées du charbon et en 1876, le cartel des maîtres de la Ruhr contrôle la moitié de la production industrielle du pays. Après la première Guerre Mondiale, le charbon affirme sa place prépondérante tant comme source d’énergie que matière première. A partir de 1925, à la suite des travaux de Georges Claude sur la fabrication de l’ammoniac, le gaz provenant des fours à coke devient la matière première d’une industrie de synthèse qui oriente l’industrie charbonnière vers la chimie. 1.2.3 : Formation du charbon Le charbon qui est extrait à l'heure actuelle provient de générations de végétaux morts, accumulés au fond d'anciens marais tropicaux. Ces débris végétaux ont d'abord formé une matière organique compacte, la tourbe. Puis, des couches de sédiments se sont progressivement accumulées sur la tourbe ; la température au sein de ces couches et la pression exercée par celles-ci ont entraîné une diminution progressive de l'humidité et accru la teneur en carbone de la tourbe, formant ainsi le charbon. A des époques géologiques reculées, et surtout pendant l'époque carbonifère, une grande partie du monde fut couverte d'une végétation luxuriante qui poussa dans les marais. Nombre de ces plantes étaient des sortes de fougères, certaines aussi hautes que les arbres. Cette végétation mourut et se retrouva sous l'eau, où elle se décomposa progressivement. Lors du processus de décomposition, la matière végétale perdit des atomes d'oxygène et d'hydrogène, laissant un dépôt à forte teneur en carbone. C'est ainsi que se formèrent des tourbières. Avec le temps, des couches de sable et de boue en suspension dans l'eau sédimentèrent sur certains des dépôts de tourbe. La pression de ces couches sous-jacentes, mais aussi les mouvements de la croûte terrestre et parfois la chaleur des volcans agirent pour comprimer et durcir les dépôts, produisant ainsi du charbon. 1.2.4 : Différents types de charbon Un simple examen à l’œil nu suffit à se convaincre que le charbon est une substance extrêmement hétérogène. Cette diversité tire son origine à la fois de celle des végétaux de départ (algues, champignons, fougères, arbres,…), de leurs éléments constitutifs et des différences dans les conditions de dépôts et de macération (durée, température, pression, pH, présence ou absence d’oxygène). Une diversité supplémentaire est apportée par l’évolution (« houillification ») qui a conduit successivement des débris végétaux initiaux aux différents types de charbon que voici : 1. La Tourbe : Noirâtre ou brunâtre, matière fibreuse, légère, de formation quaternaire, elle a une teneur en carbone faible par rapport aux autres types de charbon, et a un taux d'humidité important. Après dessiccation, sa combustion dégage beaucoup de fumées, peu de chaleur et laisse des résidus importants. 2. La Lignite : De couleur noire, brun-noirâtre et parfois franchement brune, de formation tertiaire. Sa structure fibreuse plus homogène que la tourbe, laisse néanmoins 5: apparaître des rameaux et de grosses branches. Plus riche en carbone que la tourbe, mais avec une teneur en matières volatiles élevée, la lignite reste un combustible assez médiocre. 3. uploads/Industriel/ cours-de-carbochimie-ipg-kin 1 .pdf
Documents similaires



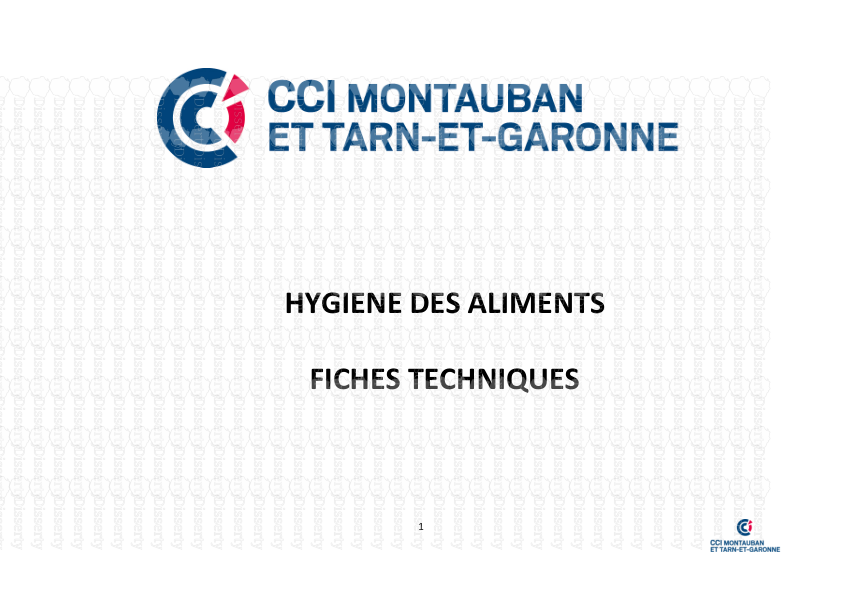






-
51
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 17, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 7.6303MB


