1 L’Agro-Pôle Olivier de Meknès : un partenariat public privé pour l’innovation
1 L’Agro-Pôle Olivier de Meknès : un partenariat public privé pour l’innovation dans la filière huile d’olive au Maroc Etude de cas pour l’étude sur l’économie de la recherche au Cameroun, Cirad, MESRI Patrick Dugué CIRAD Mai 2014 Introduction Dans le secteur agricole, l’Agro-pôle 1 Olivier constitue une structure originale au service de l’Innovation pour les acteurs de la filière olivier – huile d’olive au Maroc et plus particulièrement dans la région2 Meknès Fès. Après une dizaine d’années d’expérience il est apparu intéressant de retenir cette étude de cas pour l’étude commanditée par le MINRESI Cameroun. Cette structure unique au Maroc apporte un appui à la filière olivier – huile d’olive pour la moitié Nord du pays mais ces résultats surtout dans le domaine de la transformation des olive en huile sont applicables sur l’ensemble du pays et les autres pays au sud de la méditerranée. Cette étude de cas est basée sur la consultation de la littérature institutionnelle, technique, et scientifique, des articles de presse et sur des entretiens avec le directeur d’Agro-pôle Olivier, des producteurs d’olives et d’huile de la région de Meknès et un président de coopératives. 1. La Filière Olivier au Maroc En couvrant 60 % de la surface arboricole du Maroc, l’olivier est la première culture pérenne du pays avec environ 784 000 ha, soit 11 % de la SAU (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime MAPM, 2011) avec une production moyenne de 1 500 000 t d’olives et une contribution de l’ordre de 5% au PIB agricole. Le Maroc est le 2ème exportateur mondial d’olives de table3 après l’Espagne, avec une moyenne annuelle de près de 65 000 t mais seulement le 10 ième exportateur d’huile d’olive avec seulement 21 000 t d’huile d’olive soit 2% des exportations mondiales (Chiffre moyen, avec un maximum de 38 000 t exportées en 2011 et seulement 15 600 t en 2012). En comparaison les exportations tunisiennes correspondent à 20% des exportations mondiales, l’Espagne arrivant largement en tête. La défaillance structurelle de qualité du processus productif d’huile d’olive est la cause principale de ce retard par rapport aux autres pays du pourtour méditerranéen, malgré l’accroissement4 de la production des olives cette dernière décennie (figure 1). La majorité de la production est traitée dans des unités de trituration artisanales ou semi-industrielles ne 1 A ne pas confondre avec les deux projets appelés Agropole ou Agropolis de Berkane (Région de l’Oriental) et de Meknès (Région Meknès-Tafilalet) qui sont des zones d’activités et des projets immobiliers visant à rassembler sur deux sites proches de ces deux villes des agro-industries et des prestataires de service en relation avec la production agricole, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. L’Agro-pôle Olivier se situe dans l’enceinte de l’ENA, proche du centre INRA Meknès et à 1 km environ d’Agropolis Meknès qui est en cours d’installation. 2 Ces deux villes Impériales très visitées par les touristes sont les chefs lieux des régions administratives Meknès-Tafilalet et Fès-Boulemane 3 L’étude de cas Agropole Olivier traite uniquement de la production des olives pour l’huile, de la transformation et de la mise en marché. Cette structure n’aborde pas la filière « olives de table » qui relève de structures artisanales et de quelques agro-industries exportatrices très bien implantées sur le marché international 4 Lors de la campagne 2009/10, la production d’huile d’olive a été de l’ordre de 140 000 t (soit une augmentation de 215% par rapport à l’année 1998/1999). Le Maroc est le 5ième producteur mondial de l’huile d’olive. 2 produisant pas d’huile extra vierge. Les nouvelles unités de trituration installées avec l’appui des projets PMV, MCA) ou par des agro-industries et des grandes exploitations oléicoles sont à la pointe du progrès technologique et reposent sur le système d’extraction par centrifugation. En fait le choix de l’équipement n’est pas essentiel pour garantir la qualité gustative et sanitaire mais c’est plutôt le délai entre la cueillette des olives et la trituration qui ne doit pas dépasser quelques heures et le lavage de la production qui importent. L’oléiculture marocaine connait actuellement une grande expansion en superficie : 763 000 ha en 2007/08 à 933 475 ha en 2012/13. Cet accroissement s’explique notamment par la mise en œuvre du Plan Maroc Vert (PMV) qui fixe comme objectif 1,2 millions d’hectares d’oliviers en 2020. En termes de production, la filière oléicole a connu une nette croissance passant de 765 377 tonnes d’olives en 2007 à 1,3 million de tonnes avec un pic de 1,5 millions de tonnes en 2010. Les consommateurs marocains recherchent une huile au gout prononcé ce qui n’est pas le cas des consommateurs des pays d’exportation (Europe, USA …). Aujourd’hui les exportations sont le fait presque uniquement de grandes exploitations agricoles qui disposent des équipements et du savoir faire pour correspondre aux qualités demandées par ces marchés. Mais l’huile d’olive est un bien de consommation courante surtout en milieu rural (40 % de la population, la grande majorité des agriculteurs produisent l’huile pour leur consommation familiale). En milieu urbain l’huile d’olive est un produit onéreux, 2 à 3 fois plus cher que l’huile végétal bas de gamme importée. Le Maroc est très dépendant des importations d’huile végétale (environ 70% de la consommation nationale) c’est pour cela que l’Etat a massivement subventionné la plantation d’oliviers (en pluvial et en irrigué) depuis 2010 dans le cas du Plan Maroc Vert. En moyenne un marocain consomme par an 2,5 kg d’huile d’olive et 11 kg d’huile végétale (principalement importée). L’objectif du gouvernement est de stimulé la consommation d’huile d’olive afin de revenir à la diète méditerranéenne en visant un objectif de consommation de 4 kg d’huile d’olive par an et par habitant. Figure 1 : Evolution de la production de la consommation et des exportations d’huile d’olive au Maroc (d’après A.Saïdi, 2012) 2. La Filière Olivier dans la région Meknès-Tafilalet Cette région est la principale zone de production d’huile d’Olive au Maroc et concentre les grandes exploitations de type agro-industriel (60% de la production nationale, 80% des 3 exportations). La production, est assurée par une agriculture duale : un grand nombre de petites exploitations avec des plantations en pluvial (bour) principalement, et quelques grandes fermes de plusieurs centaines d’ha d’oliviers irrigués chacune avec des systèmes de culture intensifs ou super intensifs (type espagnol, haute densité5, goutte à goutte, récolte mécanisée). Les cultures pluviales sont présentent un peu partout pour la production familiale souvent en haies clôturant les parcelles agricoles. Mais elles se concentrent surtout dans les zones de pente qui sont difficilement mécanisables et donc peu propices aux grandes cultures annuelles pluviales (céréales, légumineuses à graine). Les exploitations familiales n’irriguent presque jamais l’olivier. Par contre les grandes exploitations entrepreneuriales ont planté récemment de l’olivier mais toujours en plaine (mécanisation poussée), en ligne et irrigué afin d’accroitre les rendements et de régulariser la production les années de faible pluviométrie (rendements en pluvial de 0,8 à 1,5 t/ha d’olive, en irrigué 1,8 à 4 t/ha). Les systèmes de culture irrigués intensifs et super-intensifs ont été mis au point en Espagne et adaptés au contexte marocain. Ce transfert de technologies est le fait des sociétés vendant le matériel, de quelques responsables de sociétés agricoles visitant les salons agricoles en Europe et des exploitations en Espagne et en Italie et enfin de l’Agro-pôle Olvier. Ce choix pour les systèmes de culture super-intensif fait l’objet de controverses dans les domaines de la durabilité économique et sociale (pas d’emploi nécessaire pour la récolte) et de leurs impacts environnementaux (traitements systématiques contre la mouche, irrigation, grande surface en monoculture d’olivier et perte de biodiversité) et du choix variétal (variétés locales vs variétés importées). Alors que les systèmes de culture pluviaux sont pratiquement conduits en Bio (sans pesticide, sans engrais, avec du fumier) et fournissent du travail aux actifs familiaux et salariés. A contrario les unités de traitement traditionnelles (maâsaras), ou semi-industrielles qui travaillent pour les agriculteurs familiaux6 sont très polluantes car elles rejettent les margines dans les oueds et donc les nappes phréatiques alors que les unités modernes des grandes entreprises sont aux normes européennes en terme de traitement des rejets. En termes de qualité de l’huile produite les grandes entreprises arrivent à des qualités bonnes à exceptionnelles souvent primées au niveau international ce qui leur ouvre des débouchés à l’export à des niveaux assez rémunérateurs. L’huile d’olive issue de l’agriculture familiale est de qualité médiocre à moyenne (rarement classée extra vierge) ce qui peut poser des problèmes de santé public. Mais la qualité progresse surtout depuis la mise en service d’unités de trituration financées par le PMV qui permettent d’atteindre des niveaux de qualité7 tout à fait acceptables pour le marché local et même à l’export. Ces succès obtenus par les entreprises privées (qualité, quantité) ne doivent pas cacher l’état préoccupant de la filière huile d’olive en 2014. Les exportateurs peinent à vendre à l’export sauf pour des huiles haut de gamme. Sur le marché national la concurrence avec les huiles végétales de bas prix est bien présente surtout avec le début de crise économique uploads/Industriel/ cas-d-x27-etude-agropole-olivier-maroc-vf.pdf
Documents similaires



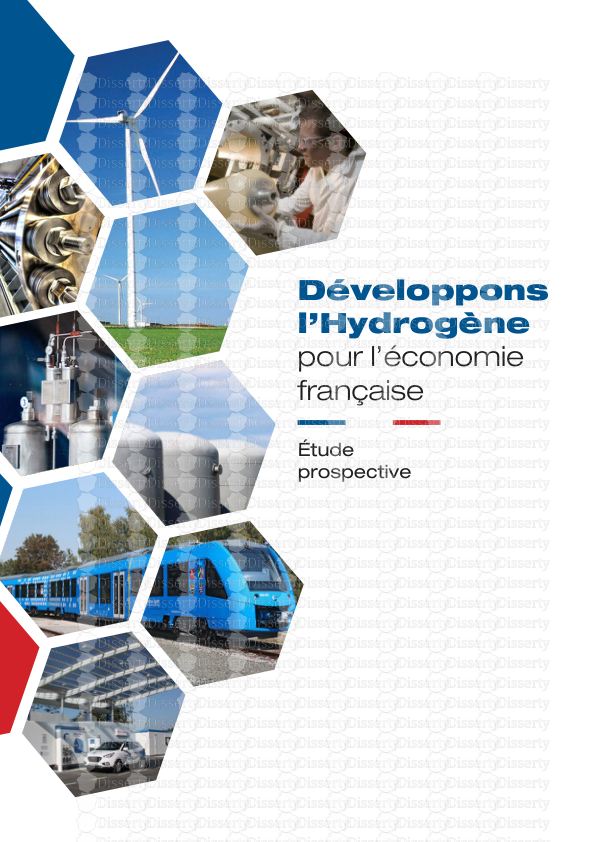






-
102
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 19, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6226MB


