UNIVERSITE DE SOUSSE ******** Institut Supérieure des Sciences Appliquées et de
UNIVERSITE DE SOUSSE ******** Institut Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse Département de Génie Mécanique Eléments de cours Commande des systèmes industriels (3ème année formation d’Ingénieurs ITR) Elaboré par : - Mr. HOUIDI Ajmi Année Universitaire 2010/2011 ISSAT SOUSSE Cité Ettafela Ibn Khaldoun, 4003, Sousse-Tunisie Tél : 216-73.382.656 e-mail : issats@issatso.rnu.tn Télécopie : 216-73.382.658 Commande des systèmes industriels Département d’informatique A.HOUIDI -2- A.U.2011/2012 Généralités Chaque processus industriel de fabrication ou de transformation se compose d’un ensemble de machines destinées à réaliser la fabrication ou la transformation considérée. Chaque machine ou partie opérative comprend un ensemble de moteurs, vérins, vannes et autres dispositifs qui lui permet de fonctionner. Ces moteurs, vérins, vannes et autres dispositifs s’appellent actionneurs. Ils sont pilotés par un automate ou partie commande (PC). Cette partie commande élabore les ordres transmis aux actionneurs à partir des informations fournies par la machine au moyen d’interrupteurs de position, thermostats, manostats et autres dispositifs appelés capteurs. La partie commande reçoit également des informations transmises par un opérateur en fonctionnement normal, ou un dépanneur en cas de réglage ou de mauvais fonctionnement de la partie commande ou de la partie opérative. Entre la partie commande et l’homme se trouve la partie dialogue qui permet à ce dernier de transmettre des informations au moyen de dispositifs adaptés (boutons poussoirs, commutateurs,etc.) Structure générale d’un système automatisé De même, la partie commande retourne vers l’homme des informations sous des formes compréhensibles par lui (voyant, afficheurs, cadrans, etc.). Ainsi, entre l’homme et la partie opérative, s’instaure un dialogue homme – machine dont l’importance naguère sous-estimée est aujourd’hui reconnue et qui est actuellement l’objet de nombreuses études. 2 Structure des automatismes Partant des définitions de base énoncées au paragraphe précédent, nous allons maintenant détailler les éléments constitutifs d’un automatisme (figure suivante). Partie opérative Partie commande Partie dialogue Processus industriel Opérateur ou dépanneur Commande des systèmes industriels Département d’informatique A.HOUIDI -3- A.U.2011/2012 Analyse de la partie opérative : La partie opérative se compose de trois ensembles : • L’unité de production dont la fonction est de réaliser la fabrication ou la transformation pour laquelle elle remplit un rôle dans le processus industriel, • Les actionneurs qui apportent à l’unité de production l’énergie nécessaire à son fonctionnement à partir d’une source d’énergie extérieure (cas d’un moteur, par exemple). Ces actionneurs peuvent aussi prélever de l’énergie sur l’unité de production pour la retourner vers un récepteur d’énergie extérieur (cas d’un frein, par exemple). • Les capteurs qui créent, à partir d’informations de natures divers (déplacement, température, etc.), des informations utilisables par la partie commande (ouverture ou fermeture d’un circuit électrique, par exemple) Analyse de la partie commande La partie commande se compose de quatre ensembles : • Les interfaces d’entrée qui transforment les informations issues des capteurs placés sur la partie opérative ou dans la partie dialogue en informations de nature et d’amplitude compatible avec les caractéristiques technologiques de l’automate. • Les interfaces de sortie qui transforment les informations élaborées par l’unité de traitement en informations de nature et d’amplitude compatibles avec les caractéristiques technologiques des préactionneurs d’une part, des visualisations et avertisseurs d’autre part ; • Les préactionneurs qui sont directement dépendants des actionneurs et sont nécessaires à leur fonctionnement (démarreur pour un moteur, distributeur pour un vérin, etc) ; • L’unité de traitement qui élabore les ordres destinés aux actionneurs en fonction des informations reçues des différents capteurs et du fonctionnement à réaliser. Unité de production Actionneur Capteurs Interface d’entrée Interface de sortie Pré actionneur Interface d’entrée Interface de sortie Unité de traitement Partie opérative ou machine Partie commande ou automate Capteurs manuels Visualisations Avertisseur Partie dialogue Homme (opérateur ou dépanneur) Commande des systèmes industriels Département d’informatique A.HOUIDI -4- A.U.2011/2012 Analyse de la partie dialogue La partie dialogue se compose de deux ensembles : • Les visualisations et avertisseurs qui transforment les informations fournies par l’automate en informations perceptibles par l’homme (informations optiques ou sonores) ; • Les capteurs qui transforment les informations fournies par l’homme (action manuelle sur un bouton-poussoir, par exemple) et informations exploitables par l’automate. Commande des systèmes industriels Département d’informatique A.HOUIDI -5- A.U.2011/2012 LE GRAFCET 1. Introduction : Le GRAFCET est un diagramme fonctionnel dont le but est de décrire graphiquement les différents comportements d'un automatisme séquentiel. Créé par l'AFCET (Association Française pour la Cybernétique Économique et Technique), le Grafcet est la synthèse d'une vingtaine de systèmes de description proposés à l'origine (1976). Sa promotion en a été faite par l'ADEPA (Agence pour le DEveloppement de la Production Automatisée) puis a été acceptée par les instances internationales de normalisation, notamment par le Comité Électrotechnique International dans sa publication 848 de l'année 1988 d'où proviendront de large extraits de ce cours (CEI 848) Domaine d'application du GRAFCET Le GRAFCET (Graphe Fonctionnel de Commande Etape Transition), également appelé Diagramme Fonctionnel en Séquence ou Sequential Function Chart (SFC), permet "l'établissement des descriptions de la fonction et du comportement des systèmes de commandes en établissant une représentation graphique indépendante de la réalisation technologique". La figure ci-dessus montre la structure d'un système de commande (ou système automatisé de production) ainsi que ses relations avec l'opérateur et avec les produits, objets de la production. Le système de commande se décompose en une partie opérative (PO) et une partie commande (PC). La partie opérative est composée du processus physique que l'on souhaite piloter (elle comprend notamment les actionneurs, pré-actionneurs et capteurs). La partie commande est constituée de l'automatisme qui élabore les ordres destinés au processus et les sorties externes (visualisation) à partir des comptes rendus de la partie opérative, des entrées externes (consignes) et de l'état du système. Plus pragmatiquement, le GRAFCET est destiné à représenter des automatismes logiques séquentiels, c'est à dire des systèmes événementiels dans lesquels les informations sont de type booléennes (tout ou rien) ou peuvent s'y ramener (numériques). Le GRAFCET est utilisé généralement pour spécifier et concevoir le comportement souhaité de la partie commande d'un système de commande mais il peut également être utilisé pour spécifier le comportement attendu de la partie opérative ou bien de tout le système de commande. Commande des systèmes industriels Département d’informatique A.HOUIDI -6- A.U.2011/2012 Destiné à être un moyen de communication entre l'automaticien et son client, le GRAFCET est un outil utilisé pour la rédaction du cahier des charges d'un automatisme. Cependant un des points forts du GRAFCET est la facilité de passer du modèle à l'implantation technologique de celui-ci dans un automate programmable industriel. Le GRAFCET passe alors du langage de spécification au langage d'implémentation utilisé pour la réalisation de l'automatisme. On parle ainsi de grafcet de spécification et de grafcet de réalisation. Les chapitres suivants seront donc consacrés à la définition du GRAFCET et à son utilisation en tant que langage d'implémentation. 2. Exemple Poinçonneuse semi-automatique : Position haute Position basse Montée Descente Tôle Marche Figure 1 Constitution de la poinçonneuse La poinçonneuse représentée très schématiquement ci-contre se compose d'une table fixe recevant la tôle à poinçonner et d'un poinçon mobile. Considérons la poinçonneuse en sa position origine au repos, poinçon en haut (configuration initiale). L'opérateur en donnant l'information "Marche" provoque automatiquement la descente du poinçon puis sa remontée en position repos. Nous dirons alors que la poinçonneuse décrit un cycle de fonctionnement. Une telle machine présente successivement trois comportements différents : repos, descente et montée. Nous appellerons étape chacun de ces comportements. haute basse basse haute basse haute Figure 2 Description des étapes Ces trois étapes sont : • ETAPE 1 - Comportement : La poinçonneuse est au repos • ETAPE 2 - Comportement : Descendre le poinçon • ETAPE 3 - Comportement : Remonter le poinçon Il s'agit maintenant de préciser ce qui provoque un changement de comportement de la machine c'est à dire les conditions logiques qui déterminent le passage d'un comportement à un autre. Nous qualifierons chaque passage d'un comportement à un autre comme étant le franchissement d'une transition pour bien montrer son irréversibilité. Par exemple, le passage de la position de repos (étape 1) à la descente du poinçon (étape 2) ne peut s'effectuer que si l'opérateur fournit l'information "Marche" et que si le poinçon est en position haute (Conditions Initiales (CI)). Commande des systèmes industriels Département d’informatique A.HOUIDI -7- A.U.2011/2012 Ces deux informations, "Marche" et "Conditions Initiales", constituent la condition de transition appelée "Réceptivité" associée à la transition de l'étape 1 vers l'étape 2 ( ) 1 2 t → . Cette description de fonctionnement de la poinçonneuse est représentée par le GRAFCET suivant : Commentaires ........ TRANSITION : ........ TRANSITION : ........ ETAPE : ........ TRANSITION : ........ ETAPE : ........ ETAPE : Figure 3 Grafcet fonctionnel de la poinçonneuse Nous remarquerons que ce Grafcet correspond à une succession alternée d'étapes et de transitions. Nous associerons : • À chaque étape, le comportement ou l'action(s) à obtenir. • À chaque transition, les informations permettant leur franchissement sous la forme d'une condition logique ou réceptivité. Nous pouvons donc, dans un premier temps, définir une étape comme une situation du cycle de fonctionnement pendant laquelle le comportement de l'automatisme demeure constant. uploads/Industriel/ cours-api-grafcet.pdf
Documents similaires









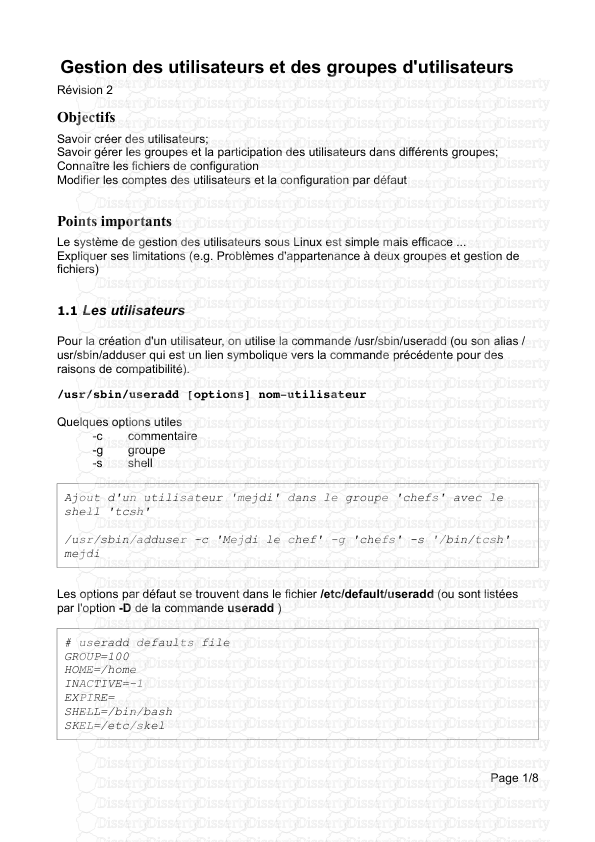
-
83
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 23, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4264MB


