l’actualité chimique - janvier 2006 - n° 293 Comment ça marche ? 3 Le cuir : ch
l’actualité chimique - janvier 2006 - n° 293 Comment ça marche ? 3 Le cuir : chimie, mécanique et sensualité Le chrome et ses complexes pour le tannage des peaux Éric Degache et Anne-Laure Hans Résumé Le cuir est un matériau noble issu de la transformation chimique et mécanique de la peau animale. La transformation d’un organe aussi complexe, opérée dans les tanneries, fait appel à des réactions chimiques et physico-chimiques nombreuses dont les mécanismes ne sont pas complètement connus. Le procédé de tannage le plus répandu actuellement utilise des sels de chrome trivalent sous forme de sulfate basique. Cet élément forme facilement des complexes et c’est par des liaisons de coordination qu’il se fixe sur le collagène, principale protéine de la peau, pour le stabiliser. On obtient un intermédiaire de fabrication d’une grande souplesse d’utilisation que l’on peut orienter vers tous les types de cuirs. Les tentatives pour substituer le chrome par des composés organiques sont freinées par leur manque de polyvalence. Mots-clés Cuir, tannage, formulation, complexes, sulfate de chrome trivalent, glutaraldéhyde, tanins synthétiques, tanins végétaux. Abstract The leather, chemical and mechanical treatments to bring sensuality Leather is a noble material created by chemical and mechanical treatment of animal skins. The transformation of such a complex organ is performed in tanneries, using numerous chemical and physicochemical reactions whose mechanisms are not completely understood. Currently, the most commonly used tanning process uses trivalent chromium salts in basic sulfate form. This element easily forms complexes and fixes onto collagen, the main skin protein, by coordination bonds, thus stabilizing it. The intermediate material obtained has a wide range of applications and can be oriented toward all kinds of leather uses. Attempts to substitute the chromium with organic compounds have been slowed down by their lack of polyvalence. Keywords Leather, tanning, formulation, complexes, chromium(III)sulfate, glutaraldehyde, synthetic tanning agent, vegetable tanning agent. rès tôt, les Hommes ont été tentés d’utiliser les dépouilles d’animaux abattus comme vêtements ou éléments de construction. Mais ils se sont heurtés à la putrescibilité de ce matériau contenant plus de 50 % d’eau. Pour le conserver, le génie de l’empirisme a poussé nos lointains ancêtres à utiliser le séchage et le fumage qui ne fournissaient qu’un matériau partiellement stabilisé et manquant de souplesse. Le tannage, et donc le cuir, apparaît à la fin du néolithique avec l’utilisation de l’alun (sulfate double d’aluminium et de potassium) ou de copeaux végétaux concentrés en tanins. Jusqu’au XIXe siècle, le tannage est le fait d’artisans dispersés sur tout le territoire au plus près des lieux d’abattage puisque les peaux brutes ne se conservent pas. Ces artisans se font une solide réputation d’empesteurs publics, d’autant plus qu’ils ont la mauvaise habitude de récupérer les excréments canins riches en éléments réducteurs pour l’épilage et l’assouplissement du cuir. L’ère industrielle révolutionne cet artisanat. D’abord le tannage qui était statique en cuve devient dynamique et beaucoup plus rapide avec l’apparition du foulon (gros cylindre horizontal tournant sur son axe) (figure 1). C’est aussi le moment où le développement de la chimie commence à expliquer les réactions mises en jeu dans la fabrication du cuir [1]. La mise au point industrielle du tannage au sulfate de chrome trivalent dans les années 1880 par l’Allemand T Figure 1 - Foulons de tannage (©Tannerie Bultonic à Ponte Egola, Italie). l’actualité chimique - janvier 2006 - n° 293 Comment ça marche ? 4 La structure de la peau et le collagène [a-b] La peau se divise en deux parties principales : • l’épiderme et les productions épidermiques (poils, plumes, écailles) constitués de kératine ; • le derme dont les constituants sont nombreux. La plupart seront éliminés avant le tannage pour isoler la structure fibreuse du collagène. Plus on se rapproche de la surface extérieure de la peau, plus les fibres sont fines. La « fleur » offre donc ainsi un aspect lisse, tandis que la chair montre des fibres grossières (voir figure A). La structure de la peau varie d’une espèce animale à l’autre (figure B). Les reptiles et les poissons possèdent des structures bien différentes du schéma de la figure A. C’est la surface du derme qui permet de distinguer les espèces. Les mammifères et les oiseaux se distinguent par la grosseur, l’orientation et la profondeur de l’implantation des poils ou des plumes. Les poissons et les reptiles se distinguent par la forme de leurs écailles et leurs finesses. Le collagène C’est la protéine la plus importante de la peau. Les fibres de collagène, qui se décomposent structurellement en fibrilles et en microfibrilles, sont des enchaînements d’acides aminés reliés par des liaisons peptidiques (NH-CO) (figure C). R1 et R2 sont les radicaux, c’est-à-dire les chaînes latérales provenant des acides aminés constituant la protéine. L’enchaînement des 1 052 acides aminés d’une chaîne de colla- gène est particulier. La glycine, qui revient tous les trois acides ami- nés, et une proportion importante d’hydroxyproline favorisent la structure hélicoïdale. En pratique, la molécule de collagène est cons- tituée de trois chaînes hélicoïdales qui s’organisent en une triple hélice sur la plus grande partie de leur longueur, en laissant libres les extrémités de quelques dizaines d’acides aminés. Sur la lon- gueur de la triple hélice, il y a des régions acides et basiques, la charge superficielle se répète selon une période D de 234 radicaux, soit un quart de la partie organisée en triple hélice. Les molécules de collagène se lient avec un décalage correspondant à la période D pour constituer des microfibrilles (d’une largeur de cinq molécules). • Acides aminés importants pour la structure du collagène : • Acides aminés importants pour le tannage au chrome : Références [a] Jullien I., Prévot J., Gavend G., La peau, matière première brute de la tannerie-mégisserie, Ouvrage CTC, 1975. [b] Jullien I., Gavend G., Le cuir : origine et fabrication, Ouvrage CTC, 1998. [c] Stryer L., La biochimie, Édition Médecine-Sciences, Flammarion, 1992. Figure A - Coupe schématique d’une peau de bovin (source CTC). buffle chèvre autruche crocodile lézard mouton python vachette Figure B - Différents grains de peaux (©CTC). Figure C - Les différents niveaux structuraux d’une fibre de collagène [c]. 5 l’actualité chimique - janvier 2006 - n° 293 Comment ça marche ? Schultz permet l’essor d’une industrie jugée stratégique dans toute la première moitié du XXe siècle. Les tanneries, indispensables à l’équipement des armées, sont des sites protégés. Ainsi, à la fin des années 1930, on déménage en hâte la plus grosse tannerie française, qui employait alors plusieurs milliers de personnes, de Strasbourg vers la Breta- gne pour l’éloigner de la portée des canons allemands. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les militaires se tournent davantage vers le nucléaire et l’électronique de pointe ; l’industrie du cuir profite de l’apparition des polymères syn- thétiques pour développer les techniques de finissage. Elle peut alors suivre la mode et fournir des cuirs d’aspects de plus en plus variés : naturel, ciré ou moderne avec des reflets irisés, métallisés ou nacrés. La variété des aspects vient aussi du tannage des peaux de nouvelles espèces. Si les mammifères élevés pour le lait ou la boucherie sont les espè- ces dont la peau est majoritairement tannée, se développe aussi le tannage de reptiles, oiseaux et poissons (tableau I). L’industrie du cuir est liée à celle de la viande. La matière première est limitée. Néanmoins, la surface de cuir produite chaque année est en crois- sance constante au niveau mondial. En effet, l’améliora- tion de la collecte des peaux partout dans le monde per- met d’augmenter le gisement de peaux brutes disponibles. Le traitement de la peau pour conduire au cuir La grande majorité des peaux utilisées dans l’indus- trie du cuir provient d’abat- toirs où elles sont salées rapi- dement après la dépouille pour assurer leur conserva- tion temporaire jusqu’au tan- nage. La peau est un organe complexe, d’épaisseur et de texture variables. Contenant une grande proportion d’eau, elle est extrêmement sensible à la putréfaction. Le travail du tanneur consiste à gommer les différences de structure pour fournir un matériau homogène et stabilisé. La première partie des traitements imposés à la peau a pour but d’isoler la structure collagénique fibreuse en éliminant les autres cons- tituants. Les fibres sont ensuite tannées pour être transfor- mées en cuir qui recevra différentes opérations dépendant de l’utilisation finale du matériau. Le tableau II donne un procédé standard de fabrication à partir de peaux brutes de bovins salées. La trempe élimine le sel de conservation et les composés hydrosolubles du milieu interfibrillaire. Le pelain effectué en milieu basique et réducteur dissout les kératines des poils et de l’épiderme. Le milieu basique provoque un gonflement important de la peau. Il dégrade très fortement le milieu inter- fibrillaire et attaque partiellement le collagène lui-même. Par cette opération, on peut influer sur la souplesse du cuir en faisant varier les paramètres de durée, de pH et de tempéra- ture. Si la durée classique du pelain est de 10 à 20 heures, une fabrication de cuir pour ganterie peut comporter un pelain de plusieurs jours. L’écharnage élimine mécaniquement uploads/Industriel/ 2006-293-janv-degache-p-3.pdf
Documents similaires







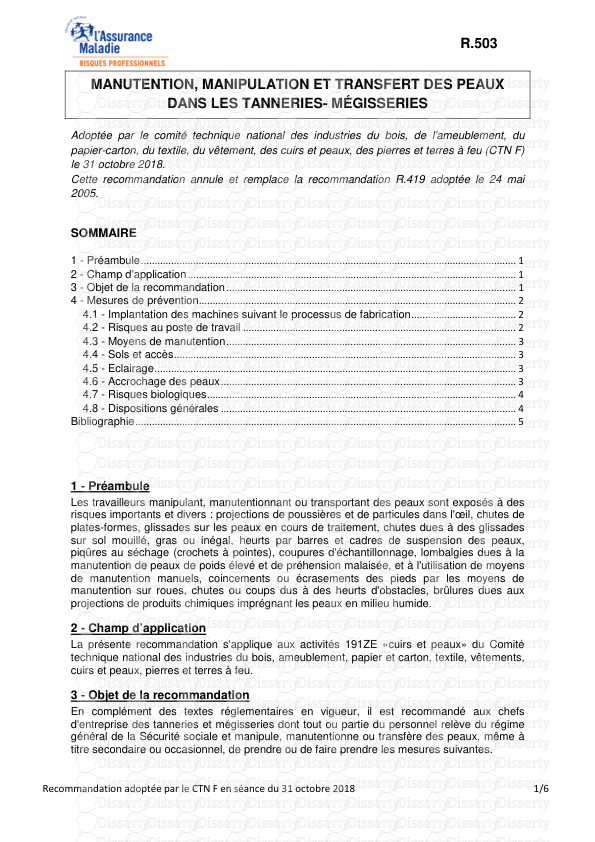
-
69
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 26, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.8023MB


