OUTRE-TERRE REVUE EUROPÉENNE DE GÉOPOLITIQUE OUTRE-TERRE REVUE EUROPÉENNE DE GÉ
OUTRE-TERRE REVUE EUROPÉENNE DE GÉOPOLITIQUE OUTRE-TERRE REVUE EUROPÉENNE DE GÉOPOLITIQUE Académie Européenne de Géopolitique Éditions L ’Esprit du Temps L ’ESPRIT DU TEMPS L’avenir économique du monde I 46 La reconfiguration industrielle globale et la crise mondiale Jean-Christophe Defraigne1 INTRODUCTION Le dernier quart de siècle a profondément modifié la configuration géographique des activités industrielles. Jusqu’aux années 1980, la plupart des pays de la semi- périphérie, qu’on qualifie aujourd’hui d’économies émergentes, n’avaient développé qu’une industrie légère intensive en travail et restaient des exportateurs de matières premières et produits agricoles. Les produits industriels intensifs en capital et en technologie étaient en grande partie manufacturés dans les économies de la triade (États-Unis, Europe occidentale, Japon) ou par des filiales de firmes multinationales issues de la triade produisant dans certaines grandes économies en développement (comme le Mexique, le Brésil, la Turquie). Une partie importante de l’économie mondiale qui poursuivait une industrialisation étatisée selon un modèle économique dit socialiste restait très peu ouverte au commerce international et totalement fermée aux investissements directs étrangers (IDE). Les économies de la triade étaient les seules capables de faire des produits manufacturés intensifs en capital et compétitifs sur les marchés mondiaux. Ils disposaient d’une avance technologique de plusieurs décennies que l’on peut mesurer par les dépenses de recherche et développement, les brevets commerciaux, les articles scientifiques et le nombre de chercheurs. Seul l’URSS a pu rivaliser jusqu’aux années 1980 dans certains domaines militaires. En trois décennies, on assiste à une reconfiguration des capacités industrielles mondiales avec une montée de l’Asie-Pacifique et de zones semi-périphériques proches des États-Unis (Nord du Mexique), de l’Europe (Turquie, Maroc ou Tuni sie) ainsi que de grandes économies émergentes plus éloignées des centres de l’éco nomie mondiale (Inde et Brésil). Le phénomène à la base de cette reconfiguration se caractérise par l’internationalisation du processus de production et la création de chaînes de valeur mondialisées par les grandes firmes multinationales des pays de la triade qui recourent à la mise en place de plateformes d’assemblage et à la sous-trai tance dans certaines pays en voie de développement. 1 Professeur à l’Institut d’Etudes Européennes de l’Université Saint-Louis Bruxelles et à la Louvain School of Management L ’auteur remercie Alice de Viron, Charles Nimmegeers et Sophie van Dessel pour leur contribution à la collecte des données statistiques de cet article. 144 Jean-Christophe Defraigne Tableau n° 1 : PIB Mondial 1870-1913-1950-1975-2000-2008-2015 Source : Maddison Project 2010 et FMI 2016 Le phénomène s’est toutefois fortement complexifié avec la multiplication de firmes multinationales issues d’économies émergentes, avec la mutation des avan tages comparatifs des différentes économies nationales, donnant lieu à de nouveaux déplacements de sites d’assemblage d’économies émergentes vers des économies moins développées et parfois à des phénomènes de rapatriement de capacités de production vers les États-Unis ou l’Europe. LA LOCALISATION DE L ’INDUSTRIE XXe : UN MONOPOLE OCCIDENTAL Le Royaume-Uni, précurseur de la révolution industrielle réussit à maintenir une position dominante pendant les premières décennies du XXe siècle mais se trouve ensuite en concurrence avec certaines économies continentales et avec les États- Unis. Au cours de ces décennies d’hégémonie britannique en matière de production et de commerce de produits manufacturés, les théories économiques ricardiennes de la rente et des avantages comparatifs2 prônent une économie mondiale carac térisée par le libre-échange au sein de laquelle la Grande-Bretagne se spécialiserait 2 Cf. David Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, Londres, John Murray, 1821. 145 La reconfiguration industrielle globale et la crise mondiale dans la manufacture pendant que ses partenaires seraient cantonnés à la fourniture de matières premières et de produits agricoles. Cependant, cette vision ricardienne est contestée car le développement industriel se voit jugé par plusieurs dirigeants d’autres États comme un moyen incontournable pour garantir une indépendance nationale sur les plans militaire et technologique3. Des États beaucoup moins avan cés comme la Prusse impériale, le Japon de l’ère Meiji et la Russie tsariste déve loppent des politiques industrielles dans une optique de modernisation des arsenaux militaires. Des économistes comme l’américain Hamilton4 ou l’allemand Friedrich List5 considèrent que l’industrialisation est une condition nécessaire pour accélérer le développement économique et technologique national et pour préserver la souve raineté nationale. Ils mettent en avant la nécessité de protéger l’industrie nationale dans l’enfance pour permettre de bénéficier des économies d’apprentissage, un argu mentaire formalisé plus tard par Paul Krugman pour justifier dans certains cas les politiques industrielles et commerciales protectionnistes dites stratégiques6. Au XXe siècle, les premières industries continentales et américaines se déve loppent lentement au départ, notamment en essayant de copier la technologie industrielle britannique à travers diverses méthodes (débauche de main-d’œuvre qualifiée britannique, espionnage industriel, achat de matériel et de brevets). On a également recours à des partenariats avec des capitaux britanniques pour dévelop per de nouveaux projets industriels nationaux. Le développement de la construc tion ferroviaire aux États-Unis et en Allemagne stimule l’industrie métallurgique et permet l’intégration d’un grand espace économique. Ce processus d’intégration économique s’accompagne d’une centralisation politique (guerre de sécession de 1861-1865 qui renforce le pouvoir fédéral américain, Zollverein qui accélère le processus de rapprochement entre les petits États de l’Ouest de l’Allemagne et la Prusse qui débouche sur l’unification en 1871)7. La création de grands marchés nationaux, régulés par une autorité centralisée qui réduit les coûts de transaction et harmonise des normes techniques et alimentés par une forte croissance démogra phique sont autant de facteurs au fondement de l’accélération des industrialisations allemande et américaine. Ces conditions combinées au développement de l’éduca tion technique permettent le rattrapage industriel rapide de la Grande-Bretagne, notamment dans les nouvelles technologies de la deuxième révolution industrielle (chimie, électricité, automobile). 3 Cf. Paul Bairoch, Victoire et déboires, Paris, Gallimard, 1997 . 4 Alexandrer Hamilton, Report on the subject of manufactures, Philadelphie, Brown, 1832. 5 Friedrich List, Le Système National d’Économie Politique, éd. française 1857 , rééd. 1998. 6 Cf. Paul Krugman, Strategy Trade Policy and the New International Economics, Cambridge Mass., MIT Press, 1993. 7 Cf. Mary Fullbrook, A Concise History of Germany, Cambridge University Press, 2014 ; Jean-Christophe Defraigne, De l’intégration nationale à l’intégration continentale : Analyse de la dynamique d’intégration européenne des origines à nos jours, Paris, L ’Harmattan, 2004. 146 La plupart des grands États européens et les États-Unis adoptent un tarif pro tectionniste pour protéger leur industrie dans l’enfance (les États-Unis en 1861 et 1890, l’Allemagne en 1879, la France, la Russie et l’Italie dans les années 1890) et permettre aux firmes nationales de bénéficier des économies d’échelle importantes générées par les innovations technologiques et commerciales de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les appareils d’État européens et américains poursuivent des po litiques industrielles par le biais des contrats publics dans le domaine des infras tructures et des commandes militaires. Le contexte de la « grande dépression » de 1873-1895 est caractérisé par des surcapacités de production, par une montée du protectionnisme et par des bouleversements technologiques et commerciaux (évo lution du droit des sociétés et du secteur bancaire) donnant lieu à des économies d’échelle qui accroissent avec une rapidité sans précédent la taille des firmes. La « grande dépression » et le protectionnisme ont entraîné la quête de nouveaux dé bouchés par les gouvernements des pays industrialisés. Ainsi Jules Ferry, président du Conseil de la République Française, écrit en 1890 que « l’Europe peut être consi dérée comme une maison de commerce qui voit depuis un certain nombre d’années décroître son chiffre d’affaires. La consommation européenne est saturée ; il faut faire surgir des autres parties du globe de nouvelles couches de consommateurs sous peine de mettre la société européenne en faillite et de préparer pour l’aurore du XXe siècle une liquidation sociale par voie de cataclysme dont on ne saurait calculer les conséquences »8. En 1899, Le Kaiser Guillaume II proclame que « le futur de l´Allemagne est sur les mers » et adopte la Weltpolitik9. Cela se traduit par un regain de la colonisation et des politiques commerciales plus agressives. La période de 1873 à 1914 voit une expansion sans précédent des empires coloniaux britannique et fran çais. L’Allemagne, la Belgique et l’Italie, nations européennes occidentales établies sur le tard se lancent dans la conquête coloniale. Même les États-Unis, le Japon et la Russie tsariste développent leurs propres colonies, principalement vers l’Asie, pour obtenir un accès à des débouchés et assurer un approvisionnement dans les matières premières nécessaires à la deuxième révolution industrielle. L’expansion commerciale des puissances industrielles américaine et européennes s’effectue également dans des pays non formellement colonisés mais ne disposant pas de base industrielle natio nale significative (Amérique latine) ou des États désireux et le cas échéant capables (dans le cas de protectorats, de mandats ou de colonisation de facto comme la Chine, l’Égypte, le Maroc ou Cuba) de soutenir des industries nationales dans l’enfance. La colonisation et l’expansion commerciale industrielle de l’Europe et des États- Unis entre 1890 et 1914 rendent beaucoup plus difficile ou impossible la poursuite de politiques industrielles nationales de rattrapage par les régions présentant un 8 Jules Ferry, Le Tonkin et la mère-patrie, Paris, Havard, 1890. 9 Cf. Pierre Guillen, L uploads/Industriel/ defraigne-jean-christophe-la-reconfiguration-industrielle-globale-et-la-crise-mondiale-2016.pdf
Documents similaires


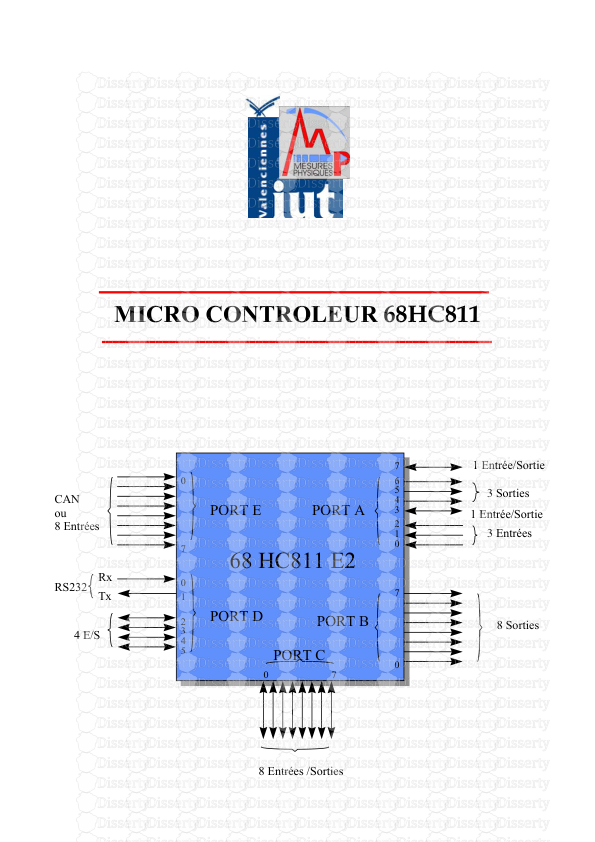







-
42
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 14, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 5.2463MB


