TP AUTOMATISME Automate Programmable Industriel(API TSX 27) Encadré par: M. KHA
TP AUTOMATISME Automate Programmable Industriel(API TSX 27) Encadré par: M. KHATORY Réalisé par: Saoussane MAATI / Youssef LIMY Avant propos : Les automatismes nécessitent un grand nombre d'entrées sorties le système de relayage devenant trop complexe, on le remplace par un système de logique programmée appelée automate programmable. I : Automatisation L'automatisation de la production consiste à transférer tout ou partie des tâches de coordination, auparavant exécutées par des opérateurs humains, dans un ensemble d'objets techniques appelé PARTIE COMMANDE. La Partie Commande mémorise le SAVOIR FAIRE des opérateurs pour obtenir la suite des actions à effectuer sur les matières d’œuvre afin d'élaborer la valeur ajoutée. Elle exploite un ensemble d'informations prélevées sur la Partie Opérative pour élaborer la succession des ordres nécessaires pour obtenir les actions souhaitées. I-1 : Structure d'un système automatisé Tout système automatisé COMPORTE : Une PARTIE OPERATlVE (P.O.) : procédant au traitement des matières d’œuvre afin d'élaborer la valeur ajoutée, Une PARTIE COMMANDE (P.C.) : coordonnant la succession des actions sur la Partie Opérative avec la finalité d'obtenir cette valeur ajoutée. Remarque Pour la partie commande d’un automatisme le concepteur à le choix entre deux familles de solutions : la logique câblée et la logique programmé. A : La logique câblée : Exemple: X = (a.b)+c L’automatisme est obtenu en reliant entre eux les différents constituants de base ou fonctions logiques par câblage. La logique câblée correspond à un traitement parallèle de l’information. Plusieurs constituants peuvent être sollicités simultanément. B : La logique programmée. Elle correspond à une démarche séquentielle, seule une opération élémentaire est exécuté à la fois, c’est un traitement série. Le schéma électrique est transcrit en une suite d'instruction qui constitue le programme. En cas de modification des équations avec les mêmes accessoires, l'installation ne comporte aucune modification de câblage seul le jeu d'instructions est modifié. II : automate programmable industriel 1 : Définition Appareil électronique qui comporte une mémoire programmable par un utilisateur automaticien (et non informaticien) à l'aide d'un langage adapté, pour le stockage interne des instructions composant les fonctions d'automatisme comme par exemple : Logique séquentielle et combinatoire Temporisation, comptage, décomptage et comparaison Calcul arithmétique Réglage, asservissement, régulation, etc, pour commander, mesurer et contrôler au moyen d'entrées et de sorties (logiques, numériques ou analogiques) différentes sortes de machines ou de processus, en environnement industriel. 2 : Architecture d'un API La structure interne d’un API peut se représenter comme suit : L'automate programmable reçoit les informations relatives à l'état du système et puis commande les pré-actionneurs suivant le programme inscrit dans sa mémoire. Un API se compose donc de trois grandes parties : Le processeur ; La zone mémoire ; Les interfaces Entrées/Sorties. Le microprocesseur : Le microprocesseur réalise toutes les fonctions logiques ET, OU, les fonctions de temporisation, de comptage, de calcul... à partir d'un programme contenu dans sa mémoire. Il est connecté aux autres éléments (mémoire et interface E/S) par des liaisons parallèles appelées ' BUS 'qui véhiculent les informations sous forme binaire. La zone mémoires : a)- La Zone mémoire va permettre : De recevoir les informations issues des capteurs d’entrées. De recevoir les informations générées par le processeur et destinées à la commande des sorties (valeur des compteurs, des temporisations, …). De recevoir et conserver le programme du processus. b)-Action possible sur une mémoire : ECRIRE pour modifier le contenu d’un programme EFFACER pour faire disparaître les informations qui ne sont plus nécessaires LIRE pour en lire le contenu d’un programme sans le modifier c)- Technologie des mémoires : RAM (Random Acces Memory): mémoire vive dans laquelle on peut lire, écrire et effacer (contient le programme) ROM (Read Only Memory): mémoire morte accessible uniquement en lecture. EPROM : mémoires mortes reprogrammables effacement aux rayons ultra-violets. EEPROM : mémoires mortes reprogrammables effacement électrique Remarque : La capacité mémoire se donne en mots de 8 BITS (Binary Digits) ou octets. Les interfaces d'entrées/sorties : Les entrées reçoivent des informations en provenance des éléments de détection (capteurs) et du pupitre opérateur (BP). Les sorties transmettent des informations aux pré-actionneurs (relais, électrovannes …) et aux éléments de signalisation (voyants) du pupitre. a)- Interfaces d’entrées : Elles sont destinées à : Recevoir l’information en provenance des capteurs. Traiter le signal en le mettant en forme, en éliminant les parasites et en isolant électriquement l’unité de commande de la partie opérative. Donc pour commander une sortie automate l’unité de commande doit envoyer : Un 1 logique pour actionner une sortie API Un 0 logique pour stopper la commande d’une sortie API 3 : Fonctionnement api L'automate programmable reçoit les informations relatives au système, il traite ces informations en fonction du jeu d'instruction et modifie l'état de ses sorties qui commandent les pré-actionneurs. Recevoir : nécessité d'informations d'entrées. Traiter : notion de programme et de microprocesseur. Jeu d'instructions : notion de stockage donc de mémoire. Commander : notion de sortie afin de donner des ordres. 4 : Alimentation de l'apis L'alimentation intégrée dans l'API, fournit à partir des tensions usuelles des réseaux ( 230 V, 24 V= ) les tensions continues nécessaires au fonctionnement des circuits électroniques. 5 : Raccordement automate Présentation 6 : Les fonctions de base d'un automate Un automate programmable permet de remplacer une réalisation câblée comportant des composants combinatoires (portes) et séquentiels (bascules, séquenceurs,...) par un programme. Un programme est une suite d'instructions, qui sont exécutées l'une après l'autre. Si une entrée change alors qu'on ne se trouve pas sur l'instruction qui la traite et que l'on ne repasse plus sur ces instructions, la sortie n'est pas modifiée. C'est la raison de la nécessité de bouclage permanent sur l'ensemble du programme. Par rapport à un câblage, on a donc deux désavantages : temps de réponse (un changement des entrées sera pris en compte au maximum après le temps d'un passage sur l'ensemble du programme, c'est ce qu'on appelle le temps de scrutation, qui sera souvent de l'ordre de la milliseconde) et non simultanéité (on n'effectue qu'un instruction à la fois). Mais ces temps étant en général très inférieurs aux temps de réaction des capteurs et actionneurs (inertie d'un moteur par exemple), ceci n'est que rarement gênant. L'avantage est que c'est programmable, donc facilement modifiable. Tout automate programmable possède : Des entrées, des sorties, des mémoires internes : toutes sont binaires (0 ou 1), on peut les lire (c.a.d connaître leur état) (même les sorties), mais on ne peut écrire (modifier l'état) que sur les sorties et les mémoires internes. Les mémoires internes servent pour stocker des résultats temporaires, et s'en resservir plus tard. Des fonctions combinatoires : ET, OU, NON (mais aussi quelquefois XOR, NAND,...). Des fonctions séquentielles : bascules RS (ou du moins Set et Reset des bascules), temporisations, compteurs/décompteurs mais aussi quelquefois registres à décalage, etc... Des fonctions algorithmiques : sauts (vers l'avant mais aussi quelquefois saut généralisés), boucles, instructions conditionnelles... De plus il permet de créer, essayer, modifier, sauver un programme, quelquefois par l'intermédiaire d'une console séparable et utilisable pour plusieurs automates. Désormais cette fonctionnalité est également possible sur PC, permettant une plus grande souplesse, une assistance automatique, des simulations graphiques,... mais pour un prix supérieur. Ce qui différencie les automates, c'est la capacité (entrées, sorties, mémoires internes, taille de programme, nombre de compteurs, nombre de temporisations), la vitesse mais surtout son adaptabilité (possibilité d'augmenter les capacités, de prendre en compte de l'analogique et numérique, de converser via un réseau...). 7 : Description des menus (utiles) sur la console T407 A - Menu principal [TSX 17-20] ADJ (adjust) : permet de visualiser ou modifier toute variable. DBG (debug) : mise au point : permet de visualiser le programme et voir l'état des capteurs, sorties, étapes actives... (Trait plein dans le programme si actif, interrompu si 0) et mettre des points d'arrêt dans le programme. PRG : créer ou modifier le programme. TRF (transfert) : pour mémorisation sur EEPROM et impression sur imprimante (RS232). B - Menu PRG (dans tous les cas) CLM (clear memory) : efface le programme actuel, permet de définir si le nouveau programme sera en langage à contacts (LAD) ou Grafcet (SEQ). CNF (config) : configuration de l'automate, de la liaison RS232 pour l'imprimante (LINE), des bobines à sauvegarder même en cas de coupure de courant (SAV)... NAME : permet de donner un nom au programme. LK : vérifie si le programme en mémoire ne comporte pas d'erreur. . FREE : retasse le programme (à faire après de nombreuses modifications). C - Menu PRG en mode ladder (LAD) TOP : aller au premier réseau. BOT : (bottom) aller après le dernier réseau (on passe ensuite au dernier par la flèche vers le haut). LAB : donner un numéro de réseau (label) puis [ENT] pour le visualiser. INS : insère un nouveau réseau (vide) devant le réseau actuel. DEL uploads/Industriel/ tp-automatisme-m-khatory-saoussane-maati-youssef-limy.pdf
Documents similaires








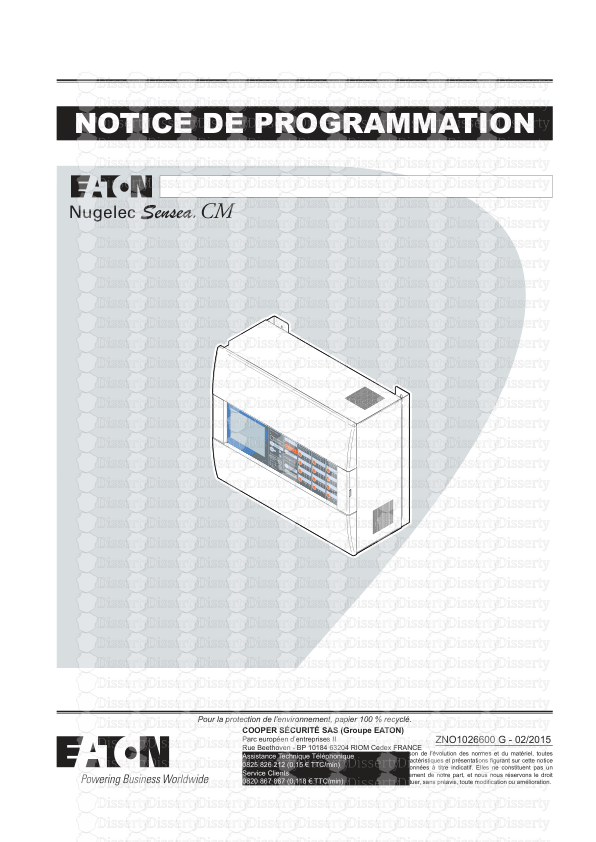

-
33
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 22, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 1.6518MB


