Le Monde morcele Cornelius Castoriadis LeMonde morcele / Les carref ours du lab
Le Monde morcele Cornelius Castoriadis LeMonde morcele / Les carref ours du labyrinthe 3 Editions du Seuil TEXTEINTEGRAL ISBN 2-02-047574-X (ISBN 2-02-012350-9, ire edition) © Editions du Seuil, octobre 1990 Le Code de la propriete intellectuelle interdit les copies ou reprcxtuctions destinees a une utilisation collective. Toute representation ou reproduction integrale ou partielle faite par quelque procede que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contref~on sanctionllee par Jes articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriete intellectuelle. www.seuil.com Avertissement Le monde - pas seulement le n6tre - est mor- cele. Pourtant il ne tombe pas en morceaux. Refle- chir cela me semble une des premieres taches de la philosophie aujourd'hui. C'est ce qu'essaient de faire les textes ras- sembles ici, composes entre 1986 et 1989 et qui s'inserent dans la preparation des ouvrages La Creation humaine et L' Element imaginaire auxquels je travaille. Le lecteur pourra les situer plus facilement en se reportant aux prefaces des Carre/ours du labyrinthe (1978) et des Domaines de l' homme (1986). Paris, decembre 1989 PREMIERE PARTIE KO/NON/A L'epoque du conformisme generalise* I Dans ses remarques introductives a ce symposium, Clau- dio Veliz notait que « l' esprit de notre temps... est trop rapide ou trop lethargique; il change trop ou pas assez; il produit de la confusion et de l'equivoque ». Ces traits ne sont pas accidentels. Pas plus que ne le sont le lancement et le succes des labels « postindustriel » et « postrno- deme ». Les deux foumissent une parfaite caracterisation de l'incapacite pathetique de l'epoque de se penser comme quelque chose de positif, ou meme comme quelque chose tout court. Ainsi, est-elle amenee a se definir comme, tout simplement, « post-quelque-chose », par reference a ce qui a ete mais n'est plus, et a s'autoglorifier par !'affirmation bizarre que son sens est le pas de sens, et son style le manque de tout style. « Enfin, proclamait un architecte bien connu lors d'une conference a New York en avril 1986, le postrnodemisme nous a delivres de la tyran- nie du style.» Cependant, une certaine distinction entre les termes « postindustriel » et « postmodeme » doit etre faite. Car il y a quelque chose dans la realite qui correspond au terme « postindustriel ». En bref, au moins dans les pays riches * Conference faite en anglais lors du symposium A Metaphor for our Times, a la Boston University, le 19 septembre 1989; traduite par moi. 12 Koinonia (mais non seulement dans ceux-ci), la production (quel que soit le sens de ce terme) quitte les hauts foumeaux et les vieilles fabriques sales et se toume vers des complexes de plus en plus automatises et les divers « services ». Ce processus, prevu depuis au moins un demi-siecle, avait ete longtemps considere porteur de promesses extraordinaires pour l'avenir du travail et de la vie humains. On disait que la duree du travail allait etre reduite de fa9on spectaculaire, et sa nature fondamentalement transformee. L'automation et le traitement electronique des donnees allaient transfor- mer le vieux labeur industriel, repetitif et alienant, en un champ ouvert a la libre expression de l'inventivite et de la creativite du travailleur. En fait, rien de tout cela ne s 'est realise. Les possibilites offertes par les nouvelles technologies restent confinees a un groupe etroit de jeunes specialistes « intelligents ». La nature du travail n'a pas change pour la masse des autres salaries, qu'il s'agisse de l'industrie ou des services. Plutot le contraire: l' «industrialisation» a l'ancienne a envahi les grandes entreprises des secteurs non industriels, ou le rythme de travail et les taux de rendement restent soumis a un controle mecanique et impersonnel. L'emploi dans l'in- dustrie proprement dite est en declin depuis des decennies ; les ouvriers « redondants » (admirable expression des eco- nomistes anglo-saxons) et les jeunes n'ont pu- trouver de l' emploi que dans des industries de « services » de seconde classe, a basses remunerations. De 1840 a 1940, la lon- gueur de la semaine de travail avait ete reduite de 72 a 40 heures (- 45 %). Depuis 1940, cette duree reste prati- quement constante, malgre une acceleration considerable de l 'accroissement du produit par heure/ouvrier. Les ouvriers qui tombent ainsi dans la « redondance » restent chomeurs (essentiellement en Europe occidentale) ou doi- vent se easer tant bien que mal dans des « services » mal payes (surtout aux Etats-Unis). Il reste toutefois vrai que, du moins potentiellement, L' epoque du conformisme generalise 13 quelque chose d'essentiel est en train de changer dans la relation de l'humanite - l'humanite riche - avec la produc- tion materielle. Pour la premiere fois depuis des mille- naires, la production « primaire » et « secondaire » - agri- culture, mines et manufactures, transports - absorbe moins d'un quart de l'input total de travail (et de la population employee), et pourrait meme n'utiliser que la moitie de ce quart s'il n'y avait pas l'incroyable gaspillage incorpore dans le systeme (paysans subventionnes afin qu'ils ne pro- duisent pas, industries et usines obsoletes maintenues en , .. activite, etc.). Elle pourrait meme absorber un quantum i. negligeable du temps humain, sans la fabrication continue, de nouveaux « besoins » et l' obsolescence incorporee par construction dans la plupart des produits fabriques aujour- d 'hui. Bref, une societe de temps libre est, theoriquement, a portee de la main - al ors qu 'une societe rendant possible pour chacun un travail personnel et creatif semble aussi eloignee que pendant le XIX" siecle. II Toute designation est conventionnelle; l'absurdite du terme « postmodeme » n'en est pas moins evidente. Ce que l'on remarque moins souvent est qu'elle est derivee. Car le terme « modeme » lui-meme est malheureux, et son inadequation ne pouvait pas manquer d'apparaitre avec le temps. Que pourrait-il jamais y avoir apres la modemite? Une periode qui s'appelle modeme ne peut que penser que l'Histoire a atteint sa fin, et que les humains vivront desor- mais dans un present perpetuel. Le terme « modeme » exprime une attitude profonde- ment auto- (ou ego-) centrique. La proclamation « nous sommes les modemes » tend a annuler tout developpement ulterieur veritable. Plus que cela, elle contient une curieuse antinomie. La composante imaginaire, et consciente de soi, 14 Koinonia du terme implique l'autocaracterisation de la modemite comme ouverture indefinie concemant l'avenii, et cepen- dant cette caracterisation n'a de sens que relativement au passe. Ils etaient les anciens, nous sommes les modemes. Comment faudra-t-il, done, appeler ceux qui viennent apres nous? Le terme ne fait sens que sur l'hypothese absurde que la periode s'autoproclamant modeme durera toujours et que l'avenir ne sera qu'un present prolonge - , ce qui par ailleurs contredit pleinement les pretentions explicites de la modemite. Une breve discussion de deux tentatives contemporaines visant a donner un contenu precis au terme modemite peut foumir un point de depart utile. Il est caracteristique qu'elles se preoccupent toutes les deux non pas des change- ments dans la realite social-historique, mais des change- ments (reels ou supposes) dans l'attitude des penseurs (phi- losophes) a l'egard de la realite. Elles sont ainsi typiques de la tendance contemporaine des auteurs a l'auto-enferme- ment: les ecrivains ecrivent sur des ecrivains a l'usage d'autres ecrivains. Ainsi Foucault 1 affirme que la moder~ nite commence avec Kant (specialement avec Le Conflit des facultes et Que sont les Lumieres ?), parce que avec Kant, pour la premiere fois, le philosophe s 'interesse au p,tesent historique effectif, commence a « lire les jour- ' a.aux», etc. (Cf. la phrase de Hegel sur la lecture du jour- nal comme la « priere realiste du matin ».) La modemite serait ainsi la conscience de l 'historicite de l' epoque ou l'on vit. C'est la de toute evidence une conception totale- ment inadequate. L'historicite de leur epoque etait claire pour Pericles (il n'y a qu'a lire l'Epitaphe dans Thucydide) et pour Platon, comme elle l'etait pour Tacite ou pour Gre- goire de Tours (mundus senescit). Aux yeux de Foucault, la nouveaute consisterait en ce que, a partir de Kant, la relation au present n'est plus corn;ue en termes de compa- 1. « Un cours inedit », Magazine litteraire, mai 1988, p. 36. L' epoque du conformisme generalise 15 raison de valeur (« sommes-nous dans la deca,dence? », « quel mode le devrions-nous suivre? » ), non pas « longitu- dinalement », mais dans une « relation sagittale » a l'actua- lite propre. Mais les comparaisons de valeur sont lourde- ment presentes chez Kant pour qui l 'histoire ne peut etre reflechie qu'en termes d'un progres, dont les Lumieres constituent un moment cardinal. (Cela est encore plus clair, evidemment, pour Hegel.) Et si la « relation sagit- tale » est opposee a l' evaluation, cela ne peut signifier que ceci : la pensee, abandonnant sa fonction critique, tend a emprunter ses criteres aupres de la realite historique, telle qu'elle est. Il est certain qu'une telle tendance uploads/Industriel/cornelius-castoriadis-carrefours-3-highlighted-errata-citations.pdf
Documents similaires






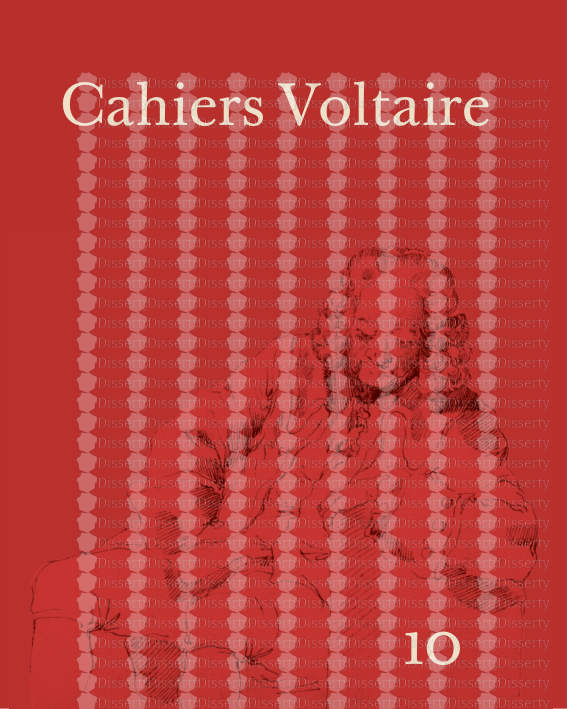



-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 17, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 10.7561MB


