1/73 I) Historique a) La science des polymères Le mot polymère vient du grec «
1/73 I) Historique a) La science des polymères Le mot polymère vient du grec « polus » plusieurs, et « meros » partie. Un polymère est une macromolécule, organique ou inorganique, constituée de l'enchaînement répété d'un même motif, le monomère (du grec monos: un seul ou une seule, et meros ; partie), reliés les uns aux autres par des liaisons covalentes. Les travaux de Staudinger dans les années 1920 constituent la base de la science des polymères (Nobel en 1953) ou macromolécules. Flory énoncera plus tard les principes fondamentaux sur les polymères (Nobel 1974). b) L’industrie des matières plastiques « Les matières plastiques » : Les matières plastiques sont des matériaux organiques de synthèse fondés sur l'emploi des macromolécules (polymères). Les caoutchoucs sont aussi regroupés sous cette appellation. Matière plastique = résine de base + adjuvants + additifs Cas du caoutchouc : vers 1839 l’Anglais Thomas Hancock et l’Américain Charles Goodyear découvrent le procédé de vulcanisation du caoutchouc en chauffant du caoutchouc naturel en présence de souffre. Le procédé industriel sera développé à partir de 1850. En dehors du caoutchouc, les premières matières plastiques sont apparues à la fin du XIXème siècle et existaient plutôt à l’échelle artisanale qu’industrielle. Parmi ces matériaux, on peut citer ceux d’origine naturelle comme le Celluloïd® (toute première matière plastique, 1870) ou le nitrate de cellulose (coton-poudre ou fulmicoton, produit inflamable utilisé dans les canons). la Galalith®, littéralement « pierre de lait », obtenue à partir de la caséine du lait, et utilisée en remplacement de la corne et de l’écaille dans la fabrication de peignes, de boutons... On trouve des brevets de fabrication de colle à base de caséine dès 1873 et déjà utilisée dans l’ancienne égypte. De façon générale, les protéines peuvent être considérés comme des polymères naturels, car constituées d’enchaînement d’acides aminés. Feretti invente le Lannital® ou fibre de lait (Brevet Feretti, 1935). Les polymères Poupée en Celluloïd Objets en galalith 2/73 Le véritable essort de la chimie des matières plastique se fait à partie de 1920 par l’exploitation des résines formo-phénoliques (1909 , Baekeland = Belge). C’est la naissance de la Bakélite®. Il s’agit du premier polymère thermodurcissable entièrement synthétique et ouvre la voie aux résines à base de phénol. De 1920 à 1940 se développent les résines « phénol/formol » ; l’acétate de cellulose remplace le celluloïd trop inflammable dans des applications type films photo ou cinématographique. Les premières matières thermoplastiques sont produites en grande quantité. Petite histoire du nylon : Wallace Hume Carothers (27 avril 1896 - 29 avril 1937) était un chimiste américain à la compagnie DuPont. En 1935, il synthétise le nylon. Le nylon a été breveté (en fait trois brevets U.S. Patents 2130523, 2130947 et 2130948 du 20 sept. 1938), mais le terme nylon n'est pas une marque déposée, il n'a donc pas à s'écrire avec une capitale initiale. DuPont a ainsi choisi de permettre au mot de devenir synonyme de bas (nylon) ; en 1992 la société dépose sa marque déposée pour le nylon sous le terme tactel. La découverte fut pour la première fois commercialisée en 1938 avec un premier produit, une brosse à dent dont les poils étaient en nylon sorti la même année. En 1940 sortait un produit qui allait marquer l'histoire du nylon, les bas pour femme. En 1941, pour l'entrée en guerre des USA , le matériau utilisé pour les toiles dparachutes fut affublé de la phrase Now You Lousy Old Nippons (« À vous maintenant, vieux Japonais dégueulasses ! ») ou encore Now You've Lost Old Nippons (« Vous avez maintenant perdu vieux Japonais ! »). Il circule de nombreuses étymologies sur l'origine du mot nylon comme celles affirmant que le nylon provient de NY (New York) et LON (London), ou encore du prénom des épouses des inventeurs. Son inventeur, Wallace Carothers, s'étant suicidé avant de donner un nom commercial à son polyamide 66 (suite à une dépression consécutive au décès de sa soeur) , il revint à un comité de trois membres de chez DuPont de faire le choix en 1938. Un des membres Dr. E.K.Gladding proposa "Norun" (pour no run soit ne s'effile pas), et changea aussitôt en "Nuron" pour éviter une publicité mensongère, tout en rimant ainsi avec Rayon ou coton, qui fut finalement déformé en nylon pour avoir un acronyme prononcé de la même façon pour les américains et les anglais. Cette version officielle de DuPont, voir aussi leur publication (Context, vol. 7, no. 2, 1978), fut aussitôt pervertie par quelques plaisantins en Now You Lose Old Nippon ou Now You Lousy Old Nippon, avec un succès tel que DuPont a commissionné en 1941 un journal japonais pour y démentir cette étymologie raciste. Baekeland 3/73 II) Organisation d’une macromolécule a) Définition d’un polymère : Un polymère est une macromolécule, organique ou inorganique, constituée de l'enchaînement répété d'un même motif, le monomère (du grec monos: un seul ou une seule, et meros : partie), reliés les uns aux autres par des liaisons covalentes. Dans la macromolécule suivante .....A-A-A-A-A-A-A..... = [-A-]n l’unité constitutive est A ; elle est formée d’un groupe d’atomes qui se répète. A l’échelle moléculaire, quelques centaines de nm, la plupart des macromolécules se présentent sous forme de « fils long et souples ». Les réaction chimiques permettant de passer d’un monomère A à la macromolécule [-A-]n s’appellent polymérisation. Ainsi, l’éthylène CH2=CH2 (monomère) conduit par polymérisation par ouverture de la double liaison au polyéthylène (polymère) [-CH2-CH2-]n. La macromolécule peut comporter jusqu’à 50 000 atomes de carbone, et pour de nombreux polymères commerciaux la masse molaire peut atteindre 1 000 000 g.mol-1. Certaines macromolécules deviennent ainsi visibles à l’oeil nu (matériaux réticulés par exemple). La synthèse d’un polymère peut être assimilé à un jeu de construction dans lequel on dispose de pièces élémentaires mono, difonctionnelles ou de fonctionnalité strictement supérieure à 2. On appelle fonctionnalité le nombre de liaisons que la pièce est capable d’établir avec une autre pièce. Quand les motifs associés sont identiques, on parle d’homopolymère. Sinon, ce sont des copolymères : bipolymères, terpolymères sont les plus communs. b) Polymères organiques : Nous parlerons ici uniquement des polymère organiques, c’est à dire ceux réalisés à partir de monomères composés d’atomes utilisés en chimie organique : C, H, O, et N principalement ainsi que d’autres éléments comme les halogènes (F, Cl, Br, I) ou le souffre, le phosphore...Il existe d’autre polymères ou l’atome de carbone est remplacé par Si (silicones). Pièces mono (m), di (d), tri (t) et tétra (q) fonctionnelles (m) (d) (t) (q) 4/73 Petite molécule Chaîne linéaire - squelette carbonné de la chaîne principale - extrémités Polymère ramifié - ramifications - chaîne principale - extrémités Polymère tridimensionnel - réseau - pontages - noeuds de réticulation Exemples de copolymères constitués de 2 types de comonomères 5/73 Formule développée du motif monomère Appellation courante et abréviation normalisée Noms commerciaux Applications CH2 CH2 Polyéthylène (PE) Lactène, Hostalen, Dowlex Sacs plastique (PEHD/PEBD) Réservoirs de voitures, bouteilles, flacons, bidons, films d’emballage, minidoses CH2 CH CH3 Polypropylène (PP) Appryl, Novolen Films d’emballage alimentaire, bouteilles rigides, intérieur de lave vaisselle, cordes et ficelles CH2 CH Cl Polychlorure de vinyle (PVC) Lacovyl, Vinidur, Vinnolit Tuyauterie, pots de margarine, blisters, bouteilles d’eau minérale, barrières extérieures, films d’emballage alimentaire CH2 CH Polystyrène (PS) Lacqrène, Novodur, Styrol PS : emballages, pots de yaourt, armoire de toilette, cassettes audio, brosses à dents. PS expansé : emballage, boites à oeufs, isolants CH2 C C O O CH3 CH3 Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) Plexiglas, Altuglas, Lucryl... Plaques pour vitres, globes, feux arrière de voiture, lentilles d’appareils photo CF2 CF2 Polytétrafluoroéthylène (PTFE) Téflon, Hostaflon Tuyaux, joints et raccords. Robinet et vannes pour matériel de laboratoire, revêtements anti-adhérents 6/73 Cordages en PP Sacs en PEHD Bouteilles en PEHD Boites en PE Cuillères en PS Articles en PVC PMMA et mobilier en PMMA Protections en PP Tubes en PTFE Poêle recouverte de PTFE (téflon) 7/73 c) Architecture moléculaire et propriétés des polymères Propriétés mécaniques : En général, les polymères formés à partir de chaînes linéaires non réticulées et flexibles sont souples (à certaines températures) tandis que les polymères très réticulés, formant un réseau tridimensionnel sont plus rigides. Les premiers donnent lieu à des polymères thermoplastiques, les seconds à des polymères thermodurcissables. Thermoplastique : se ramollit lorsqu’on la chauffe au dessus d’une certaine température, mais qui redevient solide en dessous. Cette matière conserve de façon réversible sa thermoplasticité initiale. Exemple : PE, PVC, PP.... Thermodurcissable : commence par se ramollir (si pas déjà mou) sous l’action de la chaleur puis se durcit progressivement pour atteindre un état solide qu’elle conservera sous forme irréversible. Exemple : résines phénol/formol ; bakélite, galalith... Elastomères : ce sont des matériaux amorphes, mais avec quelques pontages entre les chaînes macromoléculaires linéaires, ces liaisons sont assurées par des atomes C, S ou O. La réaction permettant d’établir ces liaisons covalentes est la vulcanisation. Cette opération confère aux élastomères une structure tridimensionnelle très souple et très déformable, car le taux de réticulation est faible. Au delà de leur Tg, les caoutchoucs ont une grande capacité de uploads/Ingenierie_Lourd/ cour-polym.pdf
Documents similaires









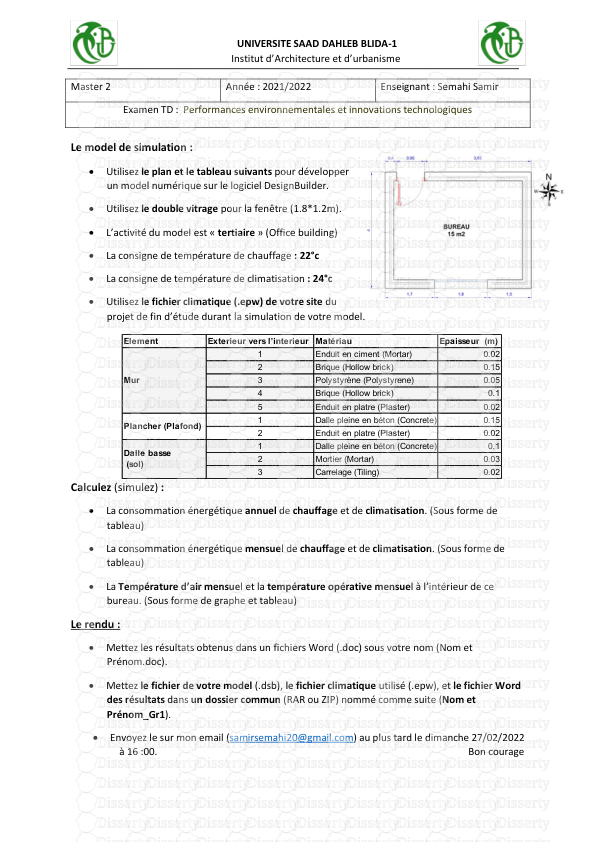
-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 03, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 2.2703MB


