LE PONT Les ponts en maçonnerie considérés aujourd'hui comme des ancêtres vénér
LE PONT Les ponts en maçonnerie considérés aujourd'hui comme des ancêtres vénérables, ont été de l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIII ième siècle, la pointe de la technique que seuls concurrençaient les ponts en bois, très fréquents en raison de leur coût modique et de leur rapidité d'installation. Les Ponts, sont par excellence des travaux publics, ce que n'ignoraient pas les Romains qui les timbraient "S.P.Q.R." (SENATUS FOPULUS - QUE -ROMANUS). Les Romains avaient barré ce bras à la hauteur de Sallèles par une puissante digue ; élargi et creusé le bras Narbonnais pour que toute l'eau ainsi détournée facilita la remontée des bateaux méditerranéens du lac RUBRESSUS (le rouge) au Port des Barques à Narbonne. Après le départ des Romains, la digue de SALLELES n'a plus été entretenue et, en 1320, une forte crue l'emporta. Les eaux suivirent alors leur pente naturelle en creusant leur lit par Cuxac et Coursan. Coursan (CORCIANO) était un petit hameau entouré d'un mur d'enceinte dont une porte face à la rivière existe encore (rue François Cheytion). Photo En ces temps-là, l'Aude était passée à gué ou en bac à l'endroit précis où se trouve aujourd'hui le pont (Quartier de la Barque). Le Roi Charles IX fit édifier un Pont en bois, sur lequel il passa avec sa mère Catherine de Médicis le 4 janvier 1565. Mais, cet ouvrage ne tarda pas à être emporté par une inondation. - II - L'histoire générale du Languedoc relate que " Le 14 octobre 1632, le Roi Louis XIII, la Reine, suivis de toute la Cour partis de Béziers à 11 heures du matin pour se rendre à Narbonne, passèrent l'Aude à gué à 4 heures du soir (sans doute au lieu dit "La Barque") il s'éleva aussitôt un orage extrêmement violent accompagné d'éclairs et de tonnerre et d'une si grande abondance de pluie qu'en moins de 2 heures, la rivière et tous les ruisseaux du voisinage débordèrent, inondèrent toute la plaine à une lieue aux environs de Narbonne, ce qui produisit une fange si épaisse, que la plupart des carrosses et fourgons de la Cour s'embourbèrent et que presque tous les cochers ou charretiers furent obligés de dételer leurs chevaux et d'abandonner leurs bagages pour se sauver. Une heure plus tôt, le Roi et la Reine auraient été noyés.." Lorsque le 31 Mai 1642, Richelieu passe l'Aude à gué à Coursan, le souvenir de l'inondation de 1632 dont les conséquences auraient pu changer l'Histoire de France, est encore dans toutes les mémoires. C'est probablement ce jour là que le Cardinal décida de faire construire le pont. Ce projet ne fut mis en exécution que 43 ans plus tard, le 1er décembre 1685. Les Etats Généraux du Languedoc, votèrent une imposition annuelle de "20 000" livres pendant cinq ans pour la construction du Pont de Coursan... La construction dura plusieurs années, il ne fut ouvert à la circulation qu'en 1706. Construit d'après les plans de Henri Gauthier Ingénieur du Roi, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, l'ouvrage est composé de voûtes en arc en maçonnerie d'assises régulières. A l'origine, cinq arches étaient apparentes, mais, la première côté Béziers étant occultée, on n’en voit que quatre, une en anse de panier et trois en plein cintre. Depuis sa construction, le Pont a été l'objet de soins attentifs et a subi diverses réparations et transformations 1882. Première restauration. 1905. Elargissement et remplacement des parapets maçonnés par des garde-corps en fonte, et des deux côtés de la chaussée des trottoirs de 70 centimètres sont crées. 1924. Encorbellement trottoirs et remplacement des garde-corps en fonte par des balustrades en ciment. 1967. Confortement de la voûte centrale. 1983 Rempiétement des fondations et dégagement des piles. 1985 –1986. Elargissement et renforcement du tablier,.rectification des courbes des deux côtés et pose de garde-corps anodisé. A noter que comme le Pont Neuf de Toulouse le Pont de Coursan présente la particularité de posséder des ouies au dessus des piles aux avant-becs triangulaires. S’agit-il d’une nécessité technique ou d’une fantaisie architecturale ? DES OUVRAGES SENSIBLES La grosse majorité des désordres rencontrés sur ce type d'ouvrage est constituée par des effondrements. Par ailleurs, ces effondrements sont en général brutaux et leur conséquences souvent graves. Cependant, outre les problèmes dus à une mauvaise concep- tion (hypothèses trop "optimistes", par exemple) ou à des mal- façons lors de la construction (armatures mal placées ayant un enrobage insuffisant, détérioration des dispositifs de drai- nage par les engins de chantier), les désordres sont en géné- ral provoqués par une augmentation des poussées faisant suite à une défaillance des réseaux de drainage, ou à l'exécu- tion de travaux au voisinage de l'ouvrage modifiant les condi- tions d'équilibre. DIFFERENTS TYPES D'OUVRAGES DE SOUTENEMENT • Les murs de soutènement, en béton ou en maçonnerie: ils sont rigi- des et constituent un barrage vis à vis des eaux souterraines • Les gabions : au contraire perméables et pouvant accepter des dé- formations (ci-contre à gauche) • Les rideaux de palplanches • Les parois moulées • Les soutènements réalisés par empilement de blocs préfabriqués, type "Loeffel" • Les murs en terre armée (ci-contre à droite) LES DESORDRES • Les désordres communs à tous ces types d'ouvrages : il s'agit de désordres détectables visuellement la plupart du temps. On constatera des mouvements de tout ou partie de l'ou- vrage (déversement, glissement, rotation) ou des manifestations signalant le développe- ment de contraintes anormales (fissurations, épaufrures au niveau de liaisons) • Sur les gabions, on constatera éventuellement des dégradations sur le grillage : corrosion, rupture • Sur les rideaux de palplanches, des déchirures, des dégrafages de serrures, des ruptures de tirants LES OUVRAGES DE SOUTENEMENT Ouvrages de soutènements 1/2 LES OUVRAGES DE SOUTENEMENT (SUITE) • Sur les parois moulées, les murs type "Loeffel" (voir ci-contre avant et après effondrement), les murs en terre armée, les désordres les plus im- portants sont les mêmes que ceux des murs de soutènement, à savoir les problèmes d'instabilité détectables par des mouvements de la structure. Sur les murs en terre armée, des désordres peu- vent être provoqués par la corrosion des armatu- res. • Les modes de rupture possibles des murs de soutènement : voir les schémas ci-dessous LA SURVEILLANCE • Murs de soutènement, parois moulées, murs "Loeffel", murs en terre armée : fonctionne- ment des dispositifs de drainage, état des parements, détection des mouvements éventuels (prendre des alignements, des repères). Etre vigilant chaque fois que l'environnement change (travaux, modifications) • Ouvrages en gabions : état du grillage et des attaches, corrosion • Rideaux de palplanches : aspect des agrafages, apparition de déchirures, apparition de déformations Ouvrages de soutènements 2/2 Caractéristiques techniques Pont-cadres avec piedroits nervurés (PIPO ou PICF) Fiche technique Murs de soutènement Murs végétalisables Passages inférieurs Murs Anti-bruit Corniches de pont Caniveaux de tunnel Structures Bâtiments industriels Sur-mesure Décrit dans le Guide de Conception du Setra, la solution piedroits nervurés préfabriqués et dalles préfabriquées (ou coulées en place ou précontraintes) permet la réalisation de PIPO ou PICF de grandes sections : • hauteur jusqu'à 10 m, portée jusqu’à 20 m selon hauteur de remblai et surcharges. • voir aussi page 30 du catalogue TP-Génie Civil. Piédroit nervuré Dalle préfabriquée Axe de l’ouvrage Coupe type sur piedroit + dalle Domaines d’utilisation Tél. : 02 32 41 02 64 - Fax : 02 32 42 38 89 Route de Rouen - Manneville S/Risle - BP 333 - 27503 Pont Audemer Cedex Principe Semelle de fondation L H Passages inférieurs >>> Cadres • Passages inférieurs de grandes sections (PIPO ou PICF) • Passages inférieurs biais ou en pente • Possibilités de matriçage des faces intérieures vues COLLECTION T E C H N I Q U E C I M B É T O N T 80 PONTS À POUTRES PRÉFABRIQUÉES PRÉCONTRAINTES PAR ADHÉRENCE : PRAD Les atouts de l'offre industrielle pour des ouvrages sobres, économiques et pérennes 5 1. Définition des ponts PRAD Les ponts PRAD (ouvrages de type courant à poutres sous chaussées) sont constitués de poutres précontraintes par adhérence (poutres précontraintes par prétension*) solidarisées par un hourdis en béton coulé en place (sur des cof- frages perdus non participants). Les poutres sont reliées entre elles par des entre- toises uniquement au niveau des appuis. Les poutres préfabriquées en usine sont de hauteur constante et leur espacement est de l’ordre de 80 cm à 1 m. Le hourdis a une épaisseur comprise entre 18 et 22 cm, pour les ponts-routes, et de 25 cm, pour les ponts-rails. L’un des franchissements de l’A64 (reliant Muret à Saint-Gaudens) dessiné par les architectes Faup et Zirk. *La précontrainte est réalisée par des armatures tendues avant bétonnage et durcissement du béton. Pont PRAD 6 2. Domaine d’utilisation privilégiée des ponts PRAD Les ponts PRAD sont devenus, depuis de nombreuses années, une solution classique pour la réalisation de ponts routiers ou autoroutiers dans la gamme des portées de 10 à 35 m (passage inférieur ou passage supérieur). Ils sont aussi utilisés désormais pour la réalisation d’ouvrages ferroviaires (à une travée isostatique ou plusieurs travées hyperstatiques). Figure 1: coupe uploads/Ingenierie_Lourd/ dossier-unique.pdf
Documents similaires







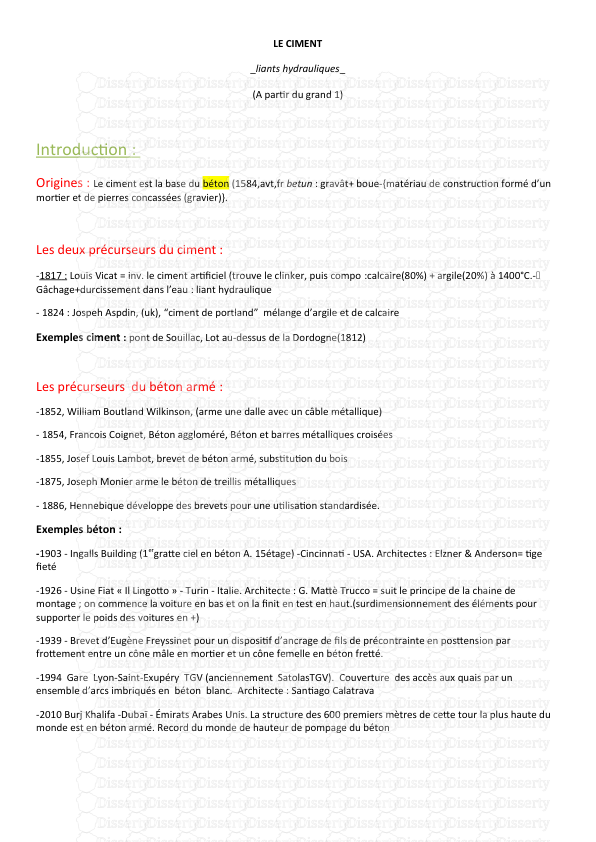


-
42
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 08, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 10.0565MB


