PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS OPERATION FACADES COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MA
PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS OPERATION FACADES COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS DOCUMENT DE REFERENCE Bon de commande B010014 du 18/01/01 Article 6226 – W01305 Juillet 2001 CENTRE DE FORMATION A LA REHABILITATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL MAISON DU ROI RENE - 6 RUE GRIVOLAS 84 000 AVIGNON - TEL . 33 0 4 90 85 59 82 - FAX 33 0 4 90 27 05 18 canonge@ecole-avignon.com - www.ecole-avignon.com N° Siren 328 768 353 00026 - n° Organisme formateur 93 84 00 242 84 – Code APE 925 C PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS OPERATION FACADES COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS Document de référence Bon de commande B010014 du 18/01/01 Article 6226 – W01305 SOMMAIRE OBSERVER LA FACADE POURQUOI OBSERVER ? 1 1. LA FACADE ET SON VOCABULAIRE 2 2. LE PAREMENT ENDUIT • La mise en valeur du bâti 8 • Les détails de mise en œuvre 12 • La protection du mur 13 3. TYPOLOGIE ARCHITECTURALE • 1 - L’habitat traditionnel en milieu rural 17 • 2 - L’habitat adapté façon architecture bourgeoise 19ème 24 • 3 - L’architecture climatique 30 INTERVENIR SUR LE BATI ANCIEN 1. ETAT DES LIEUX 34 • La présentation des parements 35 • La protection des parements 35 2. LE CHOIX DU RAVALEMENT 37 3. CONSTITUTION D’UN CAHIER DES CHARGES 39 • 1 - L’habitat traditionnel en milieu rural 39 • 2 - L’habitat adapté façon architecture bourgeoise 19ème 40 • 3 - L’architecture climatique 40 ANNEXES : MATERIAUX, TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE 1. MATERIAUX 41 2. CHOIX DU LIANT 42 • Le choix du liant • Le chois des sables 3. FICHES TECHNIQUES • Type de finition : Jeté-recoupé 46 • Type de finition : Lissé à la truelle 47 • Type de finition :Taloché 48 • Type de finition :Tyrolienne 50 • Type de finition : Peinture à la chaux 51 Repérage photographique Parc Naturel Régional du Vercors OPERATION FACADES Communauté de communes du MASSIF DU VERCORS Cette étude fait suite à une commande du Parc Naturel Régional du Vercors dans le cadre de l’opération Façades de la communauté de communes du Massif du Vercors (Bon de commande B010014 du 18/01/01, Article 6226 – W01305). Cette étude concerne les communes de : - AUTRANS - CORRENCON EN VERCORS - ENGINS - LANS EN VERCORS - MEAUDRE - SAINT NIZIER VILLARD DE LANS Juin 2001 1 LE BATI ANCIEN EST PORTEUR DU PROJET DE RAVALEMENT OBSERVER LA FACADE POURQUOI OBSERVER ? - L’observation attentive du bâti ancien permet de mieux le connaître, la connaissance du vocabulaire des ouvrages spécifiques qui le compose permet d’en parler plus facilement, et de se l’approprier. - Le bâti ancien est le souvent porteur de son propre projet, l’observation attentive va permettre la découverte de détails inattendus, de points communs avec les maisons environnantes. - L'observation est le point de départ de tout projet de travaux de réhabilitation, cette étape permet de bâtir la liste des points à traiter, matériaux, pathologies, adaptations… L’inventaire de tous ces points conduira souvent à devoir faire appel à un homme de l’art, qui pourra hiérarchiser les interventions, la maîtrise d’œuvre de l’architecte prend toute sa place sur les chantiers de réhabilitation. Etabli sur un plan rectangulaire, souvent allongé, la maison en Vercors se caractérise par la présence d’un pignon à redents. Celui-ci marque de manière très forte le paysage bâti. La façade principale de la maison -généralement exposée plein sud et comprenant le maximum d’ouvertures, la porte d’entrée- est indifféremment localisée sur les murs latéraux ou sur le pignon à redents. (Méaudre, La Truite) 2 LA FACADE ET SON VOCABULAIRE L’observation de la façade oblige à examiner sa composition architecturale, les éléments de modénature, le parement du mur avec sa finition, son grain, sa couleur. La composition d'une façade s'exprime à travers l'assemblage de baies : La baie est une ouverture quelconque dans le mur, son encadrement en fait partie. L’encadrement de la baie peut être réalisé de multiples façons, hourdage de pierres, linteau ou assemblage de bois. L’ensemble peut être caché par un enduit ou laissé apparent. (Villard de Lans, Aux Bouchards) La composition ainsi formée se décrit à partir d’assemblages verticaux ou horizontaux : Pour ce qui est de la composition verticale on a : La travée, dans l'architecture courante, désigne la superposition des baies composées sur le même axe vertical. Les limites latérales de la travée sont les axes des trumeaux (ou le calage et l'axe du premier trumeau). Le trumeau désigne le pan de mur situé entre deux baies d'un même niveau. Le calage est le pan de mur compris entre un angle du bâtiment et la première baie rencontrée latéralement. Le plein de travée est le pan de mur compris entre deux baies d'une même travée Soubassement, plein de travée, étage déterminent la composition horizontale de la façade. Le couronnement (corniche, frise, architrave) complète généralement cette composition dans la partie haute du mur, ce dispositif est peu répandu, la forte identité, donnée par les pignons, est peu être à l’origine de ce faible emploi. (Autrans) 3 La composition horizontale se décrit par : Les niveaux, ils correspondent aux étages.; le niveau est à la façade ce que l'étage est à la construction. L'étage en attique : c’est un niveau de couronnement de la composition. Sa hauteur est franchement inférieure à celle des autres niveaux dont il est séparé par un corps de moulure (corniche, frise) plus important que la corniche de l'étage attique lui-même. L'entresol : c’est un demi-étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, de hauteur sensiblement inférieure, et comptant dans la composition de l'élévation comme compris dans le premier niveau (niveau de soubassement) Etage en attique et entresol sont des dispositifs quasi absents de la zone d’étude, les exceptions concernent des bâtiments importants de l’architecture climatique. Calage, trumeau, travée déterminent la composition verticale. Le calage comprend toujours une chaîne d’angle qui lient les deux murs perpendiculaires. Celle-ci est parfois laissée apparente ou recouverte d’un enduit, très souvent un dessin de chaîne d’angle harpée est repris sur l’enduit. (Autrans) La composition architecturale de la façade est accompagnée d’ouvrage spécifique que l’on nomme de façon générique « modénature », on peut décrire ces éléments de composition en trois grandes familles, la baie, les éléments qui accompagnent la composition verticale et horizontale. La baie : Le linteau est l'organe de couvrement d'une baie. Il peut être droit ou cintré. Il est monolithe. La plate-bande est un arc appareillé plat en sous face. Elle est formée de claveaux ; celui du centre est la clé. Lorsqu'elle couvre une baie, elle remplace le linteau monolithe. En parement de façade on rencontre fréquemment un couvrement de baie formé de trois parties : deux sommiers latéraux, reposant sur des piédroits, et une clé centrale. L'appui est la partie inférieure, horizontale, de la baie (fenêtre, fausse fenêtre, mais non pas porte). Il peut être au nu du mur ou saillant. S'il est saillant, il peut recevoir une moulure qui déborde généralement les piédroits ou les chambranles de la baie. Le piédroit est l'organe porteur du couvrement de la baie. Les piédroits constituent également les limites latérales des trumeaux. En vocabulaire de composition la face du piédroit parallèle au trumeau est appelée jambage. Son retour d'épaisseur, de l'arête à la fenêtre est le tableau. Le chambranle est le cadre de la baie sur le parement du mur percé. Il peut être mouluré. Lorsque le chambranle est agrémenté aux angles d'un ressaut, il est dit à crossettes. L'allège désigne le pan de mur situé entre le plancher et l'appui de la baie dans le sens vertical, et entre les ébrasements de la baie dans le sens horizontal. Cette partie du mur, qui porte la menuiserie, est très souvent moins épaisse que le mur de la façade, donc plus légère, 4 d'où son nom. Disposition constructive non visible de l'extérieur, il est cependant fréquent que l'allège soit signifiée en façade par un panneautage ou par une saillie du plein de travée. La baie est une ouverture dans le mur, son encadrement comprend deux piédroits, un linteau, un appui, ce sont les organes de structure qui permettent les descentes de charges des efforts de la maçonnerie. En parement, ces ouvrages peuvent recevoir un dessin régulier, mouluré : le chambranle. (Lans en Vercors, La chenevarie) Dans la zone d’étude, le couvrement de la baie est composé pour l’essentiel de linteau de pierre monolithique, on trouve aussi sur du bâti à usage agricole des linteaux de bois. Dans le cas de grande portée, le linteau est soulagé par un arc de décharge. L’usage de la plate-bande est rare, on la trouve sur des bâtiments 19ème et début 20ème. L’appui réalisé en pierre est saillant ou au nu du parement. Cette maison, située dans le hameau des Drevets à Lans en Vercors, présente un parement enduit taloché, les encadrements des baies étaient soulignés par un chambranle peint. Il faut noter ici l’amortissement de l’enduit au même nu que la pierre, le badigeon couvre l’un et l’autre indifféremment. Eléments uploads/Ingenierie_Lourd/ facades-enduits-pdf.pdf
Documents similaires







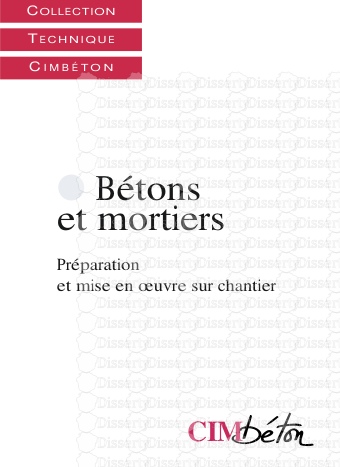


-
80
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 13, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 3.4823MB


