1 Élèves Pierre BOULANGER Louis GODRON Benoît PAQUES Projet encadré par : Anne-
1 Élèves Pierre BOULANGER Louis GODRON Benoît PAQUES Projet encadré par : Anne-Claire CHENUS CONCOURS C.GENIAL 2017 Lycée Saint-Charles, Orléans Projet réalisé en collaboration avec : Corinne ROBIN et Abderrazak YAHYAOUI, responsables des études de Lig’Air Alan URBAN, Chercheur en Neurosciences et Imagerie cérébrale, NERF 2 DUSTRACK’R Problématique : Comment élaborer un dispositif mobile qui permette de rendre compte efficacement de la pollution aux microparticules ? Résumé Les concentrations en microparticules (PM10), enjeu de santé public majeur sont déterminées en région Centre par 11 stations fixes. Notre objectif est de renforcer ce réseau en élaborant un dispositif autonome permettant de cartographier à l’aide d’une base GPS la pollution en trois dimensions dans les lieux difficilement accessibles. Notre dispositif se compose d’un drone équipé de différents capteurs permettant la mesure des PM10 ainsi que la température, la pression et l’hygrométrie ce qui permet de corriger en temps réel les mesures grâce à des modèles mathématiques. Nous avons démontré la fiabilité de notre approche car nos mesures sont comparables à celles du réseau Lig’Air, partenaire de notre projet. Avant d’optimiser les conditions de mesure des PM10 en vol, nous avons validé notre dispositif en suivant le niveau de PM10 à différentes hauteurs lors de l’émission contrôlée de poussières de cheminées. Enfin, nous avons assemblé un drone qui autorise un vol de 15 min et qui permettra de cartographier efficacement la pollution atmosphérique. Notre projet offre une approche innovante qui pourrait permettre un suivi précis géographiquement et en temps réel de la pollution atmosphérique. 3 REMERCIEMENTS Ce projet a été effectué au sein du lycée Saint-Charles sous la direction de Madame PERROT et en collaboration avec Corinne ROBIN et Abderrazak YAHYAOUI, responsables des études de Lig’Air ainsi qu’Alan URBAN, chercheur en neurosciences. Nous remercions Madame Corinne ROBIN et Monsieur Abderrazak YAHYAOUI pour leur disponibilité et pour nous avoir reçus dans leurs locaux afin de nous faire découvrir leur réseau de mesures. Nous remercions également Monsieur Florent HOSMALIN, Responsable technique de Lig’Air pour les informations techniques qu’il nous a fournies au sujet des mesures des stations de leur réseau. Nous tenons à remercier Monsieur Alan URBAN pour son implication dans le projet et pour l’aide qu’il nous a apportée sur la partie programmation du prototype. Nous remercions également Madame Claire RUELLO, technicienne du laboratoire du lycée pour son soutien ainsi que pour la gestion des commandes de matériel. Enfin, nous remercions Madame Pascale PERROT, directrice adjointe du lycée Saint-Charles, ainsi que Monsieur Frédéric LE NALIO, directeur du cours Saint Charles, qui nous ont soutenus dans la réalisation du projet. 4 INTRODUCTION De nombreuses villes françaises et notamment Paris sont régulièrement touchées par des pics de pollution atmosphérique. Chaque année, plus de 2 millions de décès prématurés à travers le monde, sont attribués aux effets de la pollution de l’air. Parmi les nombreux polluants atmosphériques, on trouve notamment les microparticules. Comment sont classifiées les microparticules ? Notre projet s’intéresse aux particules en suspension désignées par l’abréviation PM (Particulate Matter). Elles sont classées en fonction de leur diamètre aérodynamique (diamètre moyen d’une sphère qui possèderaient les propriétés aérodynamiques équivalentes) : Quelle est l’origine et la composition des microparticules ? Les particules peuvent être rejetées directement dans l’atmosphère (particules primaires) ou elles peuvent provenir de réactions photochimiques entre précurseurs gazeux (particules secondaires). À cause du trafic routier ou du vent, des particules déposées peuvent également être remises en suspension. Les sources d’émission principales sont le chauffage résidentiel, les chantiers et BTP, le transport, les combustions industrielles … Leur origine est également naturelle : éruptions volcaniques, feux de forêt, érosion éolienne des sols … La figure 1a montre un filtre neuf et un filtre après exposition du trafic tandis que la figure 1b. montre l’image d’un filtre obtenue grâce à un microscope électronique : Figure 1 : a) Photo d’un filtre neuf et d’un filtre après une semaine d’exposition au trafic routier. b) image d'un filtre à particules placé le long d'une route par un microscope électronique. Les suies de diesel (en gris sur l'image) sont présentes de manière prédominante sur le filtre. Les particules indiquées en bleu sur l'image sont des poussières de combustion, les particules colorées en rose sont d'origine minérale et les cristaux, en vert, sont des sels. (Source : C.Trimbacher Umwelbundesamt Wien) On distingue les PM10, particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm et les PM2,5 aussi appelées particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm. 5 Quel est l’effet des microparticules sur la santé ? Les microparticules ne sont pas arrêtées par la barrière du nez et pénètrent ainsi dans l’appareil respiratoire. De plus, les PM2,5 peuvent atteindre les ramifications les plus profondes de l’appareil respiratoire. Leurs effets sont comparables à ceux du tabagisme passif. PM2,5 PM10 Affectation des voies respiratoires Augmentation du risque de maladies respiratoires chroniques et de la mortalité cardiopulmonaire Augmentation du cancer du poumon chez l’adulte. Effets aigus sur les symptômes respiratoires et les maladies cardiovasculaires. En Europe : Perte d’espérance de vie moyenne à 9 mois 386 000 décès prématurés 110000 hospitalsations graves annuelles Face à ce risque sanitaire, des normes à ne pas dépasser sont définies par l’OMS (tableau 1). Les critères nationaux de qualité de l'air sont également définis dans le Code de l'environnement français (similaires à l’OMS). Polluant Lignes directrices de l’OMS PM2,5 Moyenne annuelle 10 μg/m3 Moyenne journalière 25 μg/m3 (pas plus de 3 dépassement par an autorisés) PM10 Moyenne annuelle 20 μg/m3 Moyenne journalière 50 μg/m3(pas plus de 3 dépassement par an autorisés) Tableau 1 : critères de qualité de l’air en fonction du type de particules Comment sont actuellement mesurées les concentrations en microparticules ? Des réseaux de surveillance de l’air sont mis en place dans toute la France. Dans la région Centre, il s’agit de Lig’Air que nous avons contacté afin de mieux comprendre les enjeux des mesures de la pollution atmosphérique. Ils disposent de stations de mesure fixes implantés selon la carte suivante : Figure 2 : Carte montrant les stations de mesures des concentrations en PM 10 (24/02/2017) aux environs d’Orléans 6 Les stations (fig. 3) sont fixes, situées à un mètre de hauteur par rapport au sol. Le principe de mesure est le suivant : L’air est aspiré et passe à travers un filtre sur lequel les particules se déposent. La concentration massique est alors mesurée par pesée gravimétrique (le filtre est pesé en continu) ou par jauge beta. Le filtre en verre est soumis à un rayonnement β. Un compteur Geiger mesure l’intensité du rayonnement transmis, l’absorption étant proportionnelle à la masse de matière rencontrée. La mesure transmise correspond à une moyenne calculée toutes les 15 minutes. Figure 3 : photo d’une station de mesures de la concentration en PM10 Notre problématique est donc : Comment élaborer un dispositif mobile qui permette de rendre compte efficacement de la pollution aux microparticules ? Pour répondre à la problématique, nous avons défini les objectifs suivants : Élaborer un module qui effectue les fonctions suivantes : mesure de la concentration en microparticules (PM10) ainsi que des facteurs qui influent la mesure : pression, température, hygrométrie. Pour connaître la position du module, nous avons ajouté un GPS. Effectuer des tests des capteurs de microparticules en environnement pollué. Monter le module sur un dispositif mobile : une perche télescopique dans un premier temps Élaborer le drone et l’équiper avec le module. Effectuer les acquisitions et les comparer avec les mesures de Lig’Air. Ce réseau présente deux limites : Il n’étudie pas l’évolution de la concentration en microparticules en fonction de la hauteur (intéressant dans l’élaboration des modèles de prévision de la pollution atmosphérique) Il ne s’adapte pas aux fluctuations en temps réel si un pic de pollution très localisé venait à se produire (incident tel qu’une explosion …). Il faudrait alors un dispositif mobile qui surveille particulièrement la zone concernée. 7 PARTIE 1 : Comment mesurer la concentration en microparticules ? 1.1. Choix du capteur de poussières : PPD42NS. Nous avons choisi de travailler avec le Capteur de poussières (PPD42NS, Evola). Il permet de détecter les microparticules ayant un diamètre de 1 µm minimum et d’évaluer la concentration des PM10. Température de fonctionnement : 0-45 °C Taux d’humidité maximal : 95 % Coût : 20 euros La circulation de l’air dans le capteur se fait grâce à la résistance chauffante (figure 4) qui permet des mouvements de convection. Le capteur doit ainsi être positionné verticalement, la résistance chauffante en bas. En présence de microparticules, le flux lumineux reçu par la photodiode diminue. Le temps pendant lequel l’intensité lumineuse est inférieure à une valeur seuil appelé Low Pulse Occupancy Time (LPOT) est mesuré, puis le rapport LPOT/temps d’échantillonnage (=30 s) est calculé et ensuite converti en nombre de particules par unité de volume (pcs : 1 particule/238 mL=0,01 cf avec cf= 1 cubic feet) en utilisant une courbe de calibration fournie par le constructeur (Fig. 5). Figure 4 : à gauche : composants du capteur de microparticules. À droite : uploads/Ingenierie_Lourd/ lycee-saint-charles.pdf
Documents similaires







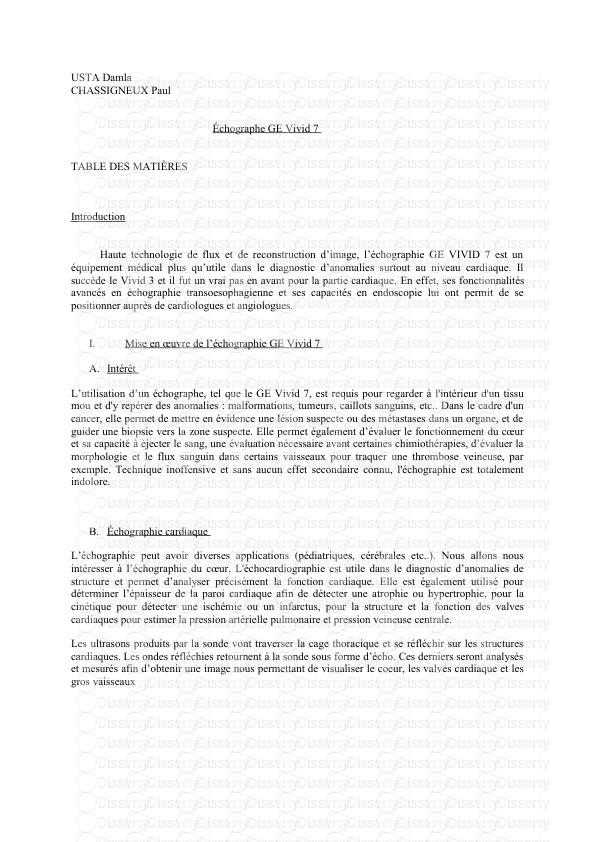


-
51
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 23, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 2.8133MB


