1. « Madame Bovary » est-il un roman réaliste ? Maupassant et Zola virent Flaub
1. « Madame Bovary » est-il un roman réaliste ? Maupassant et Zola virent Flaubert comme étant le premier romancier réaliste. Alors que Flaubert lui-même dit « exécrer ce qu’il est convenu d’appeler le réalisme ». Alors que faut-il donc penser de ces positions contradictoires ? Est-ce que Madame Bovary est un roman réaliste comme le disent les contemporains de Flaubert ou absolument pas d’après Flaubert ? Définition du réalisme selon le dictionnaire Larousse à lire sur le power point. Cette contradiction vient du fait que tout dépend de ce que l’on entend par « réalisme ». Madame Bovary est un roman réaliste par l’exactitude de sa peinture sociale car la description des faits y est très minutieuse ainsi que l’étude des mœurs. Comme nous le savons, Flaubert avait le sens du détail. Pour qu’un roman soit caractériser de réaliste, il ne faut pas seulement qu’il soit réduit à la solidité d’une information documentaire mais également il faut donner l’apparence de la vérité. 2. Le réalisme dans le roman Nous pouvons retrouver le réalisme dans le roman grâce à trois méthodes : 1) Une description minutieuse des faits Les descriptions des paysages de Flaubert sont d’une grande précision, comme lorsqu’il présente la ville d’Yonville et ses habitants (2e partie, I) ou l’opération du pied bot ou les effets de l’empoisonnement par arsenic sur lesquels il s’était énormément renseigné comme nous l’avions vu en classe. 2) Une étude des mœurs très documentée « Madame Bovary » est aussi un roman social car les différentes classes de la société y sont représentées : - Les nobles du château de la Vaubyessard - La bourgeoisie aisée avec Rodolphe - La bourgeoisie commerçante avec M. Lheureux - La petite bourgeoisie avec Léon et les Bovary - Les professions libérales tel que notaires et médecins - Les paysans C’est aussi à travers les vêtements, les objets et les niveaux de langage que cette authentique manière de vivre est dépeinte. Par exemple il y a : - Les noces d’Emma et de Charles qui reproduisent ce qu’étaient les noces campagnardes à l’époque (1ere partie, IV). - Les comices agricoles représentent un événement annuel et attendu (2eme partie, VIII). - La veillée funèbre était également très traditionnelle (3eme partie, IX). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 3) Le sens du détail Comme nous l’avons vu avant, Flaubert attachait une grande importance aux détails. Comme lorsqu’il décrit la soutane du curé, maculé de « tâches de graisse et de tabac » (2e partie, VI, p. 173). Charles explique comment déboucher un cruchon de cidre (2e partie, XIV, p.295- 296). Charles souhaitant faire plaisir à sa femme Emma, acquière un « daguerréotype » (2e partie, VI, p.179), dont la technique venait d’être inventé en 1838. Si on prend ces détails séparément, ils ne sont pas très importants mais leur accumulation permet de donner une impression de réalité et de vérité. 3. Un réalisme insuffisant ? Les techniques qu’à utiliser pour créer cet effet de réalité ne suffisent pas pour définir le réalisme. Pour qu’un roman soit réaliste, on doit pouvoir comprendre la vision propre à l’écrivain de façon à se rendre compte de la vie. Mais Flaubert a été jugé trop sec et insensible. C’est un reproche que Flaubert assume. - Un reproche d’« insensibilité » Il a été reproché à Flaubert sa trop grande neutralité et son absence d’implication personnelle et affective. Duranty (romancier et critique d’art français), déclare dans Réalisme que Madame Bovary : « représente l’obstination de la description. Ce roman est un de ceux qui rappellent le dessin linéaire, tant il est fait au compas, avec minutie ; calculé travaillé, tout en angles droits, et en définitive sec et aride (…). Trop d’étude ne remplace pas la spontanéité qui vient du sentiment » (Duranty, Réalisme, 15 mars 1857). D’après Duranty, l’œuvre est impersonnel et l’empêcherait d’être réaliste. - Un reproche apparemment fondé Flaubert n’intervient pas dans le roman de façon à juger des qualités et défauts de ses personnages comme avait pu le faire Balzac et Stendhal car cette façon d’interpeller le lecteur était très fréquente au milieu du XIXe siècle. Dans son roman, les opinions personnelles de Flaubert ne transparaissent pas. Mais sa présence peut transparaitre dans le « nous » qui ouvre le roman ou dans une pensée générale à valeur de maxime : « la parole humaine est comme un chaudron fêlé » (2e partie, XII, p,265). Mais sa présence reste très discrète. Flaubert laisse donc son lecteur libre de son opinion. (Parce qu'il affirme là explicitement l'inadéquation fondamentale du langage à exprimer fidèlement les pensées humaines, on a vu dans ces mots l'emblème du roman, traditionnellement présenté comme le livre de l'échec et de l'incommunicabilité. De fait, le motif du langage inutile apparaît réellement central dans Madame Bovary : il y revient sans cesse, décliné sous toutes les formes, à tel point que le roman entier semble formé du pavage de cette seule idée : les mots ne mènent à rien, a fortiori à rien de bon.) - Un reproche assumé Cette impersonnalité, Flaubert l’a souhaité : « Nul lyrisme, pas de réflexion, personnalité de l’auteur absente », écrivait-il à Louise Colet. Flaubert n’était pas friant du romantisme et de 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ses conceptions esthétiques. Pour Flaubert, tous les sujets sont égaux : il n’y en a pas un plus petit ou plus grand, ni de bon ou mauvais. Donc pour Flaubert, tout dépend du « style ». C’est pourquoi l’auteur ne doit pas intervenir ou expliquer ou commenter ses intentions : il doit « dans son œuvre être comme Dieu dans l’univers, présent partout et visible nulle part », écrivait-il à Louise Colet. 4. Un réalisme « subjectif » Le réalisme de Flaubert ne correspond pas vraiment à la définition du réalisme en vogue de l’époque mais ça ne veut pas dire qu’il n’existait pas. Pour créer le réalisme flaubertien, il n’est décrit que ce qu’un personnage voit. Au contraire du réalisme classique qui a une approche statique et globale de la réalité. C’est donc une saisie partielle et dépendante de l’œil qui l’observe. C’est le procédé qu’on appelle focalisation interne ou point de vue subjectif. Nous verrons également plus tard comment la technique du montage permet de recréer le réel. - Le point de vue subjectif (ou focalisation interne) Lorsque l’on découvre le personnage de Charles, il est décrit à travers le seul regard de ses futurs camarades : « le nouveau était un gars de la campagne, d’une quinzaine d’années environ, et plus haut de taille qu’aucun de nous tous » (1re partie, I, p.47). On découvre également le personnage d’Emma à travers le regard de Charles (1re partie, II, p.62). La soirée au bal des Vaubyessard (1re partie, VIII, p.99-107) nous est raconté à travers les yeux émerveillées d’Emma. Pour Flaubert, ce qui vaut pour les personnages vaut aussi pour les paysages. Ils ne sont pas évoqués de façon général mais à travers le regarde de la personne qui les regardent. C’est pour cette raison que la ville de Yonville est vue différemment par Emma, par son père ou par Léon. Quand Emma était heureuse d’être avec Rodolphe, Emma voyait Yonville comme un « petit » et « pauvre » village (2e partie, IX, p. 227). Quand Léon rentre de paris, il voit Yonville différemment et cela lui inspire un sentiment de « vanité triomphante et d’attendrissement » (3e partie, IV, p.342). Quand le père Rouault rentre du cimetière après avoir enterré sa fille, il n’aperçoit du « haut de la côte » à l’horizon qu’un « enclos de murs ou des arbres, çà et là, faisaient des bouquets noirs entre des pierres blanches » (3e partie, X, p.435-436). On peut donc conclure que la description du réel dépend de l’observateur et de son état d’esprit. citer les passages du textes dans le pp et expliquer brièvement - La technique du montage L’angle par lequel une scène va nous être décrite peut-être habillement imposé par le narrateur comme avec l’épisode des comices agricoles (2e partie, VIII). Il y a deux lignes narratrices qui s’y entremêlent : celle des discours officiels et celle privé de la conversation entre Emma et Rodolphe. La scène de séduction entre les deux amants interfère avec la scène de la distribution des prix et récompenses. Cela crée un effet grotesque. Mais si on sépare les deux scènes comme si elles ne se passaient pas au même moment, le grotesque disparait. Ici Flaubert utilise la technique du montage comme en l’utilise au cinéma uploads/Litterature/ bovarysme-et-realisme.pdf
Documents similaires

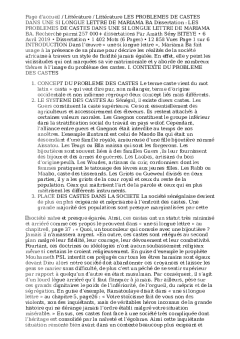








-
41
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 23, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1162MB


