LA PREMIÈRE FONDATION UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER L’une des premières fondatio
LA PREMIÈRE FONDATION UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER L’une des premières fondations universitaires françaises en sciences humaines et sociales Fondation universitaire Montpellier III Lexicographie de l’Égyptien Ancien – Hiérolexique Dossier de présentation Dossier réalisé par l’Université Paul-Valéry Montpellier III (SAJI) en collaboration avec Dimitri MEEKS Toutes les photos © Dimitri MEEKS 2 DOSSIER DE PRÉSENTATION Sommaire 1- Programme « Fondation universitaire Montpellier III-Lexicographie de l’égyptien ancien-Hiérolexique» Introduction : l’égyptologie et l’écriture hiéroglyphique Importance de la paléographie dans l’égyptologie État de la documentation lexicale 2- Présentation du dictionnaire et de son programme scientifique Le dictionnaire et son auteur Particularités du programme et intérêt des versions en langues étrangères La base internationale de données lexicales 3- Les acteurs de la fondation Les acteurs fondateurs : l’Université Paul-Valéry et l’association Hiérolexique La fondation : une structure juridique nouvellement créée 4- Le mécénat Le mécénat : être mécène du programme « Dictionnaire hiéroglyphique » ; en faveur des mécènes ; les contreparties Les objectifs du mécénat 5- Le budget 6- Contacts Sarcophage de Menqabou, Boston, ca 2000 av. Hiéroglyphe déterminatif du mot qrs.t « funérailles, enterrement » 3 1- LE PROGRAMME Hiérolexique Fondation universitaire Montpellier III Lexicographie de l’Égyptien Ancien- Hiérolexique Premier dictionnaire hiéroglyphique en langue française depuis la fondation de l’égyptologie par Champollion et son projet de versions en langues étrangères. INTRODUCTION L’égyptologie suscite depuis longtemps un engouement qui touche toutes les couches de la société. Les queues interminables qui se forment devant les entrées des expositions consacrées à l’Égypte ancienne en témoignent. Les raisons exactes de ce phénomène restent, pour une grande part, à analyser, mais il révèle à coup sûr une demande forte et profonde à laquelle les chercheurs et les politiques, chacun dans leur domaine, ont à répondre. Si la quête d’un merveilleux, qui laisse beaucoup de place à l’imagination, a ici son importance c’est, de façon beaucoup plus inconsciente et diffuse, l’image d’une histoire extrêmement longue et évoluant lentement, apparemment sans grands heurts, qui explique, au moins en partie, l’attrait qu’exerce l’Égypte. Elle donne l’illusion réconfortante d’un monde stable qui s’oppose à l’image de notre monde en perpétuelle mutation, d’un monde aux repères assurés et rassurants face à un monde où les marques se déplacent constamment. L’invention de l’écriture au Proche-Orient, d’abord à Sumer, puis en Égypte, a considérablement modifié les sociétés où elle a été mise en œuvre pour la première fois ; elle témoigne de l’apparition de structures étatiques, fondées sur un développement urbain, et réclamant un outil de communication, d’échanges, de calcul et d’archivage que la parole seule ne pouvait offrir. L’écriture hiéroglyphique apparaît en Égypte à la fin du IVe millénaire avant notre ère et sera encore utilisée au IIe siècle après dans la décoration du temple d’Esna en Haute Égypte. Durant ce très long laps de temps, ce système composé d’images mêlant, dans un même texte, des humains, des animaux, des plantes, des parties du monde ou des objets usuels du quotidien, a servi à écrire « l’égyptien ancien », langue aujourd’hui morte parlée sur le territoire de l’actuelle vallée du Nil égyptienne. Ces images, qui sont des signes d’écriture, ont été qualifiées de « hiéroglyphes » c’est-à-dire de « caractères sacrés » par les Grecs du fait de leur usage, essentiellement réservé à l’ornement des monuments royaux ou privés à destination religieuse ou funéraire. Tombe de Sarenpout II, ca 1900 av. 4 Importance de la paléographie dans l’égyptologie Mis à disposition de l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao), au Caire (2001-2005), par le CNRS, Dimitri Meeks, Directeur de recherche, y a conçu et mis en œuvre un programme international de paléographie hiéroglyphique qu’il a dirigé jusqu’en 2007. Grâce à l’aide de Bernard Mathieu, alors directeur de cet Institut, ce programme publie désormais ses résultats dans une collection de l’Ifao, « Paléographie hiéroglyphique », collection dont Dimitri Meeks est toujours le directeur. Depuis les débuts de leur discipline, les égyptologues n’ont jamais dressé l’inventaire des signes hiéroglyphes employés durant toute l’histoire de cette écriture. Le but du programme est donc d’aider à l’établissement de cet inventaire sur des bases scientifiques rigoureuses. À partir de là, il est aujourd’hui possible de définir les principes d’une grammatologie du système hiéroglyphique qui mette en lumière les mécanismes les moins apparents de son fonctionnement, de raconter son histoire et en révéler une véritable psychologie. Ce travail va, entre autre, contribuer à un autre aspect du dictionnaire que l’on ne saurait négliger, la fonte hiéroglyphique qui servira à composer les citations. Cette fonte, déjà créée par Dimitri Meeks, et qui comporte plus de 2000 signes pourra ainsi être améliorée et complétée. État de la documentation lexicale Les dictionnaires et lexiques publiés à ce jour, en allemand ou en anglais, se contentent en général de reproduire, avec des améliorations souvent mineures, les traductions proposées dans le grand dictionnaire allemand de l’Académie de Berlin publié de 1925 à 1931. La collecte des données pour ce travail avait débuté en 1897 (il y a plus de cent dix ans) et la rédaction commença en 1906 avec des tâtonnements constants pour en fixer la méthode. En près de 80 ans notre connaissance du vocabulaire égyptien a très considérablement progressé, notre perception de la culture égyptienne ancienne s’est aussi fortement améliorée. Une mise à jour est devenue d’une urgence extrême. Les chercheurs, les étudiants, les amateurs éclairés, ont besoin maintenant d’un ouvrage totalement à jour de l’état des connaissances et qui leur évitera de longues et pénibles recherches en bibliothèque, pour peu qu’ils y aient accès. C’est ce que sera le dictionnaire du présent programme. Assouan, tombe de Sarenpout II, ca 1900 av. 5 2- PRESENTATION DU DICTIONNAIRE ET DE SON PROGRAMME SCIENTIFIQUE Le programme s’articule autour de trois axes : 1. Un dictionnaire hiéroglyphique (égyptien ancien-français) 2. Des versions du dictionnaire en langues anglaise et arabe 3. Une base de données lexicales Le dictionnaire et son auteur Le dictionnaire offrira plusieurs niveaux d’information : celui nécessaire aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs et celui utile aux étudiants et amateurs. Fondé sur les recherches menées par Dimitri Meeks au cours de ces trente dernières années, le dictionnaire contiendra les quelque 23 000 vocables actuellement répertoriés sur les 3000 ans d’existence de la langue égyptienne antique. Son approche encyclopédique est novatrice et permettra de restituer le vocabulaire dans son contexte culturel. Au regard des dictionnaires publiés auparavant, il enregistrera plusieurs centaines de mots non répertoriés antérieurement ; la signification de tous sera réexaminée. S’y ajouteront des références aux commentaires scientifiques dont chacun aura pu bénéficier et éparpillées dans les publications et périodiques spécialisés. Inscrit dans les axes de recherche de l’Institut d’égyptologie François Daumas de l’Université Paul-Valéry de Montpellier, le dictionnaire sera d’abord publié sur support papier à l’issue d’une première phase prévue pour durer 5 à 6 ans. Les travaux de rédaction menés sur cette version, permettront ensuite la mise en œuvre d’une base internationale de données lexicales, contenant toutes les informations accumulées durant les phases initiales et sera régulièrement mise à jour. 6 Dimitri MEEKS. Présentation Dimitri Meeks est né à Paris en 1941. C’est aussi à Paris, à l’École Pratique des Hautes Études, à l’École du Louvre et au Collège de France qu’il a acquis sa formation d’égyptologue, puis obtenu son doctorat en Sorbonne. Chercheur au CNRS de 1966 à 1968, il devient membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale (1968-1971) puis réintègre le CNRS (1972-2007) où il a terminé sa carrière comme Directeur de recherche de 1ère classe. Durant plus de quarante années ses travaux ont porté sur pratiquement toutes les périodes de la civilisation égyptienne et sur la plupart de ses aspects essentiels. De la protohistoire jusqu'à l'époque romaine, de l'archéologie à la lexicographie et la paléographie, de la religion à l'étude des rouages économiques, il s’est efforcé de comprendre tout ce qui, au-delà des disparités, donne sa cohérence à une civilisation. Cet éventail n'a pas été ouvert pour être le masque d'une inconstance dans la méthode. De la rencontre entre sa formation première de philologue et les exigences de l'archéologie pratiquée en Égypte, lors de son premier séjour, est née la conviction que les deux domaines ne devaient ni ne pouvaient être antinomiques. Leur complémentarité, dans une démarche complice, était évidente et devait donner un habit aux choses, un contenu et une forme aux mots. Cette passion pour les mots dans leur contexte culturel l’a amené à constituer une documentation de plus en plus étendue sur le vocabulaire de l’antique langue égyptienne. De 1980 à 1982, il publie les trois volumes de l’Année Lexicographique Égypte ancienne, devenus des usuels présents dans toutes le bibliothèques spécialisées. Ce travail a été récompensé par une médaille de bronze du CNRS en 1982. Ce sont ces recherches, sans cesse enrichies, qui fondent aujourd’hui l’armature du futur dictionnaire hiéroglyphique. Parce que la recherche doit se communiquer sous peine de s’anémier voire de devenir stérile, Dimitri Meeks, est aujourd’hui responsable du séminaire de lexicographie égyptienne à l’Université Paul-Valéry de Montpellier. Il est désormais le vice-président de la Fondation universitaire. http://recherche.univ-montp3.fr/egyptologie/index.php?page=seminairesspecifiques 7 Particularités du programme et intérêt des versions en uploads/Litterature/ dictionnaire-dimitri-meeks.pdf
Documents similaires

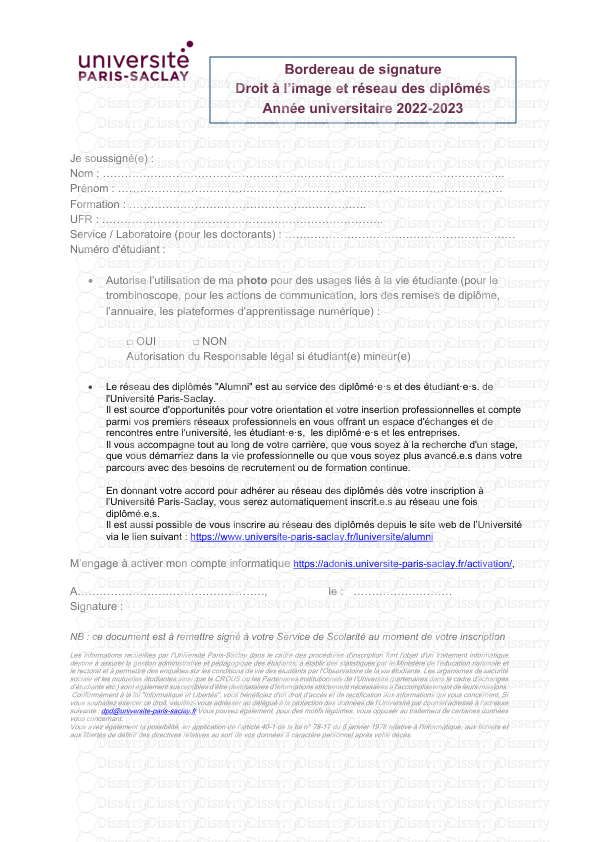








-
44
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 10, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.4138MB


