Marcel Detienne La légende pythagoricienne d'Hélène In: Revue de l'histoire des
Marcel Detienne La légende pythagoricienne d'Hélène In: Revue de l'histoire des religions, tome 152 n°2, 1957. pp. 129-152. Citer ce document / Cite this document : Detienne Marcel. La légende pythagoricienne d'Hélène. In: Revue de l'histoire des religions, tome 152 n°2, 1957. pp. 129-152. doi : 10.3406/rhr.1957.8748 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhr_0035-1423_1957_num_152_2_8748 La légende pythagoricienne d'Hélène Ces quelques pages sont écrites en marge d'une étude où nous nous proposons d'examiner la place et l'importance des poèmes homériques et hésiodiques dans la secte pythagori cienne du ve et du ive siècle. Si l'opinion la plus accréditée sur les rapports entre Homère et Pythagore s'exprime actuel lement par la voix de W. Nestle et de F. Bufïîère, qui se fondent tous deux sur le seul témoignage d'Hiéronyme de Rhodes1, nous espérons montrer que certains témoignages du Пер1 nuOayopsícov d'Aristote et certains recoupements des dialogues platoniciens imposent la conclusion que les Pythag oriciens avaient accueilli les poèmes d'Homère et d'Hésiode dans leur secte dès le ve siècle vraisemblablement. Cette solution originale du long débat entre la Philosophie et la Poésie devait être pleine de conséquences sous de nom breux aspects et, en particulier, pour les conceptions rel igieuses de l'ancien pythagorisme, comme nous essayerons de le montrer. Dès le moment où les Pythagoriciens avaient adopté les poèmes homériques, ils ne pouvaient, on en conviendra, rester indifférents devant les accusations que d'aucuns, et peut-être même certains d'entre eux, lançaient contre Homère ; d'au tant plus que certains épisodes de l'Iliade, comme le combat des dieux, et de l'Odyssée, comme les amours d'Ares et 1) W. Nestle, s. v. Aufklurung, in Reallexicon fur Antike und Chrislentum (1955), c. 941-42, et F. Buffière, Les mythes ď Homère et la pensée grecque, Paris, 1956, p. 520 : tous deux admettent que la réprobation des poètes est un lieu commun du pythagorisme ancien. Relevons simplement la remarquable intuition de Ritter et Preller, Hisloria Philosophiae Graecae, p. 74 (note) qui écrivaient en marge du passage de Porph., V. P., 30 (= Aristoxène) : * Homerum et Hesiodum non repudiebant velut Xenophanes et Heraclitus, sed allegoria inter- pretando ad suam doctrinam aptabant. » 130 REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS d'Aphrodite, devaient vivement offusquer leur conception de la divinité. Aussi leur doit-on probablement les premiers essais d'une apologétique d'Homère dont nous avons quelques échos dans les allégories qui remontent à Théagène de Rhégium ou plutôt aux Pythagoriciens contemporains de ce grammairien1. C'est dans la ligne de cette apologie d'Homère que nous voulons étudier comment les Pythagoriciens réhabilitèrent une héroïne particulièrement compromise et comment, à cet effet, ils entreprirent de refaire sa légende. Outre les passages impies ou scabreux dont, seule, l'exégèse allégorique pouvait dévoiler le sens véritable, il restait dans les poèmes homériques bien des personnages que la secte pythagoricienne devait impitoyablement censurer : à leur tête figurait Hélène, que ses liens de parenté avec les Dioscures, fort honorés dans les cercles pythagoriciens2, devait signaler à leur attention, mais dont les aventures amoureuses méri taient, sans aucun doute, « la mise à l'index ». En effet, Hélène, la plus belle des femmes que célébrèrent à l'envi les poètes comme Homère, les sophistes comme Gorgias et les orateurs comme Isocrate, restait par la séduc tion de ses charmes, un danger que les Pythagoriciens ne pouvaient méconnaître. La femme fatale, pour laquelle la guerre de Troie avait eu lieu, demeurait un obstacle très grave à la lecture des poèmes d'Homère : aussi leur ingéniosité s'est-elle efforcée de la racheter par les artifices d'un symbol isme subtil. Eustathe, qui écrivit au xne siècle le commentaire per pétuel d'Homère, nous a souvent transmis des renseignements précieux ; et c'est ainsi qu'en marge du vers 122 du chant IV 1) C'est la solution à laquelle nous nous sommes arrêté et que nous justi fierons dans le travail dont il a été question. 2) On verra P. Boyancé, Culte des muses, p. 140 ss., et F. Cumont, Recherches . sur le symbolisme funéraire chez les Romains, chap. I, passim. LA LÉGENDE PYTHAGORICIENNE D'HÉLÈNE 131 où Hélène, dit Homère, « 5^Xu0ev 'Артель хРисг/)^аХ(*тср sixuïa », Eustathe nous apprend : « ' ApxefxiSt, Se хриа7)Хахатср tíjv 'EXéVrçv ó 7Т017)ту)с ebcaÇei Sià ttjv хата <к5|л.а çutjv • IvrsuGev Se Xa6óvT£c ápx^v ol ■ |i.s6' "O[X7)pov Sbà то eíc, SsXyjvtjv аХХт)уор£ьа0а1 tyjv "ApT£fziv, (TsXvjvaíav áv0pco7iov tvjv 'EXevtjv euXácravTO wç èx тои хата cteXÝjvtjv u TC£crou(7av, aôôtç S'avco ариау^аь aÙTTjv sfJLuÔsuaavTO èustSàv ai той Atoç 7)vóa07]7av ^ouXat »х. « Le poète compare Hélène à l'Artémis « à la quenouille d'or », à cause de la pousse de son corps. Prenant leur point de départ dans cette comparaison, les auteurs postérieurs à Homère, parce qu'ils faisaient d'Artémis la lune par allégorie, imaginèrent qu'Hélène était un être sélénite, tombé du monde lunaire. Mais, racontaient-ils, elle y avait à nouveau été enlevée lorsque, par elle, les volontés de Zeus se furent accomplies. » L'imprécision d'une appellation aussi banale que ot (АЕ0' "O[AY)pov2 ne nous apporte aucune indication sur les auteurs qui avaient inventé cette histoire. Mais le scholiaste dont Eustathe s'inspire certainement nous fournit deux indications : c'est d'abord que ces ot [j.£0' "O[A7)pov prenaient leur point de départ dans la compar aison d'Homère (evteuOev Xa6ovT£ç àpxV)» c'est ensuite qu'ils utilisaient l'allégorie ou peut-être même la pratiquaient (Siol то eîç a£X7)V7jv áXXy)Yop£U70ai tyjv "Артгуцу) ; et l'on songe tout naturellement à traduire oî [X£0' "Opjpov par « les commentateurs d'Homère », comme le faisait déjà F. Chapou- thier3 ; il est bien difficile de songer à des poètes... Mais les éléments de cette étrange histoire vont nous •1) Eust., p. 1488, 30 ss. 2) A. Severyns, Le cycle épique dans Vécole ďAristarque, p. 59 ss. et passim, a montré qu'en certains cas, oi fxsô' "0[i7jpov n'était qu'une forme réduite de oi [леб' "0(jO]pov 7coi7jTai et une forme décadente du fameux ol vewTepoi. Mais une expression aussi vague ne peut toujours donner des renseignements précis : M. A. Severyns a d'ailleurs étudié le déclin et la disparition de cette terminol ogie dans un grand nombre de cas. Nous croirions volontiers que la présente notice transmise par Eustathe ne donnait plus à la formule oî (леб' "O[X7)pov le sens qu'elle avait eu. 3) Chapouthier, Les Dioscures au service ďune déesse, p. 140-141. De même J. Carcopino, La Basilique pythagoricienne de la Porte Majeure, Paris, 1927, p. 356. 132 REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS révéler son origine. Car l'histoire d'une femme tombée de la lune ne peut avoir été inventée que par des défenseurs de la pluralité des mondes, et c'est une doctrine orphico-pythago- ricienne fort bien attestée : « Héraclide (le Pontique) et les Pythagoriciens disent que chacune des étoiles est un monde comprenant une terre entourée d'éther, et que toutes sont suspendues dans l'éther infini1. » L'on a, depuis longtemps, reconnu que Platon dans le Timée2 s'inspirait de ces philo sophes qui « xofffjumoioCaiv èxaaxov t&v acrrépcov »3. Mais les Pythagoriciens précisaient : ces astres et, en particulier la lune, sont habités. Et Aétius nous le dit : « Certains des Pythagoriciens, au nombre desquels Philolaos, racontent que la lune a l'apparence d'une terre parce qu'elle est habitée sur sa surface comme notre terre, mais par des plantes et des êtres vivants plus grands et plus beaux4. » Les Pythagoriciens paraissent avoir été seuls à croire que des êtres humains vivaient sur la lune : nous en trouvons la preuve dans l'explication surprenante que Castor de Rhodes avait imaginée du port des lunules sur les chaussures : « C'est un symbole de la légende que la lune est habitée, et cela nous prouve que, après la mort, les âmes auront de nouveau la lune sous les pieds (sic)5. » 1) Kern, Orphicorum fragmenta, 22. L'on sait que Petron (ap. Plut., De def. orac, 422 b, d), un des anciens Pythagoriciens, comptait 183 mondes arrangés en triangle. 2) Platon, Timèe, 41 e, 42 b, 42 d. 3) Diels, Doxographi graeci, 343, 11. Cf. P. Capelle, De luna stellis lacleo orbe animarum sedibus, Diss., Halle, 1917, p. 2-6. 4) AéTius, II, 30, 1 = Diels, FVS7, 44 A 20. Philolaos ajoutait : « Les êtres qui y vivent sont 15 fois plus forts, etc. »; or on retrouve la même proportion de grandeur chez Hérodore d'Héraclée, cité par Athénée, p. 57 F, dans un pas sage où Athénée veut réfuter Néoclès de Crotone. Mais l'obscurité de ce pass'age du Banquet des Sophistes peut s'expliquer en supposant qu'Athénée donne au texte d'Hérodore un léger gauchissement : Hérodore, comme le pensait Diels (note in p. 404, 1. 12), rapportait une doctrine tout à fait semblable à celle de Philolaos. Cf. Jacoby, s. v. Herodoros in R.-E. (1912), с 983, qui a fait le même rapprochement avec les croyances pythagoriciennes. Ajoutons que le trait des hommes « plus grands et plus beaux » est un thème fréquent dans les utopies comme celles de Iamboulos et Théopompe {cf. Elien, III, 18, 2, et Diodore, II, 56, 2). Hérodore nous aurait-il gardé un épisode de ces légendes dont Antonius Diogène devait écrire la somme près de sept uploads/Litterature/ la-le-gende-pythagoricienne-d-x27-hele-ne.pdf
Documents similaires

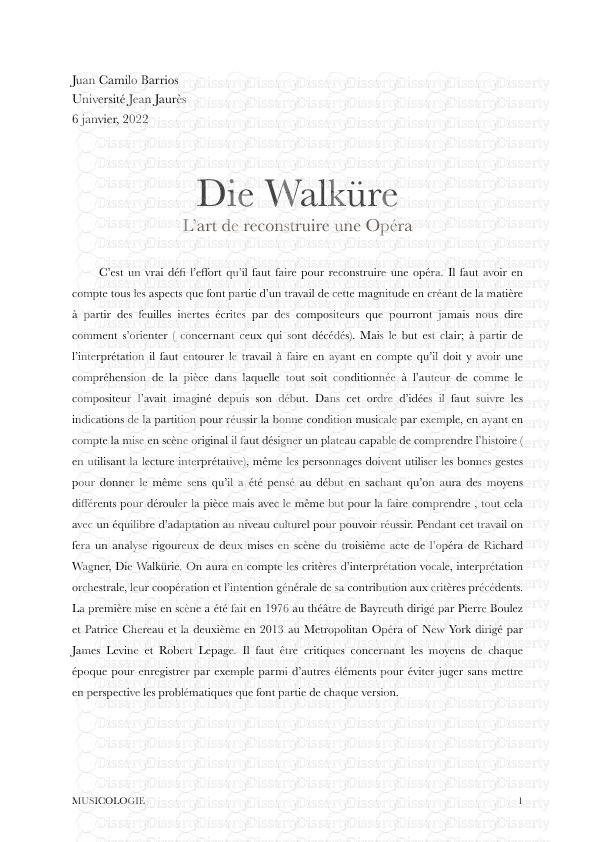








-
157
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 07, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.6876MB


