collection eupalinos série archi tecture et urbanisme Bruno Zevi Le langage mo
collection eupalinos série archi tecture et urbanisme Bruno Zevi Le langage moderne de l’archi tecture Pour une approche anticlassique Traduit de l’italien et présenté par Marie Bels Éditions Parenthèses www.editionsparentheses.com / Bruno Zevi / Le langage moderne de l’architecture / ISBN 978-2-86364-671-7 Le langage moderne de l’architecture Préface Engagement politique et modernité par Marie Bels Bruno Zevi n’est pas un théoricien comme les autres, un historien de l’archi tecture comme ses contemporains l’anglais John Summerson (1904-1992), l’allemand Nikolaus Pevsner (1902-1993) ou l’italien Manfredo Tafuri (1935-1994). C’est un homme de l’action politique, qui « juge la politique par une lecture urbanistique et architectonique 1 » et l’essai présenté ici est tout entier consacré à la défense d’une « archi tecture démocratique ». « En politique, dans l’éthique, dans les comportements, dans l’art et, naturellement, en archi tecture, je suis contre le fascisme. En cela je n’entends pas seulement Mussolini, Hitler et Staline, mais tous les absolutismes et les totalitarismes 2 » écrit-il quelques années après la publi- cation, en 1973, du Langage moderne de l’archi tecture. L’ Italie traverse alors les terribles Années de Plomb tandis que le postmodernisme triomphe sur la scène internationale. Bruno Zevi a cinquante‑cinq ans ; cela fait plus de trente ans qu’il consacre tous ses écrits, son enseignement, ses recherches historiques et son œuvre critique à la défense de cette conception politique de l’archi tecture. « L’archi tecture a toujours une matrice politique. […] Il y a un rapport étroit entre l’espace, l’usage et la signification, et c’est ce que nous pouvons appeler une responsive archi tecture. Nous devons dénoncer le fait que de nombreux architectes ont perdu la conscience de ce rapport et ne croient plus dans l’engagement social ; par conséquent leurs produits sont autonomes, ils ne correspondent à rien 3 ». C’est la raison pour laquelle Zevi n’historicise pas les théories de l’archi tecture ou les préférences architecturales à travers les différentes époques de l’histoire. Il définit et historicise uniquement ce qu’il considère comme le paramètre de jugement fondamental de l’archi tecture : l’espace, « l’espace comme protagoniste de l’archi tecture, source www.editionsparentheses.com / Bruno Zevi / Le langage moderne de l’architecture / ISBN 978-2-86364-671-7 8 9 9 Nicolas Bruno Jacquet, op. cit., p. 14. 10 Nikolaus Pevsner quitte l’Allemagne pour la Grande-Bretagne en 1934 ; Walter Curt Behrendt, émigre aux États-Unis en 1934, où il continua à travailler dans les domaines de l’urbanisme et du logement ; Siegfried Giedon est invité par Walter Gropius à la Harvard University en 1938-1939 pour donner la série de conférences qui donneront naissance à son ouvrage le plus célèbre, Space, Time and Architecture : the Growth of a New Tradition, publié aux États-Unis en 1941. 1 « Una politica culturale per la sinistra europea » [Une politique culturelle pour la gauche euro- péenne], éditorial no 320 de L’architettura, cronache e storia, juin 1982, in Bruno Zevi, Sterzate architettoniche, Conflitti e polemiche degli anni settanta-novanta, Bari, Dedalo, 1992, p. 309. 2 Bruno Zevi, « Il fascismo in architettura » [Le fascisme en archi tecture], in Dichotomy, vol. 3, no 1, automne 1979, sous le titre « On Architectural Criticism and Its Diseases », que nous avons traduit de sa version italienne, parue dans Bruno Zevi, Zevi su Zevi, Venise, Magma, 1993, pp. 144-147. 3 « Per un’architettura rispondente » [Pour une archi tecture ouverte], éditorial no 373 de L’architettura, cronache e storia, novembre 1986, in Bruno Zevi, Sterzate architettoniche, op. cit., p. 208. Au début de son article, Bruno Zevi indique que l’expression anglaise a responsive archi tecture (l’adjectif responsive signifie : sensible, ouvert, enthousiaste, en réponse à) vient d’être utilisée par l’architecte, historien et critique anglais Peter Blundell Jones, dans une conférence qui cherche à faire un bilan de la situation architecturale contemporaine. 4 Bruno Zevi, Zevi su Zevi, op. cit., p. 47. 5 Bruno Zevi, « Il fascismo in architettura », op. cit. 6 Nicolas Bruno Jacquet, Le langage hypermoderne de l’archi tecture, Marseille, Parenthèses, 2015, pp. 64 à 66. 7 Bruno Zevi, « Il fascismo in architettura », op. cit. 8 « Modernità e spirito del tempo » [Modernité et esprit du temps], éditorial no 316 de L’architettura, cronache e storia, février 1982, in Bruno Zevi, Sterzate architettoniche, op. cit., p. 120. est une pratique et une poétique du changement [elle] est liée à l’expé- rience vécue (elle) est fondée sur la conscience d’un monde qui change. Il n’y a pas une forme définitive de la modernité, mais seulement la défini- tion toujours renouvelée d’une modernité qui prend forme ». Être moderne, c’est aussi hériter des valeurs d’émancipa- tion fondées par les avant-gardes, et entamer un processus d’appropria- tion. La problématique de la modernité est donc celle de la transmission, de l’engagement des générations suivantes à accepter et se confronter à cet héritage 9. C’est la valeur de cet héritage que Bruno Zevi défend et cherche à transmettre, et se voit donc obligé de définir — et paradoxalement de codifier — face à l’hégémonie du Style International et aux régressions du post-modernisme. Jeune étudiant d’archi tecture, Bruno Zevi a dû fuir l’ Italie en 1939 à la suite de la promulgation des lois raciales. Il poursuit alors ses études d’abord à Londres (à l’Association School of Architecture), puis aux États-Unis (à la School of Architecture de la Columbia University de New York et à la Graduate School of Design (gsd), de la Harvard University de Cambridge, dans le Master of Architecture dirigé par Walter Gropius). C’est ainsi que sa formation de jeunesse empreinte de l’approche critique de Benedetto Croce et Lionello Venturi réagit au contact d’autres orien- tations culturelles, parmi lesquelles celle de l’histoire de l’art germaniste, diffusée dans le monde anglo-saxon par Pevsner, Behrendt et Giedon 10, et celle d’un argumentaire pragmatique proprement américain porté, dans ces années‑là, par les figures de l’écrivain philosophe, historien de la tech- nologie et critique d’archi tecture Lewis Mumford, et de l’architecte Franck Lloyd Wright. Promu lauréat de la gsd en 1942 et déjà fortement impli- qué politiquement pour la libération de l’ Italie, Bruno Zevi rentre en Europe en 1943, d’abord à Londres, où il en profite pour continuer ses recherches à la bibliothèque du Riba, puis en Italie en juillet 1944. Il a de joie et matrice de comportements individuels et sociaux 4 ». De la même façon, il va systématiquement à l’encontre d’une conception linéaire de l’histoire et du progrès. Il n’y a pas d’origine mythique, ou supé- rieure, dans laquelle puiser une légitimité, ni même de mouvement histo- rique auquel se rattacher. « De ce point de vue, les “vérités absolues” des Lumières et les dogmes marxistes sont fascistes. [De même que] les intel- lectuels “illuminés” peuvent être fascistes s’ils n’admettent pas d’ombres. Le fascisme est donc un mal complexe qui s’insinue, qui s’infiltre partout, et que nous devons extirper tous les jours à l’intérieur de nous‑mêmes 5 ». La modernité, en archi tecture, est la lutte contre ce mal, c’est‑à‑dire contre toutes les expressions du pouvoir qui « tendent à opprimer l’individu, à nier la diversité et à exclure les exceptions. » La modernité est donc partout en puissance, et en tous les temps. Sa nature intemporelle vient de ce qu’elle est fondamentalement une force d’émancipation conduite par des individus en quête de liberté 6. « Tous les artistes vrais et originaux sont “modernes” ; leurs messages sont toujours des transgressions des règles 7 ». Aussi, aucune forme de moder- nité ne peut prétendre être le commencement ou l’aboutissement de toute l’Histoire, car « la modernité ne fixe pas de modèles, elle est toujours en train de chercher 8 ». Et si la modernité s’incarne effectivement dans la volonté de renouvellement, cela ne signifie pas qu’elle doive s’incarner systématiquement dans la seule rupture révolutionnaire. « La modernité www.editionsparentheses.com / Bruno Zevi / Le langage moderne de l’architecture / ISBN 978-2-86364-671-7 10 11 13 Verso un’architettura organica, Saggio sullo sviluppo del pensiero architettonico negli ultimi cinquant’anni [Vers une archi tecture organique, Essai sur le développement de la pensée architec- turale durant les cinquante dernières années] n’a jamais été traduit en français ; l’ouvrage a été publié aux éditions Einaudi, à Turin, en 1945, mais écrit à Londres en 1944, Zevi l’avait d’abord proposé dans sa version anglaise : Towards an Organic Architecture, aux éditions Faber & Faber qui l’avait accepté mais ne l’éditeront finalement qu’en 1950. 14 Roberto Dulio, Introduzione a Bruno Zevi, Rome, 2008, p. 52 sq. 15 Scuola di architettura organica. Programma e descrizione dei corsi per l’anno 1945, Rome, 1945. Cité par Roberto Dulio, op. cit., p. 53. 16 Bruno Zevi, « All’Ordine degli architetti di Roma », in Metron, no 2, septembre 1945, pp. 73-74. Cité par Roberto Dulio, op. cit., p. 56. 11 « Ultimo colloquio con Ugo La Malfa » [Dernier entretien avec Ugo La Malfa], éditorial no 284 de L’architettura, cronache e storia, juin 1979, in Bruno Zevi, Sterzate architettoniche, op. cit., p. 303. 12 Apprendre à voir l’archi tecture, Paris, uploads/Litterature/ langage-moderne-de-l-x27-architecture.pdf
Documents similaires
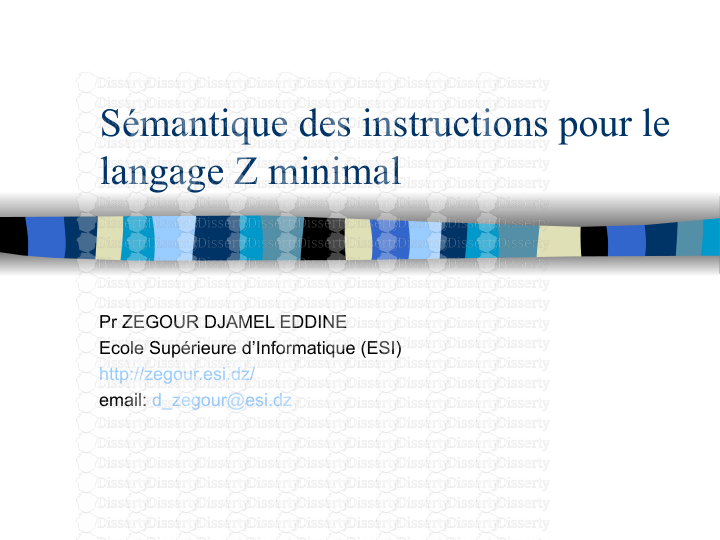









-
72
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 04, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.0374MB


