Sous la direction de Marcel Fournier coordonnateur du Fichier Origine Les origi
Sous la direction de Marcel Fournier coordonnateur du Fichier Origine Les origines familiales des pionniers du Québec ancien (1621 – 1865) «Extrait du livre publié 2001 avec une mise à jour en 2005» Québec Fédération québécoise des sociétés de généalogie Paris Fédération Française de Généalogie 2 L’immigration européenne au Canada français des débuts à 1865 Robert Larin, Ph. D. Tous les pauvres gens feraient bien mieux ici qu’en France pourvu qu’ils ne fussent pas paresseux ; ils ne manqueraient pas ici d’emploi, et ne pourraient pas dire ce qu’ils disent en France, qu’ils sont obligés de chercher leur vie, parce qu’ils ne trouvent personne qui leur veuille donner de la besogne ; en un mot, il ne faut personne ici, tant homme que femme, qui ne soit propre à mettre la main à l’œuvre, à moins que d’être bien riche. Pierre Boucher, 1664 1 Il est assez difficile de rendre un compte absolument exact de l’émigration européenne vers le Canada puisque chaque migrant n’a pas toujours été inscrit dans un document d’archive permettant de bien l’identifier. Les compilations des historiens oublient forcément un certain nombre de cas et s’appuient assez souvent sur des estimations. L’interprétation des données brutes reste par ailleurs assez instinctive. Le portrait que l’on peut tenter d’ébaucher ici ne sera, en somme, qu’une image virtuelle encore appelée à se transformer au rythme des nouvelles recherches et des réinterprétations. On se souviendra, non sans un certain sourire, qu’en 1859, l’historien Rameau de Saint-Père arrivait à la conclusion qu’à peine « quelque chose comme 10 000 émigrants » étaient passés de France au Canada avant 17602 alors que le tableau suivant fait aujourd’hui tripler ce nombre. Tableau I Origine et composition de l’immigration brute canadienne antérieure à 17603 Sexe France Europe Nouvelle- Angleterre Acadie Amérindiens intégrés Noirs Total Soldats m >15 508 > 361 ≈ 16 000 Travailleurs engagés m ≈ 5 000 > 311 ≈ 5 300 Enfants de moins de 15 ans m f ≈ 600 ≈ 600 Femmes célibataires f 2 105 > 71 ≈ 2 200 Épouses f 250 250 Réfugiés m f > 45 ≈ 1 900 ≈ 1 900 Captifs, déportés, prisonniers m f ≈ 650 > 113 ≈ 1000 ≈ 1 800 Religieux m f 710 17 727 Nobles, fonctionnaires, officiers m ≈ 2 000 > 8 ≈ 2 000 Marchands, négociants m ≈ 2 500 > 24 ≈ 2 500 Esclaves m f ≈ 1 578 ≈ 455 ≈ 2 000 Autres m f ≈ 200 ≈ 300 ≈ 500 TOTAL m f ≈ 30 00 ≈ 1 000 ≈ 1000 ≈ 2 100 ≈ 2 000 ≈ 500 ≈ 36 000 Légende < moins de > plus de ≈ environ 1 Pierre BOUCHER, Histoire véritable et naturelle des mœurs et productions de la Nouvelle-France vulgairement dite le Canada, Société historique de Boucherville, 1964, p. 162-163. 2 Edme RAMEAU de SAINT-PÈRE, La France aux colonies. Études de la race française hors de l’Europe, Paris, A. Jouby, 1859, deuxième partie, p. 94. 3 Robert LARIN, Brève histoire du peuplement européen en Nouvelle-France, Septentrion, 2000, p. 71-87, tableau, p. 82. 3 Les figures I et II veulent souligner la diversité du flux migratoire : le peuplement du Canada de la Nouvelle-France ne fut pas exclusivement d’origine française et se composait de soldats, de travailleurs, de filles à marier, de prisonniers, de captifs, de réfugiés, de nobles, de bourgeois, de religieux, d’esclaves et même d’Amérindiens que l’on tentait d’assimiler dans la société en formation. Figure I Origine géographique de l’immigration canadienne avant 17604 Figure II Statut socioprofessionnel des immi- grants d’origine européenne avant 17605 France 82 % Europe, 3 % (hors France) Nouvelle- Angleterre 3 % Acadie, 6 % Amérindiens, 6 % Négro-africains 1 % 53 % Soldats 18 % Travailleurs 20 % Autres 7 % 3 % Femmes célibataires Épouses et enfants Il faut bien saisir, d’autre part, la distinction entre l’immigration totale, celle présentée au tableau I, et l’immigration fondatrice, c’est-à-dire celle ayant donné une descendance disséminée dans la population francophone actuelle. Nos ancêtres ne formaient en fait qu’une minorité dans l’ensemble du flux migratoire. Figure III L’immigration fondatrice au sein de l’émigration française vers le Canada avant 17606 Figure IV L’immigration française au Canada sous le régime français7 22 % Nos ancêtres 8 % Sans descendance 17 % Restés célibataires 10 % Jamais arrivés au Canada 43 % Repartis 48 % Retournés en France 19 % Restés célibataires 9 % Mariés mais sans descendance connue 24 % Ont laissé une descendance 4 Selon les données du tableau I. 5 Selon les 31 000 immigrants d’origine française et européenne présentés au tableau I. 6 Robert LARIN, Brève histoire du peuplement européen en Nouvelle-France, Septentrion, 2000, p. 116. 7 Selon les données de la figure III sur la base de l’immigration d’origine française effectivement arrivée au Canada. 4 Il faut enfin distinguer l’émigration partie de France et l’immigration effectivement arrivée au Canada (figures III et IV). Dans le premier cas, environ 10 % des émigrants embarqués en France avant 1760 ne sont jamais parvenus à destination étant décédés en cours de route, ou encore, leur navire s’étant égaré, ou ayant été victime de la marine anglaise, des pirates, des mauvais vents ou des icebergs. Pas moins de 43 % du même contingent débarqua à Québec pour en repartir après au moins une année passée au Canada, alors que 17 % s’établit en permanence mais resta célibataire et que 8 % se maria sans laisser aucune descendance connue. À peine 6 500 pionniers (22 %) d’origine française, dont seulement 1500 femmes, ont laissé une descendance. Ce sont nos ancêtres. C’est donc la descendance issue d’un groupe assez restreint de pionniers, et non point l’abondance de l’immigration, qui a véritablement colonisé le Canada. La France n’a jamais eu de véritable politique colonisatrice et le Canada ne vit guère arriver que 250 couples ou familles comptant à peine 600 enfants. La moitié des Français arrivés avant 1760 étaient des soldats ; au moins un sur six était un travailleur engagé. Les autres étaient des nobles (ou des aspirants à la noblesse) de plume ou d’épée, des prêtres et des religieuses, des esclaves, des prisonniers ou des réfugiés, des pêcheurs attirés par l’abondance des ressources poissonneuses, des ouvriers spécialisés à qui on offrait des salaires alléchants, des artisans à la recherche d’une clientèle captive, ou encore des marchands venant soit vendre leur camelote soit s’enrichir dans le commerce pelletier. On voyait plus rarement arriver des femmes et parfois des enfants. En somme, le Canada était beaucoup moins une colonie de peuplement que le foyer d’une importante immigration militaire et professionnelle, essentiellement masculine et célibataire. De façon générale, ces jeunes arrivants ne venaient nullement coloniser le Canada, mais répondaient aux circonstances appelant des travailleurs et des militaires dans cette colonie vers laquelle ils s’étaient embarqués avec la ferme intention de rentrer chez eux après quelques années avec, autant que possible, du moins espérait-on, un petit pécule. Quarante huit pour cent des Français arrivés au Canada avant 1760 finiront ainsi par en repartir après y avoir vécu au moins un an. Assez peu nombreux, les véritables immigrants, c’est-à-dire ceux qui arrivaient au Canada avec déjà la volonté bien arrêtée de s’y installer définitivement, étaient souvent… des immigrantes. Les épouses accompagnant leur mari, les fillettes venues avec leurs parents, les religieuses ainsi que les femmes célibataires venant fonder une famille arrivaient au Canada pour y passer le reste de leur vie. Dès le départ, et contrairement à celle des hommes, l’immigration féminine se voulait définitive. Mais le cours des choses ne suit pas nécessairement l’itinéraire tracé au départ et les Français du Canada n’étaient pas insensibles aux avantages qu’offrait la vie dans cette colonie. C’est pourquoi la moitié de ceux que le chômage et les circonstances liées au contexte socioéconomique avaient conduits dans cette colonie, et qui y avaient vécu un certain temps, finissaient par décider de s’y établir définitivement. Sage décision ! Le peuplement du Canada s’est donc ainsi réalisé, sous le régime français, à partir d’une mince immigration souvent féminine, d’une importante mobilité de travail masculine qui, une fois sur deux, finissait par se transformer en immigration définitive et grâce ensuite, et surtout, à la descendance nombreuse de ceux et celles qui y fondèrent une famille. Il faudrait donc se défaire du mythe de la France envoyant des colons immigrant en Nouvelle- France. Le Canada n’était pas pour la métropole une colonie de peuplement mais une terre de mission et surtout un réservoir pelletier, poissonnier et baleinier. Le roi y voyait un territoire à évangéliser et surtout à développer (économiquement) et donc à défendre. La France voulait garder près d’elle tous ses ressortissants, même les huguenots qu’elle jugeait pourtant indésirables, et n’a donc jamais doté ses colonies d’une véritable politique de colonisation. Elle envoyait certes au Canada de très nombreux soldats et des fonctionnaires, mais elle n’a jamais financé un envoi massif et continu de colons, à l’exception, peut-être, des prêtres, religieux et religieuses voyageant gratuitement sur les uploads/Litterature/ les-origines-familiales-des-pionniers-du-quebec-ancien.pdf
Documents similaires



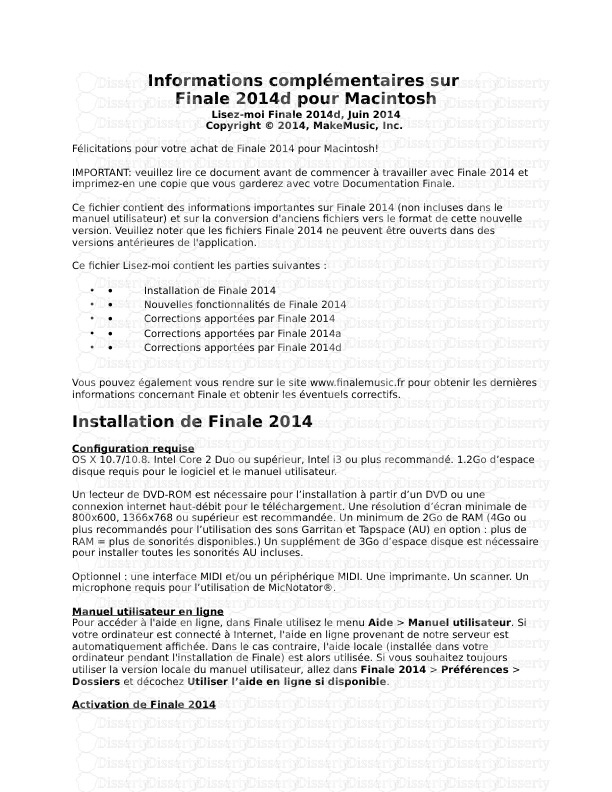






-
27
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 02, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2915MB


