1 Ligne de fuite néo-picaresque dans l’autofiction hispano-américaine : Arenas,
1 Ligne de fuite néo-picaresque dans l’autofiction hispano-américaine : Arenas, Copi, Lemebel, Vallejo Lionel Souquet Université de Bretagne Occidentale – Brest lionelsouquet@hotmail.com El personaje narrador quien, desde el prólogo, reivindica su doble función narradora y actancial, es hijo de sus obras mucho más que de sus padres de quienes no hereda ni el nombre ni siquiera el triste destino. Milagros Ezquerro (à propos du personnage de Lazarillo)1 Dans son incontournable préface sur la picaresque, Maurice Molho (1967) affirme - comme Marcel Bataillon2 - que le roman de gueuserie est mort et ne résuscitera pas, et s’inquiète même d’une récupération systématique et abusive de la notion de roman picaresque. Pour lui, La vida del Buscón (1626) de Quevedo et Moll Flanders (1722) de Daniel De Foe sont les deux derniers romans d’un genre dont la brève existence avait commencée en 1554 avec la publication de l’œuvre anonyme Vida de Lararillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades et avait atteint son apogée, en 1599, avec Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. En fait, Molho limite pratiquement la « vraie » picaresque à ces quatre œuvres : On ne saurait donc s’inquiéter trop de l’emploi abusif de ce terme, qu’on accole, comme une étiquette qui dispenserait de réfléchir, à nombre d’œuvres anciennes, modernes ou contemporaines, sous prétexte que le personnage principal est un escroc, un bâtard, un aventurier sans scrupules, une victime de l’ordre social, un écœuré agressif et protestataire, un être énigmatique errant de par le monde au gré des circonstances ou de sa fantaisie, etc.3 Le roman picaresque pose – avant tout, peut-être – la question du réalisme en littérature. De nombreux théoriciens s’accordent à dire que le genre est réaliste, et même naturaliste, dans la description des aspects les moins plaisants d’une réalité (notamment sociale) jamais idéalisée et souvent dévoilée sur le mode de la désillusion. Le grand Benito Pérez Galdós, lui-même, pensait que le roman naturaliste n’était autre que le fruit d’une longue transformation (par déterritorialisation) du roman picaresque espagnol : […] en el paso por Albión habíanle arrebatado la socarronería española, que fácilmente convirtieron en humour inglés las manos hábiles de Fielding, Dickens y Tackeray, y despojado de aquella característica elemental, el Naturalismo cambió de fisonomía en manos francesas : lo que perdió en gracia y donosura, lo ganó en fuerza analítica y en extensión, aplicándose a 1 Milagros Ezquerro, Leerescribir, México / París, RILMA 2 / ADEHL, 2008, p. 75. Un grand merci à Milagros Ezquerro dont les écrits et les conseils m’ont éclairé depuis qu’elle fut membre de mon jury de thèse sur Manuel Puig, en 1996. Merci aussi à cette « chercheuse-araignée » pour avoir su tisser et nouer autant de liens entre les membres du SAL. Le texte qui suit est, en grande partie, le fruit direct et indirect de ces rencontres. 2 Voir Marcel Bataillon, Le roman picaresque, Paris, La Renaissance du livre, 1931. 3 Maurice Molho, « Introduction à la pensée picaresque », in Romans picaresques espagnols, Bibliothèque de la Pléiade, NRF Gallimard, 1968, p. CXXXIX. 2 estados psicológicos que no encajan fácilmente en la forma picaresca.4 Edmond Cros estime cependant que l’on ne peut pas parler de réalisme à propos de la littérature picaresque car tous les personnages et les situations sont le fruit d’une collecte dans des sources littéraires et surtout folkloriques (partiellement orales).5 Pour Molho, les choses sont plus ambiguës : la picaresque est ancrée dans une réalité quotidienne qu’elle présente de façon narquoise, sous une forme stylisée (les aspects sordides deviennent burlesques) qui, par effet de contraste, met en évidence le caractère idéaliste et irréel de l’univers des romans de chevalerie et des œuvres pastorales en vogue à l’aube du Siècle d’Or : « Aussi l’univers picaresque n’est-il pas moins mythique que l’autre, qu’il ne détruit pas, mais auquel il oppose, à toutes fins utiles, une mythologie inverse. »6 Modèle de l’autobiographie fictive, le « vrai » roman picaresque doit aussi, pour Molho7, répondre obligatoirement aux critères suivants : - Le pícaro (le gueux) s’exprime toujours à la première personne : « Son « je » est celui d’un homme dont on ne parlerait pas s’il n’en parlait lui-même. » - Son lignage honteux prédétermine son comportement moral. - « Incarnant l’antithèse d’honneur ou d’honnêteté, il est moins qu’un roturier : un déchet social, objet du mépris de tous […] » Refusant de travailler, il dupe et vole. - « Il se sent néanmoins appartenir à l’humanité, en dépit de son infrahumanité ancestrale – ce qui l’amène, dans sa lucidité dont il ne se départ jamais, à mettre en question sa personne et son destin, et le code moral ou social qui régit la conduite de ses supérieurs et contempteurs. » Pour Molho, le personnage du pícaro est tout simplement incompatible avec la notion d’égalité que la philosophie des lumières impose. En outre, « Le pícaro garde le sentiment de sa transcendance, qui le conduit à persévérer dans sa misère (celle de l’homme) sans jamais céder au « divertissement ». »8, ce qui l’oppose fondamentalement au libertin et à son goût du bonheur, en rupture avec la notion de péché originel. Dans leur Histoire de la littérature espagnole9 et presque trente ans après Molho, Jacques Beyrie et Robert Jammes définissent le roman dit « picaresque » avec toute la prudence que laissent présager les guillements dont ils l’entourent et s’empressent de démonter aussitôt la définition qu’ils avaient proposée : « […] c’est un « concept flou », qui s’évanouit dès qu’on veut le confronter à une analyse rigoureuse : on ne peut l’admettre que si l’on admet en même temps que chacune des œuvres concernées est une exception à cette définition, ce qui est pour le moins paradoxal. »10 Dans un article assez anticonformiste et même « révisionniste », comme il le qualifie lui-même, Manuel Montoya propose une audacieuse remise en question de la notion de genre picaresque. Selon les théoriciens qui ont tenté de délimiter le genre et d’en établir la poétique, 4 Benito Pérez Galdós, « Prólogo », in Leopoldo Alas « Clarín », La Regenta, edición de Gonzalo Sobejano, Madrid, Clásicos Castalia, n° 110, 1987, pp. 79-92 (je cite la page 84). 5 Edmond Cros, « Lazarillo de Tormes, Structure et composition » (interview), in M. Boeglin, E. Cros, V. Parello, A. Rey, Aux origines du roman : la littérature picaresque espagnole, Université Ouverte des Humanités, METICE - Université Paul Valéry – Montpellier III, 2008. Consulté en ligne le 14/03/09 : http://meticebeta.univ- montp3.fr/litteraturepicaresque/index.html 6 Molho, op. cit., p. XI. 7 Molho, op. cit., p. CXL. (C’est moi qui souligne.) 8 Id., p. CXLII. 9 Jacques Beyrie et Robert Jammes, « Le roman dit "picaresque" », in Histoire de la littérature espagnole, Paris, Presses Universitaires de France, 1994, p. 139-147 (et 133-134, pour une présentation du Buscón). 10 Ibid., p. 139-140. 3 la catégorie est tantôt trop réduite (trois ou quatre œuvres suffisent-elles à constituer un genre ?), tantôt si étendue que l’on ne distingue plus aucun dénominateur commun. Montoya montre aussi, à travers la diversité des influences antiques et médiévales, que le Lazarillo ne peut être considéré comme l’œuvre fondatrice du genre. Pour Montoya, le « roman picaresque » (les guillemets sont de lui) serait, en fait, une parodie des romans apologétiques et des autobiographies de saints comme celles d’Augustin ou de sainte Thérèse : Si le roman picaresque devait exister, ce ne serait qu’en fonction de cette immense liberté qu’il permet et qu’il introduit dans la fiction espagnole, européenne et mondiale. La liberté absolue revendiquée et subie par le pícaro […] traduit l’immense liberté d’écriture, de choix de fictions que s’octroie un auteur enfin libéré des canons esthétiques ou idéologiques plus ou moins pesants, plus ou moins contraignants. Enfermer cette liberté affirmée et revendiquée dans des schémas ne serait-ce pas remettre en question l’existence même de ce « genre », la nier à trop vouloir la définir ?11 Les faux pícaros De nombreux critiques estiment que le genre a survécu au-delà du Siècle d’Or, restant même, surtout dans l’aire culturelle hispanique, un modèle vivant. L’œuvre la plus importante de Diego de Torres Villarroel (1694-1770), Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del doctor don Diego de Torres y Villarroel (1743), serait un exemple notoire d’une adaptation du genre dans l’Espagne des Lumières. Il ne s’agit pas d’une œuvre de fiction mais d’une autobiographie (référentielle) écrite sur le mode picaresque. Pour Christopher Domínguez-Michael12, Villarroel – imitateur timide de Quevedo – serait le dernier des auteurs picaresques et le premier des autobiographes bourgeois. Issu d’une éminente famille créole, le dominicain mexicain Fray Servando Teresa de Mier y Noriega Guerra (1763-1827) avait suscité le courroux de la couronne espagnole en prononçant, en 1794, un sermon qui dédiabolisait les amérindiens et enlevait toute légitimité à la présence coloniale espagnole. Consciente de la portée politique du message de Mier, l’Inquisition le condamne à dix ans de prison, le déporte en Espagne et le persécute jusqu’en 1822. Le reste de la vie « picaresque » de cet étonnant personnage uploads/Litterature/ ne-opicaresque-et-autofiction.pdf
Documents similaires


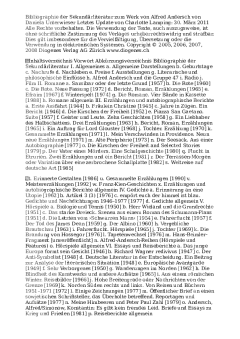







-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 20, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3578MB


