REVUE JUIVE 240 L’édifice des nombres du Penfafeuque I. L ’H istoire de ces con
REVUE JUIVE 240 L’édifice des nombres du Penfafeuque I. L ’H istoire de ces constatations Il sera sans doute intéressant pour l’histoire des sciences de connaître les voies qui m’ont amené aux constatations exposées ici. Je ne suis pas parti des mathématiques, mais des problèmes de l’exégèse. L’exégèse traditionnelle du Pen- tateuque obéit à des méthodes singulières. Bien que le Talmud soutienne que la Torah est l’œuvre d’un auteur unique, il la traite néanmoins comme si elle formait un ensemble de principes impénétrables. La conception qui veut qu’il n’y ait pas de suite chronologique dans la Torah, ou les treize règles d’exégèse, dont certaines scindent le Pentateuque en plusieurs parties, en en modifiant l’ordre, nous éclaire sur ces tendances. Mon maître, Abraham Biberfeld, veillait avec le plus grand soin à ce qu’on ne considérât pas le Pentateuque comme l’œuvre d’une « littérature nationale » et à ce qu’on ne lui appliquât pas les mêmes critères qu’à un texte de la littérature mondiale. Les méthodes que la tradition indique pour pénétrer le Penta- teuque entravent les efforts de traduction et nous écartent de son sens littéral bien plus qu’elles ne nous en rapprochent. Le sens des mots, nous enseigne la coutume, est à la surface ; lorsqu’on cherche à l’approfondir, on y trouve des indications se rapportant au fond de la tradition orale. Mais on parvient, pour finir, en une région qui révèle le sens fondamental, ou, mieux, la base initiale du document lui-même. Ainsi l’on découvre la voie qui, partant du sens superficiel du Pentateuque, conduit à la « forme originelle », dissimulée sous le sens littéral. Sans doute, au point de vue de la conception du monde, la critique moderne de la Bible et la tradition talmudique sont séparées par un abîme. Mais n’est-il pas surprenant que les méthodes de l’une et de l’autre présentent pourtant des ana- logies ? La critique biblique ne tient pas compte du fait que le Pentateuque, envisagé au point de vue du sens, se lit comme un livre homogène ; elle ne se préoccupe que de la forme. C’est précisément à cause de cette forme que certains lui attribuent presque autant de sources et d’auteurs qu’il contient de versets et de mots. Or, le parallélisme entre les deux méthodes — traditionnelle et critique — a attiré mon attention et m’a suggéré l’hypothèse qu’il devait exister une troisième possibilité qui permettrait d’expliquer pourquoi, en dépit de leurs points de départ différents, les analystes du Pentateuque sont amenés immanquablement à utiliser des méthodes analogues. Cette possibilité est restée inconnue aussi bien à la tradition qu’à la critique biblique. J’en conclus que la clef de cette énigme ne pouvait se trouver que dans le Pentateuque lui-même. 241 REVUE JUIVE J’ai étudié la critique de la Bible sous la direction d’un de ses meilleurs connaisseurs, le Dr Joseph Wohlgemut, professeur à l’Ecole Rabbinique de Berlin. En 1893, Paul Haupt avait édité la «Bible bariolée », qui permettait d’embrasser d’un seul coup d’œil les résultats de la critique biblique. Les diverses sources, gloses et conjectures, de même que les résultats obtenus par les « rédacteurs » qui auraient compilé et remanié les sources, y étaient imprimés en couleurs différentes. Or, en analysant la «Bible bariolée », j ’ai pu observer que les termes stéréotypés sont employés sept fois et j ’en ai déduit que les dérogations aux règles grammaticales, commentées par les critiques et attribuées par eux à telle ou telle source, étaient voulues par le Penta- teuque lui-même, soucieux de faire ressortir par le style le Nombre Sacré Sept. C’est ainsi que j ’ai trouvé en 1908 le sys- tème septennal du Pentateuque. Jusqu’ici j ’ai parlé de la critique de la Bible comme s’il était possible de constater que ses méthodes avaient été adoptées dès le début comme un élément de vérité. Loin de là ! La valeur de la critique de la Bible a été âprement discutée ; en tant qu’élément de culture, elle paraissait être sujette à caution. Les considérations d’après lesquelles on a essayé d’évaluer la science de la critique biblique étaient l’ère humaniste, l’anti- sémitisme et la suggestibiüté collective. Que la critique de la Bible découle de l’esprit humaniste, ses auteurs le concèdent sans ombrages. Leur argument est le suivant : » Le Pentateuque rapporte des miracles dont Moïse et les Israélites auraient été les témoins oculaires ; mais puisque nous ne croyons pas aux miracles, Moïse ne saurait être son auteur véritable. » Cependant, en arguant de cette façon, la critique biblique se range elle- même au niveau d’une science qui n’est pas exempte de pré- jugés. Quant à l’antisémitisme, il est indéniable qu’il exerçait parfois son influence sur la critique biblique. Il suffit de rappeler à cet égard l’ouvrage de Friedrich Delitzsch Die grosse Taüschung (La grande illusion). Cependant, d’autres arguments philosé- mitiques témoignent contre cette assertion. Ainsi, par exemple, le prof. Wellhausen a affirmé que les Juifs étaient le peuple classique de la religion. Que dire de la suggestibilité collective ? Il est difficile de l’admettre, puisque des auteurs différents, sans avoir été en rapport les uns avec les autres, sont parvenus à des résultats identiques. C’est une ironie du destin que ce soit précisément la décou- verte relative à l’architecture des nombres de la Torah qui ait mis un terme à la controverse engagée autour de la critique biblique tout en lui rendant justice. D’une part, cette découverte confirme la légitimité des méthodes de la critique biblique, car les observations de ses adeptes qui se rapportent au style du REVUE JUIVE 242 Pentateuque, sont exactes. D ’autre part, elle réduit à néant leurs thèses doctrinales proposées en guise d’explication des faits. La tournure « Tous les jours de... était... » dans la généalogie d’Adam, est-elle la particularité d’un rédacteur qui se servait constamment du singulier au lieu du pluriel ? Non, car ces infractions à la loi grammaticale sont intentionnelles dès le début : elles évitent que la Septaine obtenue par la septuple répétition de l’expression « Tous les jours de... étaient... » ne soit détruite. Les singularités du style ne découlent nulle part de la prétendue pluralité des sources ou des rédacteurs, elles correspondent, sans exception aucune, aux intentions du Pentateuque lui-même. Elles constituent un moyen indispensable pour le système septennal du Pentateuque. Cet objectif n’au- rait pu être atteint autrement : les irrégularités et les variations stylistiques sont précisément destinées à frapper l’esprit du lecteur par les entorses violentes qu’elles font subir à la syntaxe. L ’ironie du destin a voulu que la preuve de l’homogéinité du Pentateuque repose sur les méthodes et les découvertes de la critique biblique elle-même. Elle se voit ainsi tout ensemble justifiée et réfutée par ses propres moyens. II. L a Genèse du P entateuque Toutes les observations dont il a été question plus haut ne concernent que le côté intérieur, le style du Pentateuque. Nous y rencontrons cependant un autre élément, favorisant une pénétration plus profonde : les noms énumérés dans les généa- logies. Ils m’ont conduit nécessairement de l’exégèse aux mathématiques. Ma première constatation fut celle-ci : les noms des personnes figurant dans les généalogies sont ordonnés selon le nom de la Divinité. Dans la généalogie des Sémites au X e chapitre de la Genèse, le nombre des noms est de 26, — or, 26 est la valeur numérique du Nom de Dieu. Jusqu’ici je n’avais pas eu à franchir les limites du plan de l’exégèse. Mais une autre constatation m’y obligea quand même : le nombre des mots et celui des caractères du texte sont également ordonnés selon le nombre 26 qui en est l’unité de mesure. Ainsi deux autres couches du texte se révélèrent comme déterminées par le nombre unitaire. Et la troisième, la dernière couche, la valeur numérique des caractères ? Obéirait-elle à la même léga- lité ? Les calculs de vérification démontrèrent à nouveau l’em- ploi constant du Nombre Sacré 26. Voici, ensuite, un autre fait surprenant : la voie menant de l’exégèse aux mathématiques, nous reconduit par des détours, à l’exégèse. L’architecture numérique est un commentaire 243 REVUE JUIVE arithmographique, secret, créé par le Pentateuque lui-même, et qui fournit les réponses à des questions bien éloignées de la surface du texte à propos des princes et chefs de tribus édomites Korah, Timna et W e’ayah. Il apparut que les configurations arithmétiques confirment des traditions anciennes, et qu’elles sont seules à nous livrer la solution de certains problèmes de la science exégétique, restés sans solution depuis plusieurs siècles. Le seul fait que la couche la plus profonde du Pentateuque, celle des correspondances numériques des consonnes, est axée, elle aussi, sur le nombre-mesure 26, permet d’aborder le problème fondamental du Pentateuque, qui est celui de sa genèse. Comment le Pentateuque s’est-il constitué ? Serait-il le produit d’un calcul arithmétique ? Un maître génial du règne des nombres l’aurait-il rédigé ? D ’une analyse mathématique des faits il résulte que le Pentateuque n’a pu être élaboré par des opérations de calcul. Dans les mathématiques, la notion de uploads/Litterature/ oskar-goldberg-l-x27-edifice-des-nombres-du-pentateuque.pdf
Documents similaires





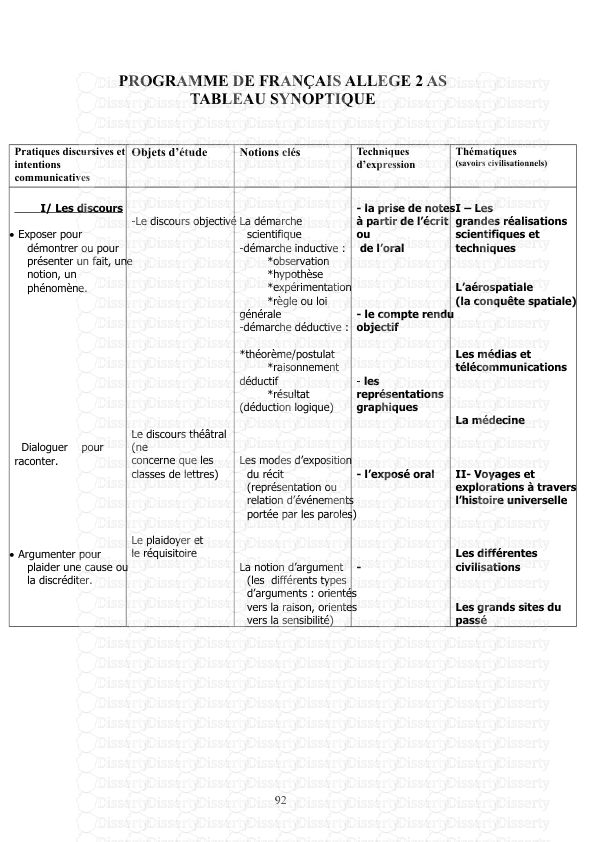




-
35
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 30, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2860MB


