Louis Pinto Sociologie des intellectuels ILa Découverte I Remerciements. Je rem
Louis Pinto Sociologie des intellectuels ILa Découverte I Remerciements. Je remercie, pour leurs remarques et suggestion tous ceux qui ont bien voulu Ure les premières versions j• œ livre, et notamment Julien Duval, johan .Heilbron, Gérard Mauger et Domiruque Merllié, Composé par Facompo à Llsleux Dépôt 11\J•I , avril 2021 S1 roui dèirez être tenu régulièrement informé des parutions de la coUectlon «Repères•, ît vous suffit de vous abonner- gratuitement à notre lettre d'lnlorrnation mensueGe par cccrret à partir de notre site www.coUecUonrepere.s.com, où vous -~ rensemble de notre catalogue. ISBN : 978-2-7071-9&84-6 En applica tion des arncjes t:. 122-10 à L 122-12 du code de ta propr1étê lntcl- lèctuclle, route reproduet1on- .\ usage rollectlf par photocopie, intégralement ou partie Jlement, du présent ouvrage est interdite sans autoris.atlon du Centre français d'op k::ritltion d11 droit de copte ;CFC, 20, rue des Grandr Augus Uns, 75006 Paris}. Toute autre torrœ de reprocucucn.. intégrale ou partielle, est également Jntertllte 51.llS au.todsalio n de l'èdneur, Q Éditions la Découverte, 2021, 9 b,s, rue Abel-Hovelacque, 75013 Paris. Introduction Le mot • Intellectuel •, relativement récent, ne remonte pas plus Join qu'à la fin du XlX' siècle. D'autres termes pourraient passer pour un équivalent. li en va ainsi pour •lettré•, qui suggère à la fois un rapport à l'écriture, très longtemps demeurée l'apanage de b 'loupes privilégiés, et un rapport à une tradition caractérisée par des textes dignes d'être conservés et étudiés. Certains mots sont fondés plutôt sur le rapport à un savoir : •savant•, - docte » et - érudlt » suggèrent un Individu ayant beaucoup étudlé, porteur de connaissances non accessibles au commun des mortels. Enfin, dans une période bien délimitée, le xvnr siècle, c'est le terme •philosophe• qui a servi à désigner un esprit encyclopédique intéressé par les prtncipau x domaines du savoir; on a pu voir dans Je personnage du philosophe la préfiguration de l'intellectuel contemporain, S'il y a une constante dans ces appellations, elle semble reposer sur la possession d'une compétence dans la manipulation de pensées, d'idées, de signes, de symboles ayant pour corrélat la dépos- session d'une partie considérable des membres d'une société. Qu'est-ce que le mot •intellectuel•• d'apparition récente, apporte de nouveau par rapport aux mots antérieurs? Ne nsque-t-on pas de céder aux leurres d'une projection rétro- spective? Le sociologue (et l'historien) se trouve(nt) pris dans une alternative : faut-li limiter le travail de recherche en fonction de l'apparition du terme en ignorant des périodes antérieures, ou bien peut-on considérer que, pour stgruûcative qu'ait été cette apparition, on est parfaitement en droit de remonter bien avant pour étudier les intellectuels ? ... SOCIOLOGIE DES: iNTELLf:C1UflS INTRODUCTION 5 Afin de sortir de l'embarras, on pourrait être tenté de s'en remettre à des définitions formelles sur ce qu'il faut entendre par • Intellectuel >, mals te risque serait alors de tomber dans l'arbitraire (on privilégie subrepticement un point de vue) ou dans un essentialisme anhtstorlque (au-delà des variations, .u y aurait bel et bien un noyau substantiel). Entre un nomina- llsme rigoriste, pour lequel il n'est pas possible de considérer la catégorie d'intellectuel indépendamment du travail d'objec- tivation réalisé à la fin du XIX' siècle, et un point de vue réaliste, porté à traiter les mots comme seconds par rapport à une réalité indépendante et présente de tout temps, on doit pouvoir travailler dans une longue durée, celle de l'histoire des intellectuels, tout en essayant de tirer toutes les conséquences du fait que la cristallisation sous un même mot de réalités pensées autrefois de façon dispersée constitue en sot un objet d'analyse. La démarche la plus .ngoureuse et la plus féconde consiste à la fois à prendre au sérieux les questions de mots et à adopter une démarche comparative visant à concilier l'étude de la singularité hlstorique et la recherche de propriétés structurales capables de manlfester le feu des invariants et des variations. C'est cette démarche que l'on va tenter de suivre ici. Faire la sociologie des intellectuels demande d'abord de se déprendre de !'ethnocentrisme Inhérent aux représentations ordinaires de l'intellectuel : cette figure est associée à une image prophétique, en partie Issue de I'héroïsatlon romantique du poète ayant conçu, dans la solitude, des idées qui, dans un premier temps, dérangent ses contemporains et qui, dans un second temps, sont célébrées avec admiration et reconnais- sance par les nouvelles générations. Cet esprit singulier est le créateur d'une œuvre écrite originale, rendue célèbre auprès du grand public à travers des articles dans la presse, des débats, des Interviews, etc. Pour rompre avec cette Imagerie, on doit s'employer à analyser toute une constellation de notions qui semblent aller de soi. " La première d'entre elles est celle d'auteur, construction historique appelée, peut-être, à disparaître (Foucault, 1969]*- L'existence contemporaine des droits d'auteur tend à nous faire •- tes référenc:es entre rnxhct5 renvoient à la btbUographle en fin d'ouvrage. oublier que l'appropriation d'un texte écrit n'a rien de naturel et qu'elle a été soit ignorée soit tenue pour secondaire dans beaucoup de sociétés [Diu et Parinet, 2013]. Roger Chartier évoque les cas de la publication anonyme, de l'écriture d'un texte à plusieurs ou encore de la réunion de plusieurs auteurs dans un recueil de « lieux communs». Il signale, par ailleurs, le foisonnement de plagiats, de copies qui compliquaient les tentatives d'identification d'un nom propre. Suivant les cas, les textes d'un auteur peuvent ainsi être réunls ï« reliés •l ensemble ou disséminés avec d'autres [Chartier, 1992). Au Moyen Âge, le statut <le l'auteur a été suspendu entre les figures grâce auxquelles un texte vient à l'existence - le « scribe », ou saiptor, copiant le texte aussi fidèlement que possible, le compilator réunissant des textes qui né sont pas de lui, Je commentator proposant un mélange de ses mots et de ceux d'un autre, et l'auctor pour qui ses propres mots l'emportent sur ceux d'un autre [Genet, 2003] : l'auteur est considéré en continulté avec d'autres figures. Quant il la notion de « création •, elle est rapportée exclusivement à Dieu. D'où la question de savoir de quel type d'auctoritas dispose l'auteur (question qui se pose d'abord à propos de I' - auteur » - humain - de la Bible). SI l'apparition d'un auteur-créateur ne se fait qu'autour de 1300 avec un novateur tel que Dante, l'auteur professionnel n'apparaît pas avant la fin du xvr' siècle. C'est sur un fond de culture transmise, de vérttés partagées et de lieux communs qu'un personnage exemplaire, tant par sa sagesse que par sa science, peut se détacher tout en échappant aux tentations d'une vaine gloire. De qui tenir son « autorité » ? De soi-même, d'une source supérieure, d'un « corps » Im personnel et transcendant? La reconnaissance d'une qualité d'auteur Implique trois types d'instances. Le premier est llé à l'institution scolaire qui contribue à faire exister des textes dignes d'être conservés et à les attribuer à des personnes singulières, capables d'accéder, le cas échéant, au Panthéon des grands hommes. Le deuxième concerne la légitimité des revendications d'une personne sut ces biens spécifiques que sont les textes : la codlflcation, à la fin du xvm" siècle, des • droits d'auteur» a favorisé l'objec- tivation de la catégorie en lui reconnaissant la maîtrise du contenu immatériel de son activité. Le troisième se rapporte à des considérations d'ordre public et à l'appareil répressif qui 6 $0ê 10LOC 1l DES lNTf ..llfCT\J H .5 INTRODUCTION 7 ) ( l tl t • • 1 à quelle personne physique faut-li imputer es sou en . a qu , l' d br -; É bll des propos jugés contraires à la morale, à or repu ic : ta r la responsabilité de l'auteur, Individu clalremcnt ldentlflé, est une affaire de police et de droit, comme.le mont:ent les procès contre plusieurs écrivains, dont Charles Baudelaire et Gustave Flaubert [Sapiro, 2011]. , . on pourrait tnterroger aussi la notion d • ~uvre • coextensive à celle d'auteur. Qu'en est-il des notes pratiques non destinées à la blication, telles que la liste des courses, ou des lettres, certain es étant anodines, d'autres ayant des résonances avec les textes publiés? La publication des • œuvres complètes> est confrontée à des questions comme cell~ de savoir si certains textes, tels que des notes de cours, merltent. publicatton et t imputables chez un auteur, à ce qui tient en lul du ::pJlateur, du ~ommentateur ou de l'auteur. Le monolithisme d la notion d'œuvre dissimule une pluralité de statuts des ;scours émis, transcrits, conservés. À l'image homogénéis _ante de livres rassemblés dans des bibliothèques, il faut substituer une conception pluraliste des modes d'existence des textes et de Jeurs usages. S'ils ont écrit des • livres », Platon, Thomas d'Aquin, Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant et Ludwig Wittgenstein, pour s'en tenir à des philosophes, n'ont pas entretenu le même rapport à leur activité, à leurs pairs, à leurs disciples, à leur audience, puisque les contextes d'énonciation étaient sensiblement différents, De même, les genres textuels (épopée, tragédie, comédie, roman, traité, discours, dissertation, thèse de doctorat, manuel ... ) ne doivent pas être uploads/Litterature/ pinto-l-sociologie-des-intellectuels.pdf
Documents similaires
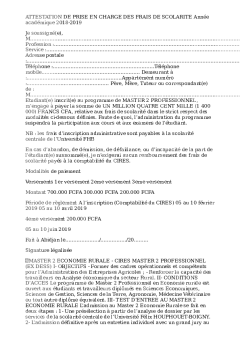









-
57
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 10, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 20.2549MB


