1 Ernest Renan et le rêve du style parfait Gilles PHILIPPE Université Paris 3 –
1 Ernest Renan et le rêve du style parfait Gilles PHILIPPE Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle En marge de la célébration du style comme signature résolument individuelle, ou en réaction contre elle, le XIXe siècle n’a jamais abandonné l’hypothèse d’un style parfait, c’est-à-dire généralisable. La correction d’un tel style est alors pensée dans les mêmes termes que la correction grammaticale ou lexicale ; comme la syntaxe ou le vocabulaire, l’appariement des mots ou l’agencement des groupes dans la phrase relèveraient en quelque sort de la langue elle-même, dont le génie appellerait tel type de phrase, tel ordonnancement dans la démarche. C’est le français lui-même, par exemple, qui serait réticent à la métaphore, s’accomplirait dans la phrase claire et sans surcharge, répugnerait à la répétition ; c’est conséquemment l’adéquation avec cet idéal qui entraînerait, à la lecture, un jugement de « bien écrit ». Les auteurs qui se tiennent rigoureusement à ces grands préceptes sont parfois qualifiés d’écrivains « sans style » par leurs détracteurs et de « modèles » par leurs admirateurs. Un tel binarisme se rencontre pourtant rarement et l’on observe plus souvent, au sein des mêmes discours, et cela dès la fin du XVIIIe siècle, une tension entre l’adhésion spontanée à ce qu’il faut bien appeler un « art d’écrire » et la revendication parfois affichée d’un traitement libéré et singulier du matériel langagier1. Cette tension s’observe assurément chez Gustave Flaubert, et c’est une des raisons pour lesquelles on va ici s’arrêter sur celui qui lui parut éligible au titre de modèle du style parfait et qui, de fait, fut largement considéré sur ce point comme le meilleur des maîtres pendant le dernier quart du XIXe siècle : C’est à la magie incomparable de son style qu’il doit d’être appelé par la majorité des critiques le premier prosateur français. Sa langue a toutes les qualités : clarté et profondeur, force et finesse, énergie et souplesse, logique et poésie, ce qu’il y a de meilleur dans le parler des classiques, ce qu’il y a de plus eurythmique dans le style d’aujourd’hui2. Les rééditions de l’importante Chrestomathie d’Henri Sensine le dirent et le redirent, mais on trouverait des formules comparables dans la plupart des manuels du temps. 1. Voir la belle étude de Jacques-Philippe Saint-Gérand, « Balzac, rhétorique, prose et style », dans Anne Herschberg Pierrot (dir.), Balzac et le style, Paris, SEDES, 1998, p. 49-75 2. Henri Sensine, Chrestomathie française du XIXe siècle (prosateurs), Paris, Payot, 1898, p. 428. 2 Nec pluribus impar Quand Ernest Renan décède à Paris, le 2 octobre 1892, une chose semble en effet sûre : il a été le plus grand prosateur de son temps, peut-être le plus grand prosateur de tous les temps. Le 17 octobre, le prolixe et très conservateur Edmond Biré s’en agace, constatant que si l’on se divise sur sa pensée, la plume de Renan fait l’objet d’un éloge unanime3. On le répéterait encore dix ans plus tard : De l’écrivain, ou du styliste, oh ! de l’écrivain, il n’y a que merveilles à dire, et je ne sais si le siècle qui vient de finir en aura connu de plus grand ; — les rangs sont toujours difficiles à donner ! — mais il n’en a pas connu de plus séduisant. Et l’auteur de ces lignes, Ferdinand Brunetière, de s’émerveiller : « abondance facile », « suprême aisance », « élégance familière et pourtant soutenue », « grâce enveloppante et souple » ; « nul, comme lui, n’a réussi, dans le contour simple et pur de sa phrase, à faire entrer tout un monde d’impressions et d’idées, surprises pour ainsi dire, et charmées en même temps, de se trouver rapprochées. » Le coup de pied de l’âne ne se ferait pas trop attendre, le charme serait brisé, le sophiste démasqué : « Eh ! il avait profité de la grande leçon de l’hégélianisme, qui est que l’expression d’une vérité n’est complète qu’autant que, par un artifice de vocabulaire ou de syntaxe, on réussit à y faire entrer l’expression de son contraire4. » C’est vrai, Renan introduit de la négation dans la positivité par son recours permanent à la modalisation (sans doute, peut-être, dans une certaine mesure, etc.), mais Brunetière, qui ne lui est guère favorable, reprend ici deux soupçons régulièrement émis contre la langue de Renan : une « germanité » de mauvais aloi, un souci rhétorique déguisé en obsession de la nuance. Ce coup de pied de l’âne, c’est surtout l’histoire qui l’a asséné, et le XXe siècle défit ce que le XIXe siècle avait fait : la gloire du style de Renan. Dans une lettre de 1923, Paul Claudel s’agaçait qu’Henri Massis eût « accepté sans discussion la légende que des générations de critiques, sans donner leurs raisons, bien entendu, ont faite autour du style de Renan ». Lui donnait en revanche les raisons de son dégoût : « démarche à la fois pompeuse et embarrassée », « chastes hardiesses », « réticents airs de bravoure, qui restent à jamais des modèles drolatiques de l’art pompier ». Bref, « c’est mou et vaguement sucré. On peut en avaler des platées sans s’en apercevoir, mais avec un véritable plaisir 5 ». André Gide confierait bientôt à son journal le même mépris : « Mollesse, incertitude de la langue de Renan » ; « Flaccidité. Phrase sans 3. Edmond Biré, « M. Ernest Renan » (17 octobre 1892), repris dans Romans et romanciers contemporains, Paris, Lamarre, 1908, p. 93-94. 4. Ferdinand Brunetière, « Première lettre sur Ernest Renan » (1903), Cinq lettres sur Ernest Renan, Paris, Perrin, 1910, p. 12, 13 et 21. 5. Paul Claudel, lettre à Henri Massis (10 juillet 1923), cité par Gilbert Guisan, Ernest Renan et l’art d’écrire, Genève, Droz, 1962, p. 141. 3 muscle » ; « Grâce détendue, retombée, qui se trouve chez Loti, et même chez Jules Lemaitre6. » Et, parcourant les Dialogues philosophiques, il épinglait une série d’expressions médiocres ou fautives : « Ton esprit apparaît altéré de soif » ; « Vit-on jamais de pareil sapajou ? » ; « Tout fidèle a droit que je lui serre la main ». Même Antoine Albalat, que l’on a connu si enthousiaste, devait, en 1933, rester mesuré dans l’éloge, déclarant que « cette prose fait revivre les plus belles qualités de la diction française », concédant qu’elle n’est pas sans « molles nuances7 ». La messe fut dire en 1948 quand, à « Michelet, génie authentique et prosateur de grande classe », Jean-Paul Sartre opposa un certain « Renan, dont le “beau style” offre tous les exemples souhaitables de bassesse et de laideur8 ». La cause fut entendue, et l’on n’en parla plus. La littérature venait de brûler ce qu’elle avait adoré. L’idée que Renan proposât une version éligible au titre de « style idéal » était apparue très vite, dès le premier succès, le premier scandale, le premier volume des Origines du christianisme : la Vie de Jésus en 1863. Tel fut en tout cas l’avis d’Edmond Scherer, dont le jugement était souvent assez juste : M. Renan est le plus accompli de nos écrivains modernes. Il n’en est aucun qui ait une si grande manière de dire, et qui, en même temps — c’est la marque des maîtres —, sache mieux exprimer simplement les choses simples, passer du récit à la discussion, et de la discussion aux poétiques pensées, en fondant le tout dans un même ton uni et soutenu9. Quelque vingt ans plus tard, la chose semble définitivement acquise : « Ce style est d’une qualité unique aujourd’hui, et très rare dans toute l’histoire de notre littérature10. ». Et le jeune Paul Bourget d’appeler le vieux Taine pour confirmer la sentence : Un mot significatif fut prononcé à son endroit par un des disciples de Gustave Flaubert, un jour que nous discutions ensemble sur la rhétorique de la prose contemporaine. Nous avions démonté la phrase de tous les manieurs du verbe qui ont quelque crédit dans l’opinion des lettrés. Nous vînmes à prononcer le nom de M. Renan. « Ah ! la phrase de celui-là », s’écria-t-il découragé, « on ne voit pas comment c’est fait11… ». Non que des réticences n’eussent tôt commencé à se faire entendre ; dans sa « Lettre à la jeunesse », au lendemain même de l’entrée de Renan à l’Académie 6. André Gide, Journal (27 juin 1932), t. II, éd. Martine Sagaert, Paris, Gallimard, « Bibl. de Pléiade », 1997, p. 371. G. Guisan fournit pour sa part une intéressante liste de négligences stylistiques dans les Souvenirs d’enfance et de jeunesse : emploi répété ou mal maîtrisé de cela, retour des mêmes sons, termes, tours et images en contexte étroit… (voir p. 104-105). 7. Antoine Albalat, La Vie de Jésus d’Ernest Renan, Paris, Société française d’éditions littéraires et techniques, 1933, p. 133 et 135. 8. Jean-Paul Sartre, Situations, II. Qu’est-ce que la littérature ? (1948), Paris, Gallimard, « Folio », p. 150. 9. Edmond Scherer, « La Vie de Jésus » (1863), uploads/Litterature/ renan-re-ve-du-style-parfait.pdf
Documents similaires








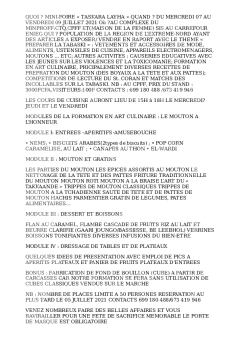

-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 08, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3311MB


