Pratiques : linguistique, littérature, didactique Textes/Discours et Co(n)texte
Pratiques : linguistique, littérature, didactique Textes/Discours et Co(n)textes. Entretiens avec Jean-Michel Adam, Bernard Combettes Jean-Michel Adam, Bernard Combettes, Dominique Maingueneau, Sophie Moirand, Guy Achard-Bayle Résumé Si ces trois entretiens sont présentés séparément, il n’en reste pas moins que les questions adressées à ces auteurs restent les mêmes et tendent à ce qu’ils confrontent leurs points de vue divers sur les rapports discours-texte-co(n) texte. ÀJean-Michel Adam, il est notamment demandé de revenir sur la dichotomie texte-discours (+ ou – contexte), et sur l’évolution qui l’a mené de la linguistique textuelle à l’analyse textuelle des discours ; il montre à l’aide de nombreux exemples, littéraires ou non, l’ampleur, la richesse mais aussi la complexité d’une telle analyse textuelle et contextuelle des discours. Bernard Combettes se situe plus particulièrement sur le terrain de la macrosyntaxe (connecteurs, anaphores, topicalisation...), même s’il revendique que l’on prenne en compte l’arrière-plan cognitif (ou informatif, i. e. référentiel et fonctionnel) ; il rappelle également la part qui doit revenir au diachronique dans les recherches textuelles. Dominique Maingueneau reprend et évalue diverses définitions du contexte en analyste du discours ; mais cette notion à géométrie variable se définit différemment suivant l’objet discursif auquel on tend à l’appliquer : conversation ou genre contraint... Il présente ensuite ses propres conceptions sur ce thème : interdiscours, scène d’énonciation, cadre herméneutique. Sophie Moirand situe sa réflexion entre linguistique sociocognitive et linguistique discursive, mémoire, intertextualité et hétérogénéité (énonciative mais aussi sémiotique et textuelle dans ses corpus de presse) ; ses recherches actuelles portent sur les moments discursifs (événements sociaux) qui tendent dans et par les médias à constituer une mémoire interdiscursive, et celle-ci à devenir mémoire collective. Citer ce document / Cite this document : Adam Jean-Michel, Combettes Bernard, Maingueneau Dominique, Moirand Sophie, Achard-Bayle Guy. Textes/Discours et Co(n)textes. Entretiens avec Jean-Michel Adam, Bernard Combettes. In: Pratiques : linguistique, littérature, didactique, n°129-130, 2006. pp. 20-49; doi : https://doi.org/10.3406/prati.2006.2094 https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2006_num_129_1_2094 Fichier pdf généré le 13/07/2018 Guy Achard-Bayle : Pour commencer, on peut se demander si s’attaquer (mé- talinguistiquement) au « contexte » est une entreprise bien raisonnable… tant cette notion est d’une étendue et d’une complexité considérables ! Georges Klei- ber s’y est attaché (1994, 1997a et b, 1998, 1999), et l’on voit bien qu’il s’agit là d’un travail de longue haleine, dont l’une des premières étapes a consisté à « faire un peu le ménage » (1999 : 167)… Autrement dit à recenser « métacontex- tuellement » les sens ou les emplois du mot : il en retient une quinzaine… voire une trentaine si l’on considère que chacun de ces sens ou emplois repose sur une opposition (1997a) ! À l’heure actuelle, G. Kleiber en a retenu et étudié surtout les « dimensions ou les distinctions » suivantes : i. en vs hors contexte, ii. con- vs co-texte, iii. contexte gauche vs droite, iv. à l’écrit vs à l’oral. Ceci dit, on peut aussi reprendre Catherine Kerbrat-Orecchioni (2002 : 135) qui s’arrête à quatre définitions ou oppositions : i. Micro vs macro contexte (cadre spatio-temporel et situation sociale lo- cale dans lesquels s’inscrit l’échange communicatif vs contexte institu- tionnel voire l’ensemble du monde physique…). ii. Ensemble de savoirs et de représentations partagées ou non. iii. Contexte conditionnant le discours vs discours transformant le con- texte, contexte construit par le discours. iv. Contexte du point de vue du locuteur (activités de production) ; contexte du point de vue de l’interlocuteur (activités d’interprétation : résolu- tion des ambiguïtés, décryptage des sous-entendus…). 20 PRATIQUES N° 129/130, Juin 2006 Textes/Discours et Co(n)textes Entretiens avec Jean-Michel Adam (Lausanne & Pôle de recherche en science des textes et analyse comparée des discours), Bernard Combettes (Nancy 2 & Atilf), Dominique Maingueneau (Paris XII & Céditec), Sophie Moirand (Paris 3 & Syled-Cediscor) Q1 : La première question sera donc, et un peu schématiquement : de quel(s) côté(s) du ou de ces « contextes » vous situez-vous en tant que spé- cialiste du texte et/ou du discours ? Q2 : À partir de là, en quoi le contexte ou les contextes est-il ou sont-ils caractéristiques et spécifiques de votre travail ou de vos travaux de cher- cheur et de votre domaine ou de vos domaines de recherche ? Q3 : M.-A. Paveau et G.-É. Sarfati (2003 : 184) regroupent sous une même étiquette « les linguistiques discursives » (autrement dit les linguis- tiques du transphrastique), la linguistique textuelle et l’analyse du dis- cours (AD)… Comment fédérez-vous de votre côté cet ensemble ; et com- ment le faites-vous au nom du contexte ? Autrement dit, comment vous y si- tuez-vous ? Q4 : En fait d’AD, on parle plutôt des AD (cf. la dernière synthèse de F. Mazière)… S’il y a donc une grande diversité des AD, quelle est la spéci- ficité d’une AD linguistique ? Q5 : Rançon du succès de vos champs de recherche respectifs ?... Texte et discours sont aujourd’hui au centre des apprentissages (du FLM), du moins des instructions qui les régissent… M. Charolles et B. Combettes (1999) en brossent un tableau et en tirent un bilan contrastés… Quel est vo- tre sentiment à ce sujet ? 21 Réponses de Jean-Michel Adam Texte, contexte et discours en questions Q1 (NDLR : cette première question comprenait une question annexe à J.-M. Adam : « Maintenez-vous ou non l’équation “discours = texte + contexte ?” », voir infra 1.2) 1.1. « En contexte vs hors contexte » ? Avant de répondre et en préalable à tout ce qui suit, je dois dire clairement que le concept de contexte me pose un problème majeur : une science du contexte est, à mes yeux, tout simplement impossible. J’ai parfois l’impression qu’en repo- sant la question du contexte, nous rêvons de rendre ce dernier manipulable. Par mesure de prudence, je dirai donc que nous ne pouvons donner que des défini- tions relatives à un cadre théorique et méthodologique limité. Procéder par cou- ples de concepts comme le propose Pratiques est à comprendre comme un essai de théorisation partielle du concept de contexte, au sein de ce que j’appellerai un système de concepts. C’est à cette réflexion que je me suis employé, en essayant de démêler pas à pas l’écheveau de concepts que les questions de Guy Achard- Bayle mettaient en avant. Ainsi la première question me gêne car j’ai envie de ré- pondre en deux mots : on est toujours « en contexte ». Quand on travaille sur des énoncés, on ne peut travailler « hors contexte » que si on se donne la phrase syn- taxiquement définie pour objet ou le phonème phonologiquement délimité. Mais 22 dans ce cas, le système même de la langue considérée n’est-il pas le « contexte » de l’unité (phonèmes ou trait phonologiques, unités morpho-syntaxiques) ? Cependant, je sais bien que, sous la question posée, il y a cette forte interroga- tion des frontières qui séparent texte et contexte comme interne/externe, texte/discours, co-texte/situation d’énonciation, bref monde des textes/monde social, et au-delà : explication de texte et histoire littéraire, linguistique structu- rale et socio-linguistique,formalistes et marxistes, etc. Pour répondre donc hon- nêtement aux présupposés de l’enquête de Pratiques, je dirai qu’une partie de mes travaux se situe dans le champ restreint (« hors contexte ») de la linguistique transphrastique que je distingue du champ plus large de l’analyse textuelle des discours dans mon dernier livre (Adam 2005a). Étudier des phénomènes trans- phrastiques, c’est nécessairement travailler « en contexte », mais je crois préfé- rable de commencer par remplacer contexte par co-texte, pour désigner la portée à gauche ou à droite d’unités linguistiques comme les connecteurs argumenta- tifs, les organisateurs textuels et autres marqueurs de prise en charge énoncia- tive (ou point de vue d’un énonciateur). Des énoncés peuvent être décrits « hors contexte », c’est-à-dire mis en rela- tion avec le système d’une langue donnée. Des textes peuvent également être étudiés en eux-mêmes et pour eux-mêmes. L’intérêt de cette façon de procéder « hors contexte » réside dans la volonté d’essayer de décrire un énoncé ou un texte le plus méthodiquement possible, en le considérant comme une forme-sens structurée. On peut décrire la dernière phrase de Nadja de Breton : « La beauté sera CONVULSIVE ou ne sera pas » comme une phrase française assertive. La graphie de « convulsive » en majuscules ne gênera pas beaucoup l’analyse mor- pho-syntaxique ou lexico-sémantique, elle sera tout simplement narcotisée. On peut même entreprendre une description illocutoire de cette assertion et souli- gner que, pragmatiquement, l’emploi du futur déclenche un acte prédictif qui fait de cet énoncé plus qu’une phrase de la langue, un énoncé dogmatique d’ailleurs détaché typographiquement du corps de la fin de Nadja, en position de clausule. Mais ces dernières remarques inscrivent la phrase dans le co(n)texte du livre de Breton et ne sont donc déjà plus « hors contexte ». On peut utilement dé- crire le fonctionnement des majuscules ou d’un adjectif dans l’édition Barbin 1697 des Fées de Perrault et en découvrir ainsi la systématique, liée à la progres- sion de l’histoire et à l’opposition des deux sœurs. Cette uploads/Philosophie/ adam-jean-michel-combettes-bernard-maingueneau-dominique-moirand-sophie-achard-bayle-guy-textes-discours.pdf
Documents similaires




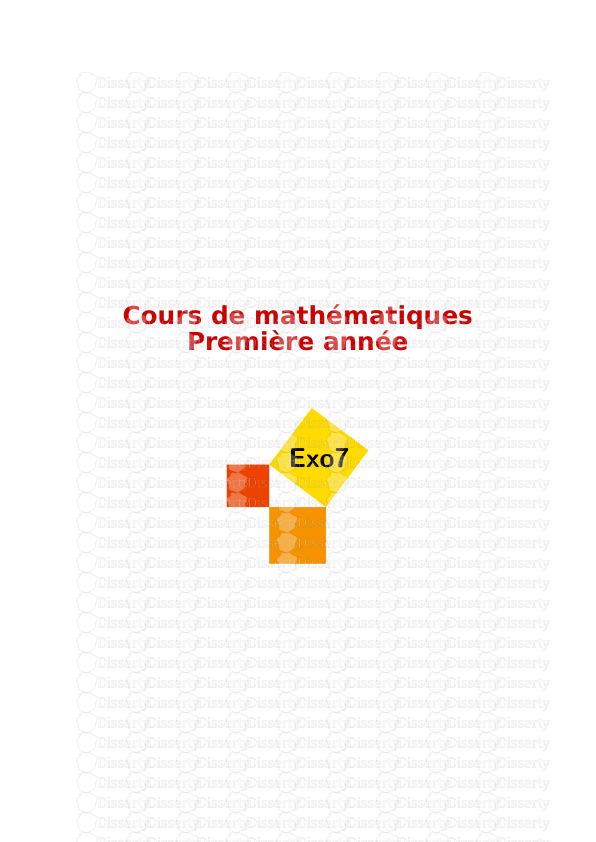





-
45
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 15, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2340MB


