Philosophie du langage et de la connaissance M. Jacques BOUVERESSE, professeur
Philosophie du langage et de la connaissance M. Jacques BOUVERESSE, professeur A. Cours Le cours de l’année 2005-2006 a été consacré à la poursuite et à l’achèvement du travail commencé il y a deux ans sur Gödel. Les treize leçons de cette année ont été consacrées à l’examen des aspects et des problèmes suivants : I. Gödel entre le réalisme naïf et l’idéalisme transcendantal II. Quel genre de réalité peut-on attribuer aux classes et aux concepts ? III. Le réalisme mathématique et l’« optimisme rationaliste » IV. Peut-on démontrer la vérité du platonisme mathématique et celle d’une théorie philosophique en général ? V. Les résultats de Gödel ont-ils justifié ses positions philosophiques ? VI. Logique, ontologie et métaphysique : Gödel critique de Carnap VII. Gödel et Carnap : ce que le maître a appris de l’élève VIII. Le mécanisme et le formalisme ont-ils été réfutés par le théorème d’in- complétude ? IX. La signification philosophique du théorème de Gödel selon Dummett X. La complétude sémantique, la complétude syntaxique et le problème de la décision XI. Indécidabilité de la proposition gödelienne et indécidabilité de « questions diophantiennes » dans l’arithmétique élémentaire XII. Après Turing : la généralisation des résultats de Gödel XIII. De Vienne à Princeton : la période américaine de Gödel Le travail a donc été réparti, pour l’essentiel, entre quatre thèmes principaux : 1) Le platonisme mathématique de Gödel, sa relation avec les résultats d’in- complétude, et sa proximité réelle ou seulement apparente avec l’idéalisme trans- cendantal husserlien ; 2) La critique radicale, par Gödel, de la conception « linguistique », et plus précisément « syntaxique », des énoncés mathématiques, qui assimile ceux-ci à des règles de langage ayant le statut de simples conven- tions ; 3) La signification philosophique du théorème de Gödel, telle qu’elle a JACQUES BOUVERESSE 378 été comprise respectivement par Gödel lui-même et par certains de ses interprètes philosophiques comme par exemple Michael Dummett ; 4) Le contexte histo- rique, mathématique et philosophique dans lequel sont intervenus les résultats d’incomplétude obtenus par Gödel, les raisons pour lesquelles ils ont fait une impression aussi considérable et pas nécessairement en rapport avec ce qu’ils comportaient de réellement inattendu, le manque de clarté sur la relation exacte qui existe entre le problème de la complétude syntaxique et celui de la décidabi- lité, le travail commencé brillamment par Gödel et continué ensuite par d’autres sur le rapport entre l’indécidabilité de la proposition gödelienne et l’irrrésolubilité de questions diophantiennes d’une certaine sorte, qui donne à première vue au résultat de Gödel un caractère à première vue beaucoup plus concret et le rend encore plus parlant du point de vue philosophique (en particulier, quand le problème posé est celui des possibilités respectives de l’esprit et de la machine, un point sur lequel il est généralement supposé avoir des implications tout à fait déterminantes). En ce qui concerne la période américaine de Gödel, on s’est concentré principalement sur le problème que soulève la démonstration de l’indé- pendance de l’hypothèse du continu par rapport aux axiomes usuels de la théorie des ensembles, la question de la ressemblance (ou de l’absence de ressemblance réelle) entre la situation créée par la démonstration et celle qui résulte de la démonstration de l’existence de propositions indécidables dans l’arithmétique formelle, et les raisons pour lesquelles l’indépendance de l’hypothèse du continu n’a pas convaincu Gödel de renoncer à l’idée qu’elle doit néanmoins bel et bien être vraie ou fausse et n’a pas ébranlé ses convictions platoniciennes en philoso- phie des mathématiques. Il est resté persuadé jusqu’au bout que les questions mathématiques ne peuvent être décidées que par des faits mathématiques qui sont réalisés ou ne le sont pas dans la réalité mathématiques et que la décision ne peut par conséquent comporter aucun élément de choix conventionnel. D’après ce que nous dit Hao Wang : « En 1959, Gödel a commencé à étudier l’œuvre de Husserl et a suggéré par la suite, avec une certaine hésitation, que la phénoménologie pourrait être la méthode correcte pour la philosophie. Même s’il y a des traces de l’influence de Husserl dans certains des écrits de Gödel, en nombre très limité, dont on peut disposer après 1959, on ne peut pas dire clairement que son œuvre ait tiré réellement un grand bénéfice de cette étude de Husserl. En 1972, il a dit qu’il n’avait pas trouvé ce qu’il cherchait dans sa poursuite de la philosophie ». On s’est interrogé longuement dans le cours, d’une part, sur les raisons qui ont amené Gödel à chercher dans la phénoménologie husserlienne la solution des problèmes qu’il se posait en philosophie, en particu- lier en philosophie des mathématiques, et, d’autre part, sur celles pour lesquelles il ne semble effectivement pas avoir trouvé ce qu’il cherchait chez Husserl ni d’ailleurs non plus chez aucun autre philosophe contemporain. Ce que Gödel espérait trouver en lisant Husserl est tout à fait clair. Dans le brouillon d’une lettre adressée au philosophe et mathématicien Gian-Carlo Rota, il écrit : « Une fois achevée, la phénoménologie transcendantale [de Husserl] ne serait ni plus PHILOSOPHIE DU LANGAGE ET DE LA CONNAISSANCE 379 ni moins que la critique de la raison pure de Kant transformée en une science exacte [qui], loin de détruire la métaphysique traditionnelle [...], s’avérerait au contraire lui fournir un solide fondement ». Gödel a cru pouvoir découvrir chez Husserl l’exemple d’un projet philosophique idéaliste qui, bien qu’inspiré initiale- ment de Kant, pourrait non seulement être réconcilié avec le réalisme, mais permettrait en outre à la métaphysique traditionnelle, telle qu’elle avait été conçue et pratiquée par des philosophes comme Leibniz, de prendre un nouveau départ. Mais, comme on l’avait déjà indiqué l’année dernière et l’a souligné à nouveau cette année, il y a des raisons de penser qu’il considérait Kant comme nettement plus subjectiviste et en même temps Husserl comme nettement plus réaliste qu’ils ne le sont en réalité. On est obligé évidemment de se demander de quelle façon le réaliste qu’il était aurait pu réagir à des déclarations comme la suivante, que l’on trouve dans La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale : « Nous apprendrons à comprendre que le monde existant pour nous dans le flux changeant de ses modes de donnée est un acquis universel de l’esprit, que c’est en tant que tel qu’il a eu son devenir et qu’il continue à devenir en tant qu’unité d’une seule figure de l’esprit, en tant que formation de sens — en tant que formation d’une subjectivité universelle fonctionnant de façon ultime. [...] Tout traitement théorique objectif du monde est traitement “de l’extérieur” et ne saisit que des “extériorités”, des objectivités. Le traitement théorique radical du monde est le traitement interne systématique et pur de la subjectivité s’“extériorisant” elle-même dans l’extérieur ». Eckehart Köhler admet clairement que, en dépit de la sympathie considérable dont la phénoménologie husserlienne ne pouvait pas ne pas bénéficier a priori aux yeux de Gödel, la réconciliation du point de vue ouvertement platonicien qu’il défendait avec la démarche à première vue nettement plus constructiviste de Husserl présentait, malgré tout, certaines difficultés. Dans les discussions du Cercle de Vienne, si Gödel avait pris le risque d’exprimer franchement ses convic- tions philosophiques, on peut supposer sans grand risque que : « La plus grande résistance est celle qui aurait été suscitée par son engagement en faveur de l’intuition rationnelle, qui passait depuis Kant pour avoir été liquidée, en dépit du fait que toute la logique et les mathématiques (tout au moins la partie ensem- bliste qu’elles comportent) dépendent d’elle — Kant justement, en commettant une erreur grossière, avait déclaré la logique morte. C’est le phénoménologue Kaufmann qui aurait été sur ce point le plus susceptible de comprendre Gödel, étant donné que toute l’entreprise phénoménologique de Husserl repose sur une intuition a priori (la vision des essences), qui va au-delà de la perception sen- sible ; c’est justement pour Husserl que Gödel a développé après 1959 une grande sympathie. Mais il y a eu là aussi des complications considérables. Premièrement, Husserl a limité son intuition, comme Brouwer, a un domaine qui peut être exploré de façon constructive, son adepte Kaufmann est allé, si possible, encore plus loin. Cela a placé Kaufmann dans la proximité de l’orientation, en matière de fondements, qui était celle de Poincaré, Brouwer et Weyl (Weyl avait suivi JACQUES BOUVERESSE 380 avec enthousiasme les leçons de Husserl avant la Première Guerre mondiale à Göttingen). Mais pour le directeur du Cercle de Vienne, Moritz Schlick, une intuition prétendument logico-mathématique (comme celle de Husserl) était jus- tement une bête noire ; dans cette opinion Schlick a été spécialement conforté également par Wittgenstein et Waismann. Ces choses étaient naturellement connues de Gödel, et il ne voyait pas de raison de détourner son attention d’un travail mathématique techniquement astreignant vers des confrontations philosophiques tout à fait obscures et dans un état de développement très insuffisant ». La complication que signale Köhler semble bien réelle. Il n’y a a priori aucune raison de penser que la phénoménologie husserlienne va, en philosophie des uploads/Philosophie/ upl17139-jbouveressecours0506-pdf.pdf
Documents similaires


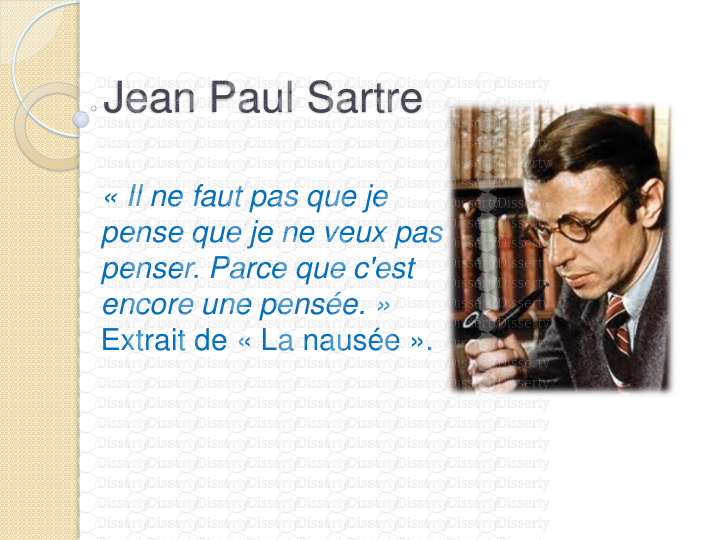







-
539
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 18, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3345MB


