L ’Europe des lumières rêva de décorer le mérite. Elle prétendit même faire des
L ’Europe des lumières rêva de décorer le mérite. Elle prétendit même faire des distinctions honori- fiques le fondement des hiérarchies sociales. Que l’on songe à la conclusion du célèbre Traité des délits et des peines: « Si les prix distribués par les Académies aux Auteurs des découvertes utiles ont étendu les connaissances et multiplié les bons livres, pourquoi des récompenses de la main d’un Monarque bienfaisant n’augmenterait-elle pas le nombre des belles actions1?» Promue dans les milieux utilitaristes, cette revendica- tion reste difficile à analyser, notamment à partir de nos spécialisations académiques. Sans doute parce que chaque bastion disciplinaire prétend d’abord y installer sa propre «avant-garde». Pour la sociologie du droit, ce type de récompense relève de l’arsenal des «sanctions posi- tives», autrement dit d’un moyen alternatif de garantir l’observance des lois2. Pour la philosophie morale, il faut y lire la quête d’une vertu susceptible de ne faire appel à aucune transcendance autre que le sentiment de la loi: d’où son assimilation à la controverse sur les « fonde- ments de la moralité» qu’aurait ouverte en 1745 l’Essai sur le mérite et la vertu d’Anthony Ashley Cooper, comte de Shaftesbury3. Quant aux juristes, ils en font la GOUVERNER PAR LES HONNEURS. DISTINCTIONS HONORIFIQUES ET ÉCONOMIE POLITIQUE DANS L’EUROPE DU DÉBUT DU XIXe SIECLE* Olivier Ihl * Ce texte est tiré d’une communication présentée au colloque organisé par le Centre d’études de la pensée et des systèmes économiques et l’association Charles Gide pour l’étude de la pensée économique sur «Histoire des représentations du marché», Institut d’études politiques de Grenoble, 25, 26 et 27 septembre 2003. Tous mes remerciements aux lecteurs anonymes de la première version de ce papier pour leurs critiques très constructives. 1. Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines [Dei delitti e delle pene], Philadelphie, 1766, p. 147. 2. Voir, dans la tradition de la sociologie parsonnienne, l’article de Jack P. Gibbs, «Norms: The Problem of Definition and Classification», The American Journal of Sociology, vol. 70, n° 5, 1965, pp. 586-594. Ou plus récemment, Martin L. Friedland (éd.), Sanctions and Rewards in the Legal System, Toronto, University of Toronto Press, 1989 et Francesco D’Agostino, Sanzione e pena 4 D O S S I E R Genèses 55, juin 2004, pp. 4-26 métaphore d’un «droit distributif»: par opposition au «droit pénal», celui-ci permettrait d’affirmer la supério- rité de la prévention sur la punition4. Et si cette «monnaie d’honneurs», que Cesare Beccaria, aristocrate réformiste de vingt-cinq ans, présentait comme « inépuisable et féconde entre les mains d’un sage distributeur», relevait d’une autre histoire : de l’entrée des honneurs dans le giron d’une économie politique œuvrant à modeler de nouvelles catégories d’intervention publique? Explorer cette hypothèse, c’est revenir sur les condi- tions qui ont permis aux traditionnels «bienfaicts» du roi, ceux dont parle encore Michel de Montaigne au titre d’une police des mœurs5, de s’imposer comme une tech- nique de gouvernement à part entière6. Un processus qui s’est déployé dans le mouvement même par lequel la récompense, se distinguant de la « libéralité » et de la « faveur », est devenue l’objet d’une revendication de scientificité, celui d’un militantisme savant dont cet article s’attache à reconstituer les contours. Voyages, séjours, correspondances : un véritable réseau européen s’est mobilisé sur cette thématique, celle d’un management honorifique d’État. Pour trouver un substitut aux piétés consolantes et autres dévotions protectrices chères à la pastorale chrétienne, il fallait établir un «trésor d’hon- neurs». Et plus encore: exciter l’émulation, rétribuer le mérite, honorer la vertu. Très vite, le mot d’ordre devient un lieu commun. À la veille de la Révolution française, il se déploie aux marges d’une professionnalisation écono- mique déjà amorcée7 et de sciences expérimentales (comme la physique ou la statistique) qu’abritent, dans toute l’Europe, collèges royaux et Académie des sciences. Comme si promouvoir la « monnaie des honneurs », c’était pour ces réformateurs en appeler à transformer un art de gouvernement en une science d’État. Jean-Claude Perrot a montré combien la prétention de fonder une «science» de l’économie accompagna l’école physiocra- tique, entre 1767 et 1774 avant de disparaître puis de rebondir au tournant du siècle grâce à l’abbé Joseph- André Brun de La Combe, François Véron Duverger de Forbonnais ou Julien-Hyacinthe Guer marquis de Mar- nières et, enfin, de se généraliser8. D’autres figures, aujourd’hui oubliées, permettent d’en prendre la mesure, cette fois au nom d’une «science» des honneurs. Comme celle du comte Giuseppe Gorani, dont l’ouvrage, publié en 1790, fut traduit deux ans plus tard à Paris sous le titre Recherches sur la science de gouvernement9. Pour cet nell’esperienza giuridica, Turin, Giappichelli, 1989. 3. Voir le chapitre qu’Alasdair C. Mac Intyre consacre au «projet des Lumières de justifier la moralité», dans After Virtue, Duckworth, Londres, 2000 [1981], pp. 36 et suiv. 4. Exemple: l’article «Sanction» de Charles-Albert Morand dans Archives de philosophie du droit, vol. 35, 1991, pp. 293-312. 5. «C’a esté une belle invention, et receuë en la plupart des polices du monde, d’establir certaines merques vaines et sans prix, pour en honnorer et recompenser la vertu», in Reinhold Dezeimeris et Henri Barckhausen (éd.), Essais de Michel de Montaigne [texte original de 1580 avec les variantes des éditions de 1582 et 1587], Bordeaux, Feret et Fils, 1870, t. 1, chapitre VII «Des récompenses d’honneur», p. 312. 6. Sur cette problématique générale, voir Olivier Ihl, Martine Kaluszynski, Gilles Pollet (éd.), Les sciences de gouvernement, Paris, Economica, 2003. 7. Catherine Larrère, L’invention de l’économie au XVIIIe siècle. Du droit naturel à la physiocratie, Paris, Puf, 1992, notamment pp. 193 et suiv. 8. Jean-Claude Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique (XVIIe-XVIIIe siècle), Paris, EHESS, 1992, p. 81. 9. Giuseppe Gorani, Recherches sur la science de gouvernement, Paris, 1792. Sa première édition, sous le titre Ricerche sulla scienza dei governi date de 1790, chez Heubach, Durand & Co, à Lausanne, et non de 1788 comme l’indique, en suivant les mémoires de G. Gorani, Alessandro Casati dans sa présentation du Dal dispotismo illuminato alla rivoluzione, Milan, A. Mondadori, 1942 [1767-1791], p. 430, n. 2. On retrouve là le désir de paraître avoir anticipé la Révolution française contre les apparences d’un travail pourtant bien ancré dans les Lumières prérévolutionnaires. 5 illuminista qui fait transition entre la science mondaine du XVIIIe siècle et celle, académique, du XIXe siècle, régénérer l’édifice des relations sociales, c’était imposer une nou- velle ingénierie du mérite. Une idée abondamment débat- tue dans la première moitié du XIXe siècle, notamment par Jérémie Bentham, Jean-Baptiste Say ou les «écono- mistes» italiens. Restituer le contexte de cette revendication, c’est – comme on le verra dans un premier temps – contribuer à l’histoire d’une démocratisation des honneurs et, plus lar- gement, d’une émulation premiale que l’Europe des Lumières plébiscita comme un moyen d’accéder à l’éco- nomie de marché et à une démocratie civique10. C’est renouer surtout – ce sera l’objet d’un second temps – avec une constellation de savoirs et de pratiques devenus étrangers à la science économique, notamment à la théo- rie des incitations, alors même que celle-ci a colonisé, sous son versant managérial, les organisations hiérar- chiques, depuis la bureaucratie stato-nationale jusqu’à la firme industrielle11. Car cette «science» des honneurs n’a rien d’anecdotique. Elle a bel et bien participé d’une forme d’administration du social12: celle dont témoigne, tout au long du XIXe siècle, l’inflation des médailles, prix, concours et autres émulations honorifiques, celle dont le tournant néolibéral en Europe pourrait bien célébrer à nouveau l’ordre des vertus. Une «science» des honneurs Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, récompenser, du latin recompensare, c’était donner en retour, fournir compen- sation à une perte ou une privation. Du latin compensare, le mot exprimait le dédommagement chrétien, c’est-à-dire la rédemption des péchés. Après 1750, les activités pro- ductrices sont vantées par les écrivains et les philosophes. On se prend d’enthousiasme pour les théories écono- miques. Au point que les mécanismes de la production se voient assimilés à ceux de la « civilisation ». L’idée de récompense se spécialise. Elle se fixe sur le versant positif du terme: non plus réparer mais gratifier. C’est ainsi que le siècle des Lumières considéra sous un jour nouveau la notion d’émulation, qu’il en fit une fonction de l’État libéral13. Apologie des expositions agricoles, création de sociétés d’encouragement, multiplication des prix propo- sés par les académies et sociétés savantes: tout était bon pour répandre des «motifs d’encouragement». Il s’agissait, 10. Sur le rôle des récompenses dans la science administrative et la pensée économique contemporaines, voir James N. Baron et Karen S. Cook, «Process and Outcome: Perspectives on the Distribution of Rewards in Organisations», Administrative Science Quarterly, n° 37, 1992, pp. 191-197. 11. Une conceptualisation en termes de «subordination volontaire» destinée, depuis les travaux pionniers d’Oliver E. Williamson, à rendre compte de la «nature de l’autorité» au sein de la «firme moderne» ou dans la «relation d’emploi» (Markets and Hierarchies, New York, The Free Press, 1975, p. XV). On remarquera toutefois que le «jeu des sanctions et des incitations» utilisé pour produire «l’obéissance» demeure, dans cette tradition, masqué par une problématique fort peu uploads/Politique/ gouverner-par-les-honneurs-distinctions-honorifiques-et-economie-politique.pdf
Documents similaires

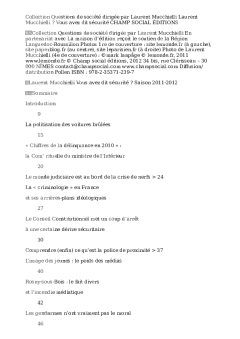








-
54
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 14, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6042MB


