Menu principal Une lecture lakatosienne de l’approche par les écosystèmes d’aff
Menu principal Une lecture lakatosienne de l’approche par les écosystèmes d’affaires A Lakatosian Perspective on the Business Ecosystems Theory Los ecosistemas empresariales : un enfoque con la perspectiva de Lakatos Anne Gratacap, Thierry Isckia et Xavier Parisot …plus d’informations Diffusion numérique : 24 octobre 2018 URI https://id.erudit.org/iderudit/1052767aradresse copiéeune erreur s'est produite DOI https://doi.org/10.7202/1052767aradresse copiéeune erreur s'est produite Un article de la revue Management international / International Management / Gestiòn Internacional Volume 21, Numéro 3, Printemps 2017, p. 81–95 Communautés et réseaux de pratique : organisations innovantes et globalisation des connaissances Tous droits réservés © Management international / International Management / Gestión Internacional, 2017 Feuilleter les articles de ce numéroBoîte à outils PDF Résumés Résumé La notion d’Ecosystème d’Affaires est aujourd’hui bien ancrée dans le vocabulaire managérial. Pourtant, l’existence d’un programme de recherche scientifique spécifique aux écosystèmes d’affaires reste discutée dans le monde académique. Pour démontrer l’existence d’un tel programme, nous avons réalisé une analyse qualitative diachronique exploitant une version de la méthodologie des programmes de recherche de Lakatos adaptée aux sciences de gestion. 74 articles publiés dans 22 journaux de Management Stratégique à fort facteur d’impact entre 1993 à 2014 ont été sélectionnés. L’analyse diachronique des travaux retenus démontre l’existence d’un programme de recherche dynamique et progressif connectant de nombreux construits théoriques différents. Mots-clés : Écosystème d’affaires, innovation collective, management stratégique, programme de recherche progressif, Lakatos Abstract The Business Ecosystem notion is now firmly rooted in managerial vocabulary. However, the existence of a specific business ecosystem scientific research program is still being discussed in the academic world. To demonstrate the existence of such a program, we carried out a diachronic qualitative analysis using a version of the Lakatos research program methodology adapted to the management sciences. 74 articles published in Strategic Management journals with a high impact factor between 1993 and 2014 were selected. The diachronic analysis of the selected works demonstrates the existence of a dynamic and progressive research program linking different theoretical constructs. Keywords: Business ecosystems, collective innovation, strategic management, progressive research program, lakatos Resumen Actualmente, la noción de Ecosistema de Negocios está bien arraigada en el vocabulario empresarial. Sin embargo, la existencia de un programa específico de investigación en este tema sigue siendo debatido por el mundo académico. Para demostrar la realidad de tal programa, procedimos a un análisis cualitativo diacrónico basado en una versión de la metodología de los programas de investigación de Lakatos aplicada a las ciencias de gestión. Seleccionamos una recopilación de 74 artículos científicos publicados entre 1993 y 2014 en revistas de Gestión Estratégica y presentando un fuerte factor de impacto. El análisis diacrónico de estos artículos demuestra la presencia de un programa dinámico y progresivo de investigación vinculado con conceptos teóricos como los modelos de negocios, las plataformas y la innovación abierta. Palabras clave: Ecosistema de negocios, innovación colectiva, gestión estratégica, programa progresivo de investigación, Lakatos Corps de l’article Les articles et ouvrages sur les écosystèmes d’affaires (EA) se sont multipliés depuis quelques années, dans la presse économique et managériale grand public, mais aussi, plus récemment, dans les revues académiques en management. Cette multiplication de contributions confère-t-elle pour autant à l’approche par les EA le statut de « nouvelle production scientifique » ? Comment évaluer son intérêt dans le champ du management stratégique (MS) ? De nombreux débats alimentent la question des déterminants de nouveaux paradigmes, théories ou concepts scientifiques. Dans le cadre de l’organizational theory par exemple, plusieurs auteurs se sont interrogés sur la nature d’une théorie (Dimaggio, 1995; Sutton & Staw, 1995; Weick, 1995; McKinley et al., 1999). Astley (1985), McKinley et al. (1999) et Astley & Zammuto (1992) ont considérablement enrichi le débat en s’intéressant à l’émergence de nouveaux paradigmes ou théories. Ils ont notamment précisé que ces derniers devaient impérativement s’inscrire dans une réflexion plus générale. Cette réflexion vise à apprécier notamment, le contexte, les conditions et les modalités par lesquelles ils ont pu trouver une audience au sein d’une communauté scientifique donnée. Ces questions ont toujours animé la communauté scientifique. Karl Popper (1968), Ludwik Fleck (1979) et Thomas Kuhn (1970) - pour ne citer qu’eux - sont à l’origine de contributions majeures, sur lesquelles Lakatos s’appuiera pour élaborer une méthodologie des programmes de recherche scientifique (Lakatos, 1970, 1978). En nous appuyant d’une part sur la méthodologie des programmes de recherche scientifique (MPRS) développée par Lakatos (1970, 1978) et d’autre part, sur une étude bibliométrique et une revue de la littérature qui couvrent une période de plus de dix ans, nous montrerons que l’approche par les EA constitue un programme de recherche progressif. Ce programme de recherche présente un cadre commun unifié permettant de mieux explorer les différentes facettes de l’innovation collective dans un contexte de globalisation économique et technologique. Notre analyse met en exergue plusieurs caractéristiques des EA comme programme de recherche : Une trajectoire académique qui passe par plusieurs périodes visant une reconnaissance institutionnelle, Un processus de développement marqué par un ancrage empirique fort et une logique abductive dominante, Des formes de nouveauté qui visent à s’émanciper des cadres théoriques classiques (nouveaux concepts, nouveaux phénomènes). La première partie de cet article présente les grandes lignes de la MPRS de Lakatos. Nous soulignerons les apports de la MPRS et montrerons que certains aménagements s’imposent afin d’embrasser la spécificité des sciences de gestion et de la stratégie. La seconde partie analyse le développement de l’approche par les EA à l’aune de la MPRS adaptée aux sciences de gestion. Nous procèderons alors à une analyse bibliométrique de notre corpus d’articles afin d’apprécier les différentes phases de développement de ce programme de recherche. Enfin, nous discuterons dans la troisième partie, du caractère progressif du programme de recherche sur les EA, de sa cohérence et de son originalité, en mettant en avant les tâtonnements partagés par toute théorie en cours de construction (Weick, 1995). Une validation épistémologique par la MPRS L’oeuvre de Lakatos est guidée par la volonté d’appréhender la nature d’une avancée scientifique (problemshift progressive) et de fournir un moyen d’apprécier les progrès réalisés, c’est-à-dire la valeur des connaissances produites. Pour Lakatos, le progrès scientifique résulte des imbrications dialectiques en cours entre des théories concurrentes au sein d’un ensemble « organique » c’est-à-dire un programme de recherche (Lakatos, 1978, p.11). L’auteur cherche à réconcilier les positions de Popper (falsificationnisme) et de Kuhn (conventionnalisme) face à la nouveauté scientifique. En effet, la question se pose de savoir ce qui constitue - ou non - une nouveauté ou une avancée scientifique (Larvor, 1998; Edouard & Gratacap, 2010, 2011). En transposant son analyse aux sciences de gestion, nous montrerons d’une part, qu’un aménagement s’impose afin d’identifier les figures de cette nouveauté. D’autre part, nous appréhenderons leur valeur scientifique, c’est-à-dire l’intérêt qu’elle suscite au sein de la communauté académique. L’architecture de la méthode Pour Lakatos (1970, 1978), un programme de recherche consiste en un noyau dur d’hypothèses centrales non directement critiquables, autrement-dit non réfutables. Ce programme se présente comme une série de théories successives qui se construisent en acceptant ce noyau d’hypothèses centrales. Lakatos étudie l’ensemble des hypothèses d’une même série de théories et non une somme de théories : « Progress is measured by the degree to which a problemshift is progressive, by the degree to which the series of theories leads us to the discovery of novel facts » (Lakatos, 1970, p.118). Il cherche à comprendre les fondements de l’évolution des théories d’une même série. Une série de théories assemblée autour du même noyau dur constitue un programme de recherche. La MPRS se structure autour de différents éléments : Le noyau dur regroupe les hypothèses centrales. Celles-ci sont partagées par l’ensemble des théories qui composent le programme, La ceinture protectrice est constituée d’hypothèses auxiliaires réfutables remplissant deux fonctions : 1) leur ajustement au regard des anomalies observées empiriquement permet la progressivité du programme 2) elles défendent les hypothèses centrales du noyau dur de toute falsification ou remise en cause. Les heuristiques négatives et positives constituent « apowerful problem-solving machinery » (Lakatos, 1978, p.4). L’heuristique négative maintient inchangée le noyau dur au cours du développement d’un programme (intra-program problemshift). L’heuristique positive conduit à l’élaboration d’hypothèses auxiliaires qui contribuent à enrichir le noyau dur de nouvelles directions de recherche (inter-program problemshift), par l’émergence de nouvelles séries théoriques. Les problemshifts qui interférent avec le noyau dur d’un programme induisent l’émergence d’un nouveau programme de recherche. Les deux types de problemshifts sont dégénératifs lorsqu’ils ne constituent que de simples tentatives ad-hoc pour faire face à des preuves apparemment discordantes. Lakatos explique la continuité des sciences en interprétant leur histoire comme étant celle de programmes rivaux, certains étant progressifs et d’autres dégénératifs. Cette perspective historique est centrale et considère la temporalité d’un programme c’est-à-dire son évolution chronologique. Dans ce cadre, Lakatos suggère de ne pas abandonner prématurément un programme et insiste sur l’idée qu’il doit être protégé - au moins temporairement - des programmes rivaux antérieurs, afin d’éviter toute position trop dogmatique. Un programme de recherche est dit progressif ou productif si sa croissance théorique anticipe sa croissance empirique (Lakatos, 1971, p 200), autrement-dit s’il permet de uploads/Science et Technologie/ lalatos-2.pdf
Documents similaires



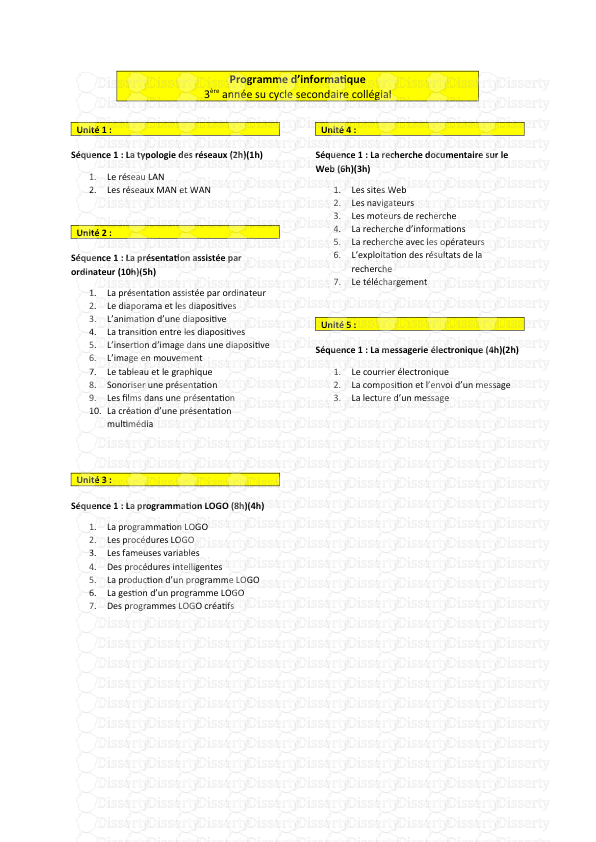






-
109
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 18, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3501MB


