CONSIDÉRATIONS SUR L'IDÉE DE NORME Eirick Prairat ADRESE/CIRNEF | « Les Science
CONSIDÉRATIONS SUR L'IDÉE DE NORME Eirick Prairat ADRESE/CIRNEF | « Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle » 2012/1 Vol. 45 | pages 33 à 50 ISSN 0755-9593 ISBN 9782918337119 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere- nouvelle-2012-1-page-33.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour ADRESE/CIRNEF. © ADRESE/CIRNEF. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.123.208.211 - 23/03/2020 08:14 - © ADRESE/CIRNEF Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.123.208.211 - 23/03/2020 08:14 - © ADRESE/CIRNEF Résumé : La question de la norme connaît ces dernières années un vif regain d’intérêt dans les champs de la sociologie et de la philosophie. Le présent article est structuré comme une enquête, c’est-à-dire comme un travail d’élucidation méthodique d’une série de points successifs qui, in fine, permet de mettre au jour une conception de la norme. Finalement, la véritable énigme intellectuelle -que l’on ne saurait confondre avec le problème sociopoli- tique- n’est pas le problème de la transgression mais celui de l’accepta- tion. Pourquoi acceptons-nous aussi facilement les normes? Résoudre cette énigme, c’est sans aucun doute saisir le sens ultime de la norme. Considérations sur l’idée de norme Eirick PRAIRAT* Mots-clés : Acceptation. Normativité. Norme. Pratiques humaines. Régularité. Régulisme. Transgression. Valeurs. * Professeur des Universités, Université de Lorraine, Institut universitaire de France (IUF). Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.123.208.211 - 23/03/2020 08:14 - © ADRESE/CIRNEF Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.123.208.211 - 23/03/2020 08:14 - © ADRESE/CIRNEF Introduction Il est vrai que le problème social est celui de la transgression et plus encore celui de la gestion des transgressions des différentes normes (sociales, juridiques ou encore morales) qui permettent la cohabitation et la reconnaissance entre les hommes. L’actualité politique, par un jeu de prismes et de miroirs grossissants, en fait même un problème majeur. Nous aurions tort d’assimiler le problème socio-politique à l’énigme intellectuelle car la véritable énigme au sujet de la norme est moins le problème de la transgression, appréhendée comme un fait social et qui reste qu’on le veuille ou non finalement un phénomène relative- ment marginal, que celui de l’acceptation. Pourquoi acceptons-nous aussi facilement les normes? Il va non seulement falloir que nous proposions une explication mais que nous montrions que cette explication peut être tenue pour la bonne1. Vincent Descombes dans les premières pages de sa grande enquête sur «Le fait d’agir par soi-même» soulignait que si la réponse est souvent triviale, le chemin vers celle-ci ne l’est jamais, nous encourageant à pratiquer «les voies de l’éclair- cissement syntaxique». «Ce qui fait l’intérêt et, dans certains cas, la profondeur du travail philosophique (…), écrit-il, n’est (…) pas la teneur de la réponse, mais c’est d’arriver à accepter que cette réponse triviale est en effet la bonne, donc à déjouer les charmes des sirènes spéculatives». «Pour cela, ajoute-t-il, il a fallu surmonter une tendance à pratiquer la philosophie sur le mode eidétique, comme nous étions tentés de le faire en cherchant à fixer notre attention sur le temps pour déterminer ce qui fait que le temps est le temps. Il a fallu accepter de procéder par la voie grammaticale» (Descombes, 2004, p. 12). Nous suivons, dans les premiers moments de notre enquête, les conseils de Vincent Descombes. 1. Énoncés Commençons notre travail d’enquête en examinant la forme linguistique des énoncés normatifs. Nous pouvons raisonnablement penser qu’en mettant au jour la spécificité de ce type d’énoncé, nous aurons déjà quelques informations Les Sciences de l’éducation - Pour l’Ère nouvelle, vol. 45, n° 1-2, 2012 34 1. Ce texte doit beaucoup à la lecture croisée des travaux de Ruwen Ogien et de Pierre Livet. Ce dossier est donc une heureuse manière de poursuivre le débat avec ces deux auteurs. Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.123.208.211 - 23/03/2020 08:14 - © ADRESE/CIRNEF Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.123.208.211 - 23/03/2020 08:14 - © ADRESE/CIRNEF Eirick PRAIRAT 35 sérieuses sur la réalité normative. Les énoncés normatifs ou déontiques2 utili- sent le plus souvent des formes verbales à l’impératif ou des opérateurs modaux dits déontiques, comme par exemple «il faut», «il est obligatoire» ou encore «il est demandé». Les critères linguistiques ont cependant leurs limites car il est toujours possible de formuler des énoncés normatifs sans recourir à des opéra- teurs déontiques ou à des formes verbales impératives. Pensons aux formes infinitives («ne pas se pencher», «ne pas courir») ou aux formes nominales («Pelouse interdite», «défense d’entrer»). Dans le corpus juridique, la dimen- sion normative est parfois indiquée par l’usage de verbes conjugués au présent ou au futur de l’indicatif. Des expressions telles que «le contrat est signé» ou «la pièce d’identité sera présentée» doivent être comprises comme des injonc- tions même si elles sont dépourvues d’opérateur déontique ou de verbe à l’impératif. À l’inverse, note Ruwen Ogien, «des énoncés qui contiennent des verbes déontiques n’expriment pas nécessairement des prescriptions. L’énoncé : «Pour faire bouillir de l’eau, il faut porter sa température à 100 degrés» contient un verbe déontique mais n’a pas la signification d’une prescription. Il exprime seulement le fait que l’eau bout à 100 degrés. Par ailleurs, le mode impératif ne suffit pas, à lui seul, à indiquer la prescription ou l’obligation. L’impératif de Jacques Brel : «Ne me quitte pas» peut servir à exprimer une recommandation, un conseil, une menace, un avertissement, une requête, une supplique, une simple demande (…) autant qu’une obligation. Bref, il convient de distinguer le jugement normatif de sa formulation» (Ogien, 2003, p. 99). Retenons deux choses de ce premier développement : premièrement, une norme peut se formuler de plusieurs manières, même si l’on peut repérer des modalités d’énonciation dominantes; l’examen linguistique n’épuise pas l’analyse conceptuelle. Secondement, une norme exprime toujours une recommandation ou une obligation à faire ou à ne pas faire. 2. Nous utiliserons de manière indifférenciée les adjectifs «normatif» (du latin norma : la règle, l’équerre) et «déontique» (du grec deon : le devoir, l’obligation), on peut également parler d’énoncé prescriptif ou directif. Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.123.208.211 - 23/03/2020 08:14 - © ADRESE/CIRNEF Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.123.208.211 - 23/03/2020 08:14 - © ADRESE/CIRNEF 2. Distinguer Normes et valeurs En effet, dès lors que l’on caractérise le normatif par l’idée de recommandation, on est en droit de se demander si le domaine des valeurs n’est pas un sous-ensemble du monde des normes. «… Le simple repérage de la question de la normativité (…), remarque Pierre Demeulenaere, donne lieu à un certain nombre de difficultés préliminaires fondamentales : la première et la plus évidente tient à la localisation même de ce qui est (ou doit être) considéré comme normatif par rapport à ce qui ne le sera pas» (Demeulenaere, 2001, p. 187). Faut-il rapprocher la valeur de la norme ou faut-il, au contraire, considérer ces deux domaines comme des domaines distincts? Le jugement de valeur n’enferme-t-il pas une incitation, une exigence à faire, n’est-il pas finalement, lui aussi, de l’ordre du normatif? Affirmer par exemple que «la mer est belle» n’est-ce pas aussi dire que l’on doit s’engager à la préserver. Cette la thèse qui consiste à subsumer le domaine de la valeur sous celui de la norme, en raison d’une caractéristique contraignante commune, est notamment défendue par Pierre Livet. «En fait, écrit Pierre Livet, les valeurs sont aussi du domaine du normatif, sinon des normes. Toute valeur, en effet, nous donne un conseil et nous suggère une orientation puisqu’elle nous indique dans quel sens nous pourrions souhaiter que le monde évolue ou dans quel état nous souhaitons qu’il se maintienne» (Livet, 2006, p. 30). Cette affirmation nous semble difficilement défendable. Un jugement de valeur -ou jugement axiologique- n’appelle pas nécessaire- ment un engagement, il peut simplement être de l’ordre de l’expression et donc être inerte du point de vue pratique3. «Quelle étrange situation!» s’exclame l’explorateur débarquant en terre inconnue et qui, ce faisant, énonce bien un jugement de valeur mais qui n’appelle ni engagement, ni désengagement. Il semble que lorsqu’un énoncé axiologique est plus expressif (c’est-à-dire référé aux émotions et aux impressions du sujet) qu’évaluatif (c’est-à-dire référé aux qualités du monde), qu’il perde sa dimension de recommandation. En conséquence, nous partageons la position «déflationniste» de Ruwen Ogien qui réserve l’adjectif «normatif» aux seuls énoncés explicitement prescriptifs ou directifs et nous demande de ne pas mettre dans le même «sac métaphysique» normes et valeurs (Ogien, 2003, p. 98). Nous pouvons confirmer cette thèse en examinant les domaines auxquels s’appli- Les uploads/s1/ e-prairat-considerations-sur-lidee-de-norme.pdf
Documents similaires




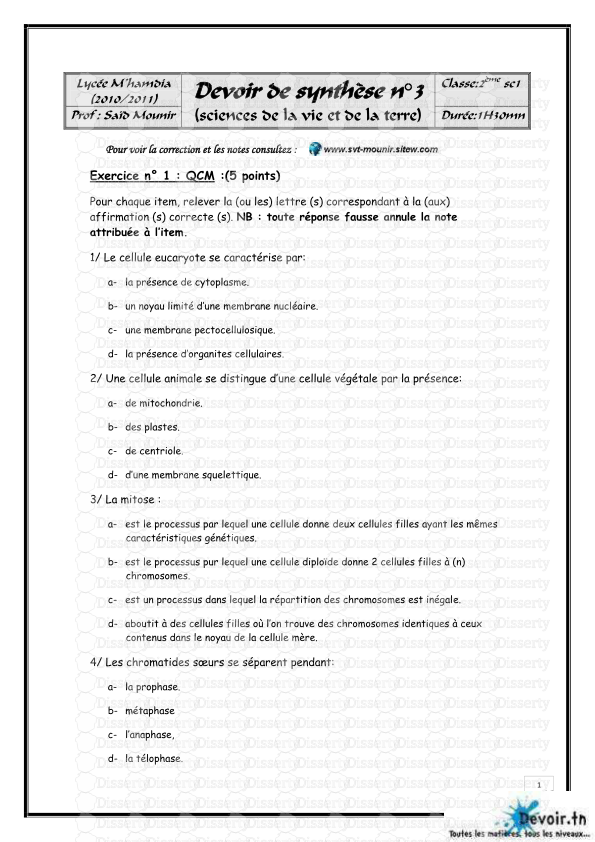





-
171
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 09, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.3934MB


