ANALYSE DE LA MORPHOLOGIE URBAINE. Analyse de la morphologie urbaine AUCAME - M
ANALYSE DE LA MORPHOLOGIE URBAINE. Analyse de la morphologie urbaine AUCAME - Mai 2008 - 2 - Analyse de la morphologie urbaine AUCAME - Mai 2008 - 3 - Une large diversité des formes et fonctions urbaines1. La ville est un espace constitué par l’adjonction de formes urbaines variées, qui traduisent chacune la conception de la ville et de la vie en commun à une époque donnée. Chaque grande idéologie politique a produit une forme urbaine originale. Cette forme intègre les fonctions urbaines qui lui sont associées : l’habitat, les activités économiques, culturelles et de loisirs, … . On parle alors de mixité fonctionnelle lorsque sont représentées dans un quartier au moins deux de ces fonctions. Une autre manière de qualifier les formes urbaines est la densité. Elle est caractérisée par le coefficient d’occupation des sols (COS) qui calcule la densité de construction sur une parcelle. Il faut distinguer la densité réelle et la densité perçue. En effet, les quartiers de grands ensembles ressentis comme très denses, sont moins denses que certains quartiers constitués de maisons de ville : les immeubles sont largement séparés pour éviter les phénomènes d’ombre-portée et entourés de très vastes espaces publics. Néanmoins, l’habitat individuel est en général moins dense que l’habitat collectif. On trouve sur le territoire du SCoT des espaces aux densités très variables qui participent à la multitude de formes urbaines. Ainsi, Caen-Métropole est un musée des formes urbaines à ciel ouvert. Le territoire dispose de quasiment toutes les formes urbaines qui ont marqué l’Histoire de France : bâti ancien, cités ouvrières, centre reconstruit, ville nouvelle... Ces formes sont le témoignage de l’histoire économique, sociale et urbanistique de la métropole. Le rôle des formes urbaines est considérable puisqu’elles agissent directement sur les pratiques et la qualité de vie. Des réflexions poussées sur les formes urbaines permettent aujourd’hui de jouer sur ces éléments. 1 : Toutes les photos aériennes sont issues, soit du site Internet « Google Earth », soit de l’Orthophotoplan 2006 mis à disposition par le Conseil Général du Calvados. Les autres photos appartiennent à la photothèque de l’AUCAME Analyse de la morphologie urbaine AUCAME - Mai 2008 - 4 - L’espace urbain dense Le centre ancien de Caen Contrairement à l’image véhiculée par l’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, Caen, ville reconstruite, conserve un centre ancien hérité du Moyen- âge, puis de l’époque classique, plus particulièrement au nord-ouest du centre reconstruit : bâti dense, rues étroites et sinueuses, voisinent avec de vastes emprises foncières des congrégations ou de l’armée, dont la reconversion porte des enjeux importants pour la ville centre. Dans l’hyper-centre médiéval, la densité bâtie est très forte. Dans les anciens faubourgs médiévaux, derrières les façades sur rues, les jardins et les cours forment des enclaves privées verdoyantes qui contribuent à aérer le tissu. Place St Sauveur/ Place des Petites Boucheries/ Ilot rue Froide/ Hôtel de ville rue Caponière rue Demolombe Le Vaugueux rue St Pierre une vue générale d’avant guerre Faubourgs et cités ouvrières Caen-Métropole a un passé ouvrier riche qui a donné lieu à des formes urbaines originales. La rive droite de l’agglomération caennaise, où se sont localisées les principales entreprises de main-d’œuvre, témoigne particulièrement de ce passé ouvrier. Le développement industriel s’est traduit par la construction de véritables cités, dont les plus remarquables sont la cité des Rosiers2 et celle du Plateau3. Elles apparaissent à une époque où la vie dans les faubourgs ouvriers (tels Vaucelle) est devenue insoutenable. En réaction à cette difficile situation, une idéologie de défiance à l’égard de la ville traditionnelle, lieu de perdition des 2 Caen 3 Colombelles, Mondeville et Giberville Analyse de la morphologie urbaine AUCAME - Mai 2008 - 5 - mœurs et de perte de productivité, émerge dans la pensée de la ville. Le retour aux valeurs paysannes et à la vie en communauté est prôné. La cité du Plateau est l’archétype de la cité ouvrière patronale. Elle émerge des préoccupations paternalistes du PDG de la SMN4 qui désire contrôler le mode de vie et les mœurs de ses ouvriers afin de sécuriser sa production. L’urbanisme de la cité permet de mettre en œuvre ce dessein. C’est un espace clos, fermé sur l’extérieur pour éviter l’influence néfaste que pourrait avoir la ville. Pour permettre ce repli sur soi, services, équipements et commerces ont été implantés au cœur de la cité dès sa création, ce qui fait toujours de cet espace un véritable lieu de vie. En outre, seuls les quartiers aisés ont leur square pour éviter les rassemblements d’ouvriers. Le plan de la cité du Plateau traduit la structure sociale. L’espace est fortement hiérarchisé : le quartier des chefs de services et ingénieurs est situé à proximité de la villa du directeur, elle-même à côté des bureaux de la SMN. Plus on s’éloigne de ces bureaux, plus les maisons et les jardins deviennent modestes sans pour autant arriver à une forte densité. Une place importante est laissée à la nature : le plan urbain est très aéré et les maisons ont toutes leur propre jardinet. Jardinet qui a pour fonction de distraire les ouvriers par une occupation jugée saine. La citée de l’ex SMN : un quartier intercommunal 4 Société Métallurgique de Normandie Analyse de la morphologie urbaine AUCAME - Mai 2008 - 6 - Quelques quartiers sont constitués entièrement de maisons des années 1930/50, caractéristiques de l’habitat ouvrier. Bien que le bâti y soit moins homogène, ils forment eux aussi de véritables « cités jardins » quasiment au cœur de l’agglomération. Certains connaissent aujourd’hui une importante mutation sociologique, avec le remplacement des retraités issus des milieux populaires par des familles de la classe moyenne. C’est notamment le cas des quartiers Vaucelles et Sainte-Thérèse à Caen et des Charmettes à Mondeville. Ce phénomène est appelé « gentryfication ». Un ancien faubourg ouvrier en voie de « gentryfication » : le quartier desFfleurs La rue Victor Lépine un îlot du quartier Ste Thérèse : une certaine densité (25 logt/ha) Les quartiers de la Belle Epoque Ces quartiers ont été édifiés, à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, par les classes aisées en dehors du centre de Caen pour fuir l’insalubrité générée notamment par les égouts à ciel ouvert. Ce sont des quartiers entièrement résidentiels dont les maisons et les villas présentent parfois une architecture spectaculaire, inspirée de l’Art Nouveau : en réaction à l’industrialisation, l’Art Nouveau développe des formes épurées et directement inspirées par la nature. Le quartier du Nice Caennais en est un exemple typique, ainsi que le quartier de la gare Saint-Martin dont la proximité permettait aux habitants de se rendre sur la Côte de Nacre afin de profiter des bains de mer. La densité y est assez élevée pour des quartiers d’habitat individuel ; la rue du XXème siècle à côté du Jardin des Plantes de Caen en est le meilleur exemple (32 logements par hectare). Le centre reconstruit de Caen La ville de Caen a été détruite à près de 70% par les bombardements qui ont suivi le Débarquement du 6 juin 1944. Une opération de reconstruction de grande ampleur a ainsi été menée. Elle a pris une forme particulière, puisque contrairement à d’autres villes reconstruites comme Le Havre, Dunkerque ou Lorient, le parti pris a été de conserver le plan originel de la ville, même si quelques entorses à la règle ont été opérées, notamment avec le percement de l’avenue du 6 juin. Le plan de la ville reconstruite est imprégné de l’idéologie dominante de l’époque : le fonctionnalisme. En urbanisme, cela se traduit par des formes urbaines rationnelles. Le plan privilégié est le plan orthogonal : à Caen, l’île Analyse de la morphologie urbaine AUCAME - Mai 2008 - 7 - Saint-Jean a été construite selon ce modèle. Le tissu urbain est aéré pour laisser entrer le soleil dans les constructions et pour permettre la circulation automobile. Celui de Caen est néo-haussmannien. Il est divisé en îlots, au centre desquels un espace de parking et de stockage pour les commerces est réservé (initialement, il était prévu comme espace vert récréatif et de loisirs pour les résidents). Ces îlots de centre-ville sont mixtes avec la présence de commerces, de bureaux et de logements. En matière architecturale, le parti choisi est la diversité et la simplicité. L’uniformité est rejetée, contrairement au Havre, au profit de directives générales relatives aux toitures, aux matériaux (la pierre de Caen) et aux volumes globaux qui confèrent cependant une certaine homogénéité à la reconstruction caennaise. Vue en perspective en 2001 Les tours Marines en 1954 La CCI en1960 Le quartier des Quatran en1960 L’université en 1960 Analyse de la morphologie urbaine AUCAME - Mai 2008 - 8 - Différentes formes urbaines se distinguent dans la reconstruction caennaise : − l’avenue du 6 juin et les tours marines : les tours, de hauteur inhabituelle pour la ville de Caen, balisent visuellement la perspective vers le château. La monumentalité de la reconstruction s’exprime particulièrement dans ces tours. Elles sont reliées entre elles et comportent toutes des cases commerciales uploads/s3/ 1-3-analyse-de-la-morphologie-urbaine-pdf.pdf
Documents similaires



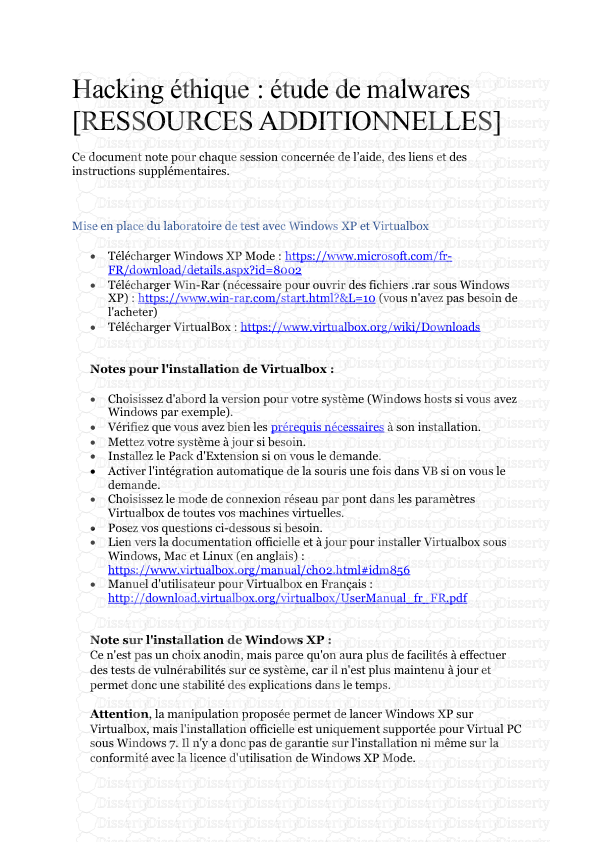






-
28
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 16, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.2508MB


